Qu’est-ce que le racisme? Que pouvons-nous faire pour y mettre fin?
Le racisme est une combinaison de pensée stéréotypée, de sentiments négatifs et haineux et d’actes discriminatoires ciblant des individus ou des groupes d’individus considérés comme intrinsèquement inférieurs, plutôt déviants socialement et méritant un statut inférieur dans la société. Même si tous les humains sont susceptibles d’entretenir des stéréotypes et des préjugés à l’égard d’autres groupes, le racisme devient un problème grave lorsqu’un groupe, ou les membres de ce groupe ont la capacité d’agir en se fondant sur ces points de vue et sur la valeur qu’ils attribuent aux autres.
- Le racisme est un phénomène de catégorisation sociale et un système de comportements profondément enracinés dans l’histoire de la colonisation et de l’esclavage. La construction d’une hiérarchie raciale par les puissances coloniales continue de favoriser les personnes qui détiennent le pouvoir en maintenant leur domination sociale, économique et politique.
- Les groupes qui deviennent les cibles du racisme ont généralement des caractéristiques physiques distinctes, comme la couleur de la peau, les traits du visage et la forme du corps. Historiquement, en Amérique du Nord et dans d’autres pays occidentaux, il s’agit surtout de personnes au teint foncé, qui constituent une minorité et qui sont défavorisées sur le plan socio-économique en raison du racisme systémique (p. ex., les personnes autochtones, noires et de couleur [PANDC]). Dans la présente fiche d’information, nous nous concentrons sur le racisme, mais nous reconnaissons que le racisme coexiste avec le sexisme, l’homophobie et la transphobie, le classisme, le capacitisme, etc.
Le racisme individuel renvoie au racisme intériorisé, qui existe à l’intérieur de la personne. Les sentiments, les paroles et les actes anti-Noirs, anti-Autochtones et anti-Asiatiques en sont des exemples. Le fait de croire que certains groupes sont intrinsèquement inférieurs à d’autres est un exemple de racisme individuel. Dans certains cas, les gens peuvent cautionner le racisme ouvertement ou de manière plus subtile, ce qu’on appelle aussi microagression.
Le racisme systémique fait référence aux pratiques déloyales et au traitement inéquitable des groupes touchés, soit en raison de la légitimation institutionnelle ou par la voie d’un consensus général et de pratiques informelles en usage depuis longtemps au sein des groupes majoritaires et privilégiés. En Amérique du Nord, le racisme systémique est le ciment sur lequel s’appuie la suprématie blanche pour opprimer et exploiter les minorités racialisées. Voici quelques-uns des nombreux exemples de racisme systémique, qui ont jalonné l’histoire du Canada :
- Du 17eau 19e siècle, 200 ans d’esclavage, où les populations noires et autochtones étaient les principaux peuples asservis.
- La Loi sur les Indiens de 1876 a pratiquement fait des peuples autochtones des pupilles de l’État. Entre 1894 et 1996, la politique canadienne exigeait que les enfants autochtones soient retirés de leur famille et placés dans des pensionnats gérés par des prêtres et des religieuses catholiques. Ces enfants ont été forcés d’abandonner leurs traditions culturelles, y compris leur langue.
- 1885 : la Loi de l’immigration chinoise obligeait les immigrants chinois à payer un impôt très élevé pour venir au Canada, alors que les immigrants européens n’étaient pas tenus de payer cet impôt.
On a tendance à considérer le racisme comme une affaire de « bonnes » personnes vis-à-vis de « mauvaises » personnes, ce qui amène souvent les Blancs à chercher à se positionner comme les « bonnes personnes », car ils pensent avoir de bonnes intentions, et ne peuvent donc pas être racistes. De là naît un schéma de pensée, qui empêche d’examiner ses propres attitudes et comportements racistes. Ainsi, les PANDC peuvent être confrontées à des réactions extrêmement défensives, et parfois agressives, niant le comportement raciste. Cette dynamique sert à maintenir la suprématie blanche en muselant les PANDC et en les empêchant de parler du racisme qu’ils subissent.
Qu’est-ce que la psychologie du racisme?
Le racisme englobe : i) Les stéréotypes sociaux; les pensées généralisées; ii) les préjugés; les attitudes négatives et les émotions négatives; iii) la discrimination; les comportements injustes et inéquitables à l’égard des individus en raison de leur appartenance à un groupe.
Stéréotypes sociaux et jugements biaisés
- L’esprit humain a comme caractéristique fondamentale de diviser le monde social en deux catégories : les gens qui me ressemblent (intragroupe) et les gens qui ne me ressemblent pas (hors-groupe). Cette idée de similarité et de dissimilarité avec autrui peut être fondée sur des critères bien visibles, comme la couleur de la peau, le sexe, l’âge, la langue, ou sur des critères qui ne sont pas aussi visibles, comme le système de croyances, la religion, la culture ou l’origine ethnique.
- En raison de la fréquence et de l’habitude des interactions avec les membres de l’intragroupe, on peut identifier et distinguer les membres de l’intragroupe avec une relative facilité. En revanche, la relativement faible familiarité avec les membres hors-groupe est associée à une propension à percevoir et à juger l’hors-groupe comme un tout. Cela engendre des stéréotypes sociaux ou des pensées généralisées sur les hors-groupes, du genre « les Autochtones sont des alcooliques» ou « les Noirs sont des criminels ».
- Cette propension à percevoir l’hors-groupe comme un tout est associée à l’effet de similitude. Cela peut expliquer en partie pourquoi les policiers sont susceptibles de commettre des erreurs lorsqu’il s’agit d’identifier des personnes appartenant aux « hors-groupes » qu’ils connaissent peu. Lorsqu’une erreur de jugement de ce genre se produit dans le contexte du racisme systémique, des conséquences négatives graves peuvent s’ensuivre, par exemple, des situations où un policier appréhenderait non seulement la mauvaise personne, mais ferait preuve, en plus, de brutalité à l’égard de celle-ci si elle est membre d’une communauté PANDC.
- Le terme parti pris implicite renvoie au fait d’avoir une vision stéréotypée d’une catégorie de personnes sans en être conscient. Cependant, certaines situations peuvent entraîner un parti pris implicite sans qu’on en ait conscience, déclenchant dès lors une réponse comportementale partiale, par exemple, des insultes raciales involontaires ou le traitement injuste non intentionnel de la part des personnes appartenant aux communautés PANDC.
Préjugés et sentiments de haine
- Lorsqu’ils s’accompagnent d’attitudes et d’émotions négatives, comme la colère, la haine, l’irritabilité et la peur, les stéréotypes négatifs à l’endroit d’une catégorie de personnes deviennent des préjugés.
- Les préjugés peuvent également sembler « positifs », mais les attitudes qu’ils dénotent sont paternalistes, condescendantes et normatives; par exemple, «Tu devrais être attentionné et aimable. Tu es un Philippin », ou « Tu devrais être bon en mathématiques. Tu es Chinois ».
- Les préjugés peuvent se traduire par un sentiment de malaise, d’irritabilité, de colère, de pitié et de dégoût envers les membres de groupes racialisés, ethniques et culturels minoritaires et par le refus de s’associer avec eux. Cependant, le préjugé peut s’accompagner du refus de reconnaître, par la personne qui l’entretient, cette attitude émotionnelle négative.
- Lorsque les membres d’une minorité se conduisent bien et suivent les règles, ils sont considérés de manière impartiale. Toutefois, lorsque les membres d’une minorité dévient de la norme, violent une loi, ont un rendement inférieur à celui attendu ou donnent une rétroaction ou une évaluation négatives, la réaction du membre du groupe privilégié est parfois plus prompte et plus sévère. Par exemple, si un professeur noir donne de bonnes notes et des commentaires favorables aux étudiants, il est considéré au même titre que son collègue de la majorité blanche européenne. Cependant, si les deux professeurs donnent de mauvaises notes et des commentaires négatifs aux étudiants, le professeur noir sera probablement évalué plus sévèrement par ses étudiants que son collègue blanc européen.
- Les préjugés ont un impact négatif sur la personne qui en est l’objet et peuvent conduire à des sentiments et des comportements réciproques. Ainsi, si une personne n’aime pas une autre personne ou fait preuve de discrimination à son endroit, ces attitudes et ces comportements se retournent contre elle. Les personnes qui expriment des préjugés et qui se livrent à des pratiques discriminatoires ne peuvent pas s’attendre à être aimées ou acceptées par celles qui sont exclues. Par conséquent, les individus qui sont régulièrement exclus du fait de préjugés systémiques ou individuels sont susceptibles de se venger de ceux qui sont à l’origine de ces préjugés.
Discrimination : traitement injuste et inéquitable
- La discrimination est une action qui a pour effet de traiter les individus différemment, et à leur désavantage, en fonction de leur appartenance à un groupe.
- Les actes discriminatoires peuvent avoir de graves répercussions, par exemple, si un médecin passe moins de temps avec un membre d’une minorité racialisée, ou ne prend pas au sérieux la gravité de ses symptômes ou interprète mal les symptômes et refuse de prodiguer les soins nécessaires. Cet acte discriminatoire peut être intentionnel ou non, mais ses conséquences peuvent être graves.
- La discrimination est parfois subtile et souvent non verbale. Par exemple, un caissier de banque pourrait accueillir les membres de son intragroupe avec une courtoisie particulière, avec le sourire, et en leur offrant une aide supplémentaire, mais pourrait avoir une attitude très formelle et axée sur les tâches sans être particulièrement courtois ou affable avec les membres du groupe minoritaire racialisé. Faire des salutations peu enthousiastes ou ignorer les salutations des gens, montrer des signes de désintérêt pendant les interactions ou s’abstenir d’offrir de l’aide lorsque le besoin est manifeste, être prompt à signaler d’une voix forte une violation mineure de certaines normes (par exemple, « Hé, vous ne pouvez pas vous asseoir là. C’est pour les aînés seulement») sont d’autres exemples de comportements discriminatoires.
- Des pratiques discriminatoires sont souvent observées dans les milieux de travail. Cela peut commencer par la préférence accordée à la sélection de candidats issus de groupes privilégiés, ce qui fait en sorte que moins de membres de minorités racialisées sont convoqués en entrevue. Pendant l’entrevue, la discrimination est manifeste lorsque l’employeur consacre moins de temps à la procédure d’embauche et montre des signes de malaise ou un manque d’intérêt. En outre, le candidat minoritaire racialisé se fera probablement offrir un salaire de départ inférieur, ce qui contribuera à des écarts de salaire qui s’ajoutent aux disparités sur le plan des richesses accumulées pour maintenir la suprématie des Blancs. La discrimination est susceptible de se poursuivre sous la forme d’évaluations du rendement biaisées et de l’absence de promotions malgré les qualifications de l’employé. Cela met en évidence l’importance du déséquilibre des pouvoirs entre les groupes. En d’autres termes, les évaluations négatives des autres sont possibles lorsqu’un groupe est capable d’agir sur la base des stéréotypes négatifs et des préjugés qu’il entretient à l’égard d’un autre groupe.
- Il en résulte une « mosaïque verticale » dans laquelle, aux postes de direction de la plupart des organisations, nous voyons des individus appartenant au groupe privilégié, notamment des personnes d’origine blanche européenne. Au bas de la hiérarchie de l’emploi, où figurent les emplois manuels peu rémunérés, comme l’entretien ménager et le lavage de vaisselle, nous observons une surreprésentation des groupes minoritaires racialisés. Cela conduit à des disparités économiques. Par exemple, en 2016, le taux de chômage était plus élevé chez les Canadiens noirs que chez les Canadiens non issus d’une minorité visible (12,5 % vs 7,3 %). De plus, le revenu moyen des Canadiens noirs était nettement inférieur à celui des Canadiens qui n’appartenaient pas à une minorité visible (35 310 $ vs 50 225 $).
- La discrimination s’observe également dans le système judiciaire et le système de placement familial. Tandis que les peuples autochtones ne représentent que 3,8 % de la population totale, 23,2 % de l’ensemble des personnes incarcérées et 52 % des enfants en famille d’accueil sont autochtones.
- La discrimination a des répercussions négatives sur la santé physique et mentale de la personne qui la subit. Beaucoup des données solides et cohérentes indiquent que le racisme autodéclaré est associé à des problèmes de santé physique comme l’hypertension, les maladies cardiaques et l’obésité. Il se manifeste également par l’augmentation des maladies mentales comme la dépression, l’anxiété, la détresse et la toxicomanie. Les répercussions négatives du racisme sur la santé physique et mentale s’observent chez les hommes et les femmes de tous les groupes ethniques, y compris les Noirs, les Autochtones, les Latinos, les Asiatiques et les Blancs de tous les groupes d’âge (c.-à-d. adolescents, étudiants universitaires et adultes).
Comment apprendre à vivre ensemble et sans racisme?
La démarche à adopter pour combattre le racisme individuel et systémique doit s’effectuer à l’échelle individuelle et à l’échelle gouvernementale, juridique et politique.
- S’il n’est pas stoppé, le racisme risque de s’aggraver. Les génocides, par exemple, ne se déclenchent pas du jour au lendemain. Il est donc important de combattre le racisme dès qu’il se manifeste, même dans ses formes les plus légères et subtiles, chez les gens ou dans les médias sociaux. Il faut immédiatement confronter et combattre les signes et les symboles d’oppression et de harcèlement à caractère racial qui s’expriment à une moindre échelle, comme les farces, le vandalisme, les insultes raciales et les blagues racistes. Les individus, par exemple, pourraient confronter leurs amis et leurs proches, et répondre aux messages négatifs qu’ils publient sur les médias sociaux.
- Le poids de la sensibilisation et de la prévention des actes haineux motivés par les préjugés et de la discrimination ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des groupes minoritaires racialisés. Au lieu de cela, les membres de la majorité qui ont hérité, et donc bénéficié des systèmes de pouvoir fondés sur la suprématie raciale, ont la responsabilité de réparer les torts et d’instaurer la justice. Ils doivent agir pour devenir de véritables partenaires du changement. Il s’instaurera ainsi la confiance entre groupes majoritaires et minoritaires, ce qui favorisera la motivation des groupes minoritaires racialisés à travailler avec les partenaires majoritaires. Pour les groupes majoritaires et minoritaires, il est essentiel de travailler ensemble pour transformer la société.
- Le principe psychologique selon lequel la familiarité et la similitude créent des liens peut être mis en œuvre en donnant l’occasion aux gens d’augmenter leurs interactions avec l’« autre », dissemblable. Cela leur permettrait de découvrir des similitudes fondamentales pour renforcer le sentiment de familiarité générale tout en comprenant les différences culturelles. À l’école, on pourrait, par exemple, concevoir des plans de cours pour les jeunes enfants, mettant l’accent sur l’exploration des similitudes et la compréhension et l’appréciation des différences entre les enfants.
- Les activités et les événements communautaires doivent inclure TOUS les groupes culturels, et ce, à tous les échelons (organisation, représentation, participation). Les membres de la majorité privilégiée doivent y prendre part aux côtés des minorités raciales. Les programmes communautaires devraient viser à favoriser une coopération et des échanges fructueux entre les groupes majoritaires privilégiés et les groupes minoritaires racialisés, réunis autour d’un objectif commun.
- Il a été démontré que les contacts entre personnes d’origines diverses améliorent l’acceptation réciproque de la différence. Toutefois, de tels contacts sont probablement plus efficaces s’ils sont volontaires, s’ils s’établissent entre des individus de statut à peu près égal et s’ils ont comme objectif de promouvoir l’inclusion et réduire la discrimination. Les conditions propices à ces contacts doivent être mises en place par le truchement de politiques et de programmes publics.
- Toutes les institutions sociales (gouvernement, soins de santé, éducation, famille, etc.) doivent reconnaître les politiques et les comportements racistes tout en s’engageant activement à éliminer les discriminations passées. Il faut mettre en place des mesures et des approches qui favorisent l’équité, la diversité et l’inclusion. Cela se fera sur plusieurs plans : (1) formation continue, éducation et discussion; (2) se responsabiliser pour prévenir les actes racistes et s’attaquer au racisme quand celui-ci est pratiqué; (3) organiser nos institutions de telle manière qu’elles favorisent intrinsèquement la diversité et la justice sociale.
- Nous devons soutenir les politiques et les programmes qui favorisent l’acceptation des gens tels qu’ils sont, et de ce qui compte le plus pour eux, comme leur patrimoine culturel et leur religion.
- Le fait de nous responsabiliser quant à la manière dont la société a été structurée au profit des Blancs et aux comportements racistes, à l’échelle individuelle et institutionnelle, permettra de faire évoluer la société vers un vivre ensemble exempt de racisme.
Où puis-je obtenir plus d’information?
- Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme/strategie-contre-racisme.html - Race Relations in Canada 2019 Survey
https://www.environicsinstitute.org/projects/project-details/race-relations-in-canada-2019 - Pour savoir si une intervention psychologique peut vous aider, consultez un psychologue agréé qui a une formation sur l’antiracisme et la diversité culturelle. Les personnes touchées par le racisme peuvent bénéficier d’une intervention de la part d’un psychologue qui s’identifie comme Noir, Autochtone ou personne de couleur. Les associations provinciales et territoriales, et certaines associations municipales offrent des services d’aiguillage. Pour connaître les noms et les coordonnées des associations provinciales et territoriales de psychologues, veuillez vous rendre à l’adresse https://cpa.ca/publicfr/Unpsychologue/societesprovinciales/.
La présente fiche d’information a été préparée pour la Société canadienne de psychologie par Gira Bhatt (Université polytechnique Kwantlen), Saba Safdar (Université de Guelph), John Berry (Université Queen’s), Maya Yampolsky (Université Laval) et Randal Tonks (Collège Camosun).
Date : 12 octobre 2020
Votre opinion est importante! Si vous avez des questions ou des commentaires sur les fiches d’information de la série « La psychologie peut vous aider », veuillez communiquer avec nous : factsheets@cpa.ca.
Société canadienne de psychologie
1101 promenade Prince of Wales, bureau #230
Ottawa, ON K2C 3Y4
Tél. : 613-237-2144
Numéro sans frais (au Canada) : 1-888-472-0657

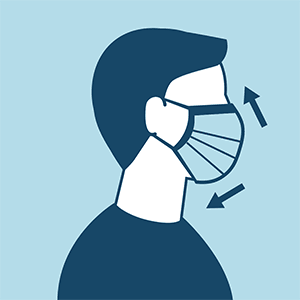 CDC recommends wearing cloth face coverings in public settings where other social distancing measures are difficult to maintain (e.g., grocery stores and pharmacies), especially in areas of significant community-based transmission.
CDC recommends wearing cloth face coverings in public settings where other social distancing measures are difficult to maintain (e.g., grocery stores and pharmacies), especially in areas of significant community-based transmission.
 Meghan Norris: The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science
Meghan Norris: The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science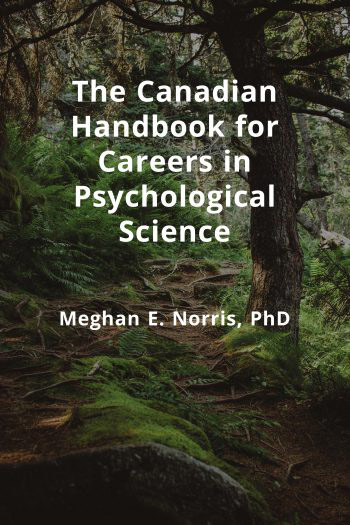
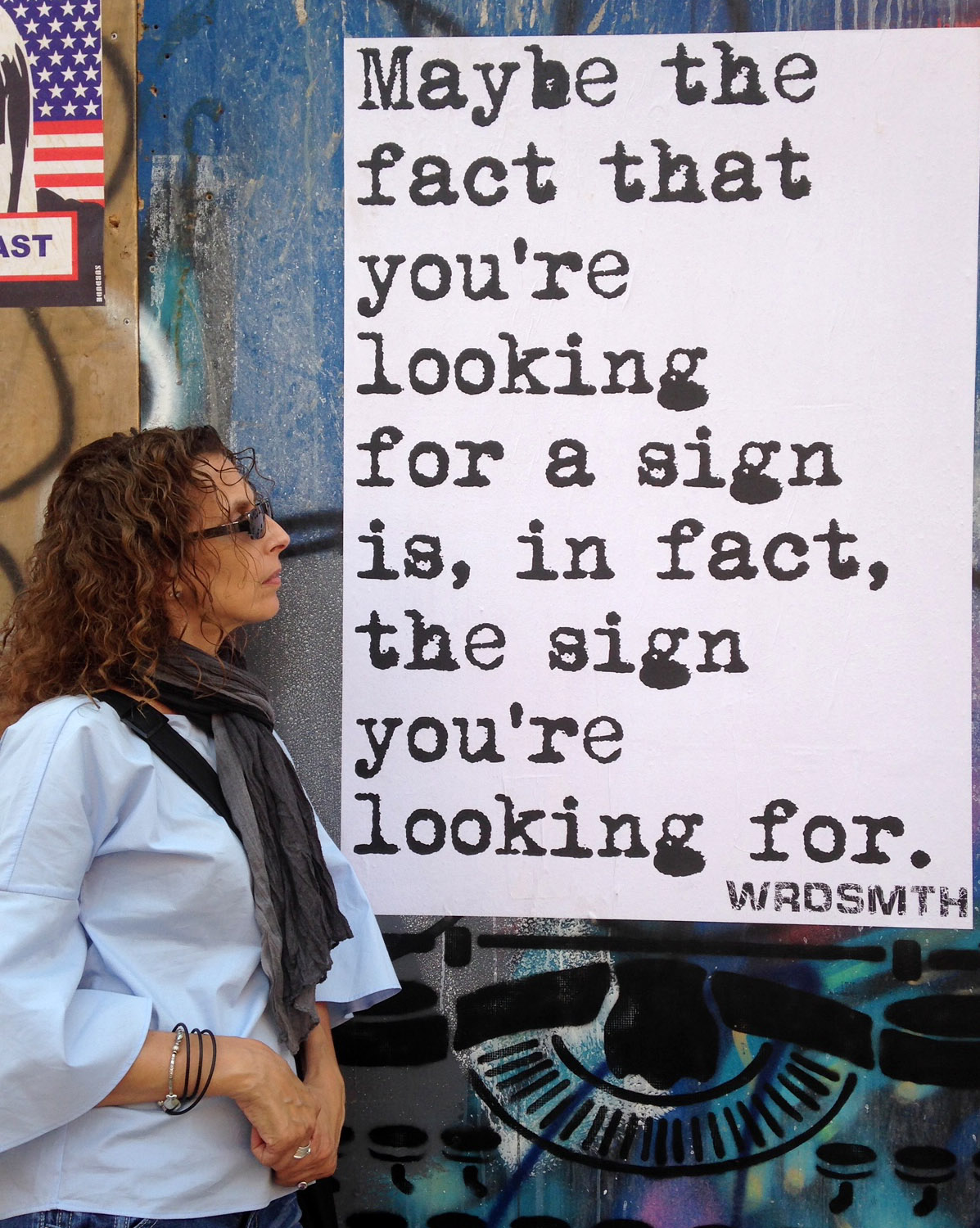 Leanna Verrucci
Leanna Verrucci Leigh Greiner
Leigh Greiner Marais Bester
Marais Bester