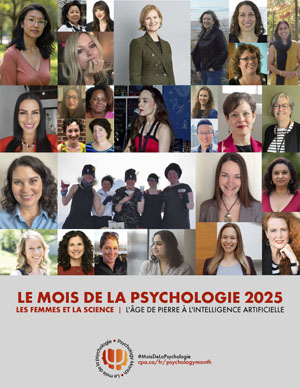
Les femmes et la science
Le thème du Mois de la psychologie de 2025 est « Les femmes et la science ». Ce mois-ci, nous mettrons en lumière le travail de 34 scientifiques remarquables, avec notamment huit nouveaux balados et profils. Le Mois de la psychologie de 2025 suivra des scientifiques tout au long de leur parcours, des études jusqu’à la retraite, et nous emmènera de la Colombie-Britannique à l’Île-du-Prince-Édouard, et du pôle Nord à l’espace extra-atmosphérique.

Liisa Galea
La Dre Liisa Galea est responsable scientifique du programme CAMH (Centre de toxicomanie et de santé mentale) womenmind™. Il s’agit d’une communauté de philanthropes, de leaders d’opinion et de scientifiques qui se consacrent à la lutte contre les disparités entre les sexes dans le domaine des sciences et à mettre les besoins et les expériences uniques des femmes au premier plan de la recherche sur la santé mentale.
Womenmind™ Liisa Galea
« L’agent de location sait comment *accepter* une réservation, mais il ignore comment garantir que la voiture sera bien réservée, ce qui est la partie la plus importante du processus. » [traduction]
- Seinfeld, ‘The Alternate Side’, 1991
Les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis ont introduit en 1993 une politique* en vertu de laquelle les propositions de recherche impliquant des sujets humains dans le cadre d’essais cliniques doivent prévoir l’inclusion de femmes, de membres de minorités et d’enfants dans la recherche proposée. C’est donc précisément ce qu’ont fait les scientifiques qui ont demandé des subventions de recherche. Ils ont inclus les femmes, les membres de minorités et les enfants dans leurs études. Mais à quelle fin?
Il est facile d’inclure les femmes, les membres de minorités et les personnes de la diversité de genre, mais si l’on ne cherche pas à savoir si cela affecte différemment les résultats chez ces personnes, on ne fait que la moitié du travail – et l’on passe à côté de ce qui fait l’importance de l’inclusion. Or, depuis l’introduction de cette politique, très peu de recherches ont fait cette distinction.
*Il convient de souligner qu’il est très difficile, à l’heure actuelle, de déterminer exactement quand les NIH ont institué cette politique, ou quels en ont été les résultats, étant donné que la nouvelle administration présidentielle américaine a expurgé ses sites Web et ses ressources de tout langage faisant référence aux « minorités » (minorities), à la « disparité » (disparity), aux « préjugés » (bias), et même aux « femmes » (women).
La Dre Liisa Galea dirige le Women’s Health Research Cluster au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Elle est la rédactrice en chef principale de Frontiers in Neuroendocrinology, la présidente sortante de l’Organization for the Study of Sex Differences et la co-vice-présidente de la Canadian Organization for Gender and Sex Research. Elle est également la responsable scientifique de l’initiative womenmind™ du CAMH et une inconditionnelle de Seinfeld.
« J’ai grandi à une époque où je devais porter une jupe à l’école parce que j’étais une fille. Je suis très reconnaissante à mes parents de m’avoir dit que j’étais intelligente et que je pouvais faire tout ce que je voulais... sauf peut-être devenir pape! On m’a dit que j’étais différente parce que j’étais une fille, mais cela ne me dérangeait pas – j’étais simplement curieuse de comprendre pourquoi les gens pensaient ainsi. Lorsque je suis entrée à l’université, je me suis intéressée de près à la question des cerveaux féminins et masculins et j’ai voulu en savoir plus sur les différences entre les deux et sur ce que cela pouvait représenter pour notre santé ».
womenmind™ est une communauté de philanthropes, de leaders éclairées et de scientifiques qui se consacrent à la lutte contre les disparités entre les sexes dans le domaine scientifique, et qui cherchent à placer les besoins et le vécu propres aux femmes au premier plan de la recherche en santé mentale. La Dre Galea et la Dre Daisy Singla, une psychologue clinicienne spécialisée en santé mentale périnatale, sont les scientifiques qui, au sein de womenmind™, effectuent une grande partie de ce travail important.
Les disparités entre les sexes dans les soins de santé sont réelles et elles sont considérables, en particulier dans le domaine de la santé mentale. Les diagnostics de problèmes de santé mentale peuvent prendre jusqu’à deux ans de plus pour être établis lorsqu’il s’agit de femmes, comparativement aux hommes. Dans la sphère publique, on a l’impression que les hommes ne parlent pas autant de leurs émotions que les femmes et qu’ils sont moins enclins à chercher de l’aide quand ils éprouvent des problèmes psychologiques. Malgré cela, si l’on considère uniquement les troubles mentaux, le retard dans l’établissement d’un diagnostic est encore de plus de deux ans dans le cas des femmes. Ce retard peut interférer avec les plans de traitement – si les symptômes donnent lieu à un mauvais diagnostic ou sont ignorés, le traitement requis n’est pas dispensé; or, nous savons tous que des interventions précoces permettent d’obtenir de meilleurs résultats cliniques.
Une étude réalisée par le Forum économique mondial a montré que, à l’échelle mondiale, les femmes passent 25 % de plus de leur vie en mauvaise santé que les hommes. La Dre Galea pense que cela est dû en partie au fait que les sciences de la santé sont depuis toujours dominées par des hommes qui étudient les hommes.
« En ce qui concerne la santé mentale en particulier, de nombreuses raisons expliquent les retards de diagnostic, mais je crois que l’une des raisons principales est que la plupart de nos connaissances médicales – y compris les symptômes figurant sur les listes de diagnostic – sont basées sur l’expérience des hommes. À tel point que nous qualifions souvent les symptômes des troubles mentaux chez les femmes d’« atypiques ». Nous utilisons beaucoup le terme « atypique » dans le contexte de la neurodiversité – autisme, TDAH, etc. De plus, le nombre d’hommes chez qui ces problèmes de santé sont diagnostiqués est plus élevé. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à recevoir un diagnostic de dépression, mais le terme « atypique » est également appliqué à la dépression chez les femmes. Si deux fois plus de femmes que d’hommes sont déclarées dépressives, en quoi leurs symptômes sont-ils « atypiques »? Selon moi, c’est parce que nos échelles ont été développées il y a longtemps, en tenant compte des résultats obtenus chez les hommes et de ce que vivent les hommes.
En conséquence, les prestataires de soins de santé n’acquièrent pas suffisamment de connaissances sur les disparités entre les sexes et les genres dans les manifestations et les symptômes de la maladie. Cela a de réelles conséquences pour les femmes dans le système de santé, mais aussi pour les organismes de financement. Chercheuse dans ce domaine depuis 28 ans, le Dr Galea reçoit de nombreux commentaires de la part de rédacteurs en chef et d’organismes de financement disant que *ce [sujet centré sur les femmes]* n’est pas un sujet très important à étudier parce qu’il ne concerne « qu’un sous-ensemble de la population. »
La Dre Galea et son équipe ont effectué une revue de la documentation, en se limitant aux études hommes/femmes en neurosciences et en psychiatrie. 68 % des études utilisaient des participants masculins et féminins, mais seulement 5 % d’entre elles cherchaient à déterminer si le sexe avait une incidence. Comme le dit la Dre Galea, « il peut y avoir deux femmes et huit hommes dans le groupe témoin, mais l’inverse dans le groupe de traitement, et il est impossible d’effectuer une analyse adéquate parce que la taille de l’échantillon n’est pas suffisante pour voir si cela a eu un impact. »
27 % des études portaient uniquement sur les hommes et 3 % uniquement sur les femmes. L’équipe de la Dre Galea a ensuite examiné les subventions canadiennes, ce qui a conduit à des pourcentages similaires. En 2023, la recherche sur la santé mentale des femmes représentait moins de 1 % du financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le principal organisme fédéral responsable du financement de la recherche en santé et en médecine au Canada.
Le financement de la recherche est malheureusement une question brûlante en ce moment, car le nouveau gouvernement américain tente d’interrompre le financement des NIH pour tout ce qui lui semble associé au « wokisme ». Cela a eu un impact sur de nombreux collègues de la Dre Galea et sur le travail qu’ils effectuent, d’autant plus que les coupes semblent avoir été décidées de la manière la plus préjudiciable et la moins rationnelle qui soit. La nouvelle administration a cherché les mots-clés qu’elle n’aimait pas et a interrompu le financement de tout ce qui contenait des mots tels que « bias » (parti pris), « diversity » (diversité) ou « environment » (environnement). Les mots « trans » (trans), « non-binary » (non-binaire), « female » (féminin) et « woman » (femme) ont également été ciblés.
Cela pourrait entraîner la fin d’études portant sur des sujets tels que le microbiome intestinal, dont l’une des mesures est la diversité alpha et la diversité bêta, c’est-à-dire la variété de bactéries qui vivent dans l’intestin humain. Des études dans le domaine de l’électricité utilisant des tubes à vide qui requièrent un courant appelé « bias » (polarisation). Et des études portant sur la santé des femmes. La Dre Galea estime que cette situation est encore plus dangereuse qu’il n’y paraît, car cesser d’étudier la santé des femmes a également des répercussions sur les hommes. Elle donne l’exemple suivant :
« Le lazaroïde est un médicament qui a été découvert pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Il faisait des miracles pour les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Il a d’abord été découvert en phase préclinique, sur des souris et des rats, avant de faire l’objet d’essais cliniques randomisés à double insu, notre étalon de référence. Il s’avère que la plupart des travaux effectués en phase préclinique l’ont été chez des hommes. Le premier essai clinique a été réalisé sur des hommes, car les hommes sont plus susceptibles d’être victimes d’un AVC plus tôt dans leur vie (mais les femmes sont plus nombreuses à subir un AVC plus tard dans leur vie). Le médicament a échoué aux essais cliniques de phase 3, qui comprenaient des femmes, et il n’a pas été mis sur le marché. Cela a entraîné la faillite de l’entreprise pharmaceutique. Mais des analyses secondaires ont révélé que les lazaroïdes font des merveilles chez les hommes, mais pas chez les femmes. En fait, chez les femmes, ils auraient pu aggraver les choses. Mais il s’agit d’un médicament qui n’est plus sur le marché et qui pourrait faire des merveilles pour la santé des hommes! N’est-il pas dans notre intérêt collectif de découvrir les médicaments qui fonctionnent le mieux dans les différentes populations? »
Ce bouleversement pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l’avenir de la santé des femmes, un domaine qui connaît déjà des problèmes graves. Pensons à la ménopause. C’est une réalité qui touchera 50 % de la population. Pourtant, 0,5 % de toutes les études en neurosciences, et dans le domaine de la santé du cerveau en général, portent sur la ménopause. Les médecins reçoivent environ de une à trois heures de formation sur la ménopause et ses effets sur la santé.
Lorsque les femmes atteignent la ménopause et ont des problèmes importants, elles sont envoyées chez des spécialistes, les gynécologues. Mais seulement 38 % des programmes de gynécologie (aux États-Unis) couvrent le sujet. Ainsi, plus de la moitié des femmes qui sont dirigées vers des spécialistes pour ce genre de problème se retrouvent face à une personne qui n’a pas été formée dans ce domaine et qui n’a probablement appris que très peu de choses sur le sujet.
Comme le dit la Dre Galea, « chacune doit devenir sa propre spécialiste, mais il nous faut des recherches approfondies pour savoir ce que nous pouvons faire pour atténuer nos symptômes. Laura Gravelsin (l’une de mes chercheuses postdoctorales) et moi-même venons de faire accepter un article intitulé ‘One Size Does Not Fit All: Type of Menopause and Hormone Therapy Differentially Influence Brain Health’, car il existe de nombreuses hormonothérapies et de nombreuses ménopauses, et nous devons déterminer celle qui nous convient le mieux. »
Les scientifiques qui étudient les questions relatives aux femmes ne sont pas tous des femmes, et toutes les femmes ne sont pas spécialisées dans cette problématique. Mais avoir plus de filles qui s’orientent vers les disciplines scientifiques et qui sont soutenues tout au long de leur parcours ne peut pas faire de mal. C’est un autre des objectifs de womenmind™. La Dre Galea souligne le fait qu’il y a plus de femmes psychologues et médecins que d’hommes. Pourtant, au rang de doyen, de directeur ou de superviseur, la proportion de femmes diminue constamment au fur et à mesure que l’on monte les échelons, par rapport à celle des hommes.
« Les filles s’intéressent très tôt à tous les domaines scientifiques, dit-elle, mais à mesure que le temps passe et que nous évoluons dans notre carrière, cette disparité commence à se faire sentir. Au niveau universitaire, on voit plus de femmes et de filles en sciences, mais l’écart se creuse au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie, au niveau des études supérieures puis au niveau des professeurs adjoints. »
Dans cette optique, womenmind™ dispose d’un solide programme de mentorat pour toutes les femmes et les scientifiques issus de la diversité de genre, qui a donné des résultats remarquables. Environ 60 % des femmes et des membres de la diversité de genre scientifiques qui travaillent au CAMH ont participé au programme de mentorat, et le taux d’approbation est stupéfiant : toutes les personnes qui ont participé au programme de mentorat ont dit qu’elles le recommanderaient et qu’elles souhaitaient qu’il se poursuive.
Et il se poursuivra, grâce à la passion et à la détermination de jeunes scientifiques et de vétérans comme la Dre Galea. En plus de womenmind™, elle a son propre laboratoire qui étudie l’influence des hormones (principalement les œstrogènes) sur le cerveau. Ses travaux se focalisent sur les troubles psychiatriques liés au stress, tels que la dépression, ainsi que sur la maladie d’Alzheimer. La Dre Galea dirige également le Women’s Health Research Cluster, un réseau de scientifiques qui s’intéressent à l’application des connaissances et dont les activités semblent très amusantes! Le réseau vient de tenir un événement à Toronto appelé « Galentine’s Day : Love your brain » qui visait à sensibiliser les filles, les femmes et toutes les personnes qui s’identifient comme telles à l’effet des changements hormonaux, comme la puberté et la ménopause, sur le cerveau.
Le vécu des femmes et des jeunes filles qui connaissent des changements hormonaux est varié et diversifié. Le chemin qui conduit à l’adolescence, ou à la ménopause, est rarement linéaire. Rien dans la vie n’est linéaire! Même le parcours de la Dre Galea qui l’a amenée à faire son travail actuel (et à rejoindre la communauté d’adeptes de Parks and Rec) a connu de nombreux rebondissements.
“« J’ai commencé par le génie, et j’ai suivi le cours de psychologie 101 avec Susan Lederman, dit-elle. Elle se consacre au domaine de la perception. Elle a déclaré : ‘Je suis la première Canadienne, la première femme et la première psychologue à être invitée à participer à un groupe d’experts de la NASA’. Elle avait été invitée parce que les astronautes se plaignaient de ne rien sentir à travers leurs gants lorsqu’ils effectuaient une sortie dans l’espace. J’ai été séduite. Je me suis dit : « C’est vraiment intéressant, c’est ce que je veux apprendre ». Ce n’est pas du tout ce que j’ai fini par faire, mais le résultat a été que j’ai suivi davantage de cours de psychologie. J’ai fini par étudier le cerveau des femmes et je vais continuer à le faire!
Quelqu’un doit le faire. Et quelqu’un d’autre doit absolument soutenir les personnes qui le font en faisant de cette mission une priorité afin qu’elles puissent continuer à le faire.
Madeline Springle is a second-year Ph.D. student at the University of Calgary, who is winning awards for her ability to mobilize knowledge. Specifically, she is taking the research she has done into one-way video interviews, and using it to help people who might use this knowledge to better prepare for their own job search.
As we close out Psychology Month, we wanted to highlight knowledge translation (explaining the science for a more general audience) and knowledge mobilization (putting new findings into practice such that they help those they were designed to help) because without those, science exists in a vacuum!
Cette semaine, dans le cadre du Mois de la psychologie dont le thème, cette année, est « Les femmes et la science », nous présentons Sophie Bergeron, Ph. D., qui détient une Chaire de recherche du Canada sur les relations intimes et le bien-être sexuel au Département de psychologie de l’Université de Montréal, où elle dirige également le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), l’Équipe SCOUP Sexualité et Couple, et le Laboratoire d’étude de la santé sexuelle. Ses travaux portent sur les déterminants psychosociaux de la santé sexuelle des individus et des couples ainsi que sur le traitement des dysfonctions sexuelles.
There has always been a stereotype that women are “more emotional” than men, and even that they are “too emotional” for leadership roles. Dr. Winny Shen joins Mind Full to discuss the results of her study which suggest that not only is that stereotype untrue, the exact opposite might actually be the case.

Laura Thomas – photo par Erik McRitchie

Photo de B.I.G. au pôle Nord par Edel Kieran
La formation des astronautes pour les vols spatiaux nécessite une équipe importante, y compris des psychologues qui peuvent aider à les préparer à la proximité et à l’isolement pendant de longues périodes. Laura Thomas n’est pas seulement une de ces psychologues, elle a aussi connu des rapprochements et un isolement similaires avec des expéditions exclusivement féminines dans des endroits comme le pôle Nord.
Nous lançons le Mois de la psychologie 2025 : les femmes en sciences avec un regard sur le travail de Laura, ses voyages et les exigences pour établir un record du monde Guinness!
Je suis souvent émerveillé par les personnes que j’interviewe, dont beaucoup sont remarquablement accomplies et font un travail important pour le monde. Parfois, je suis même un peu envieux, car j’aurais aimé participer à certains de leurs projets. J’ai confié cela à Laura Thomas vers la fin de notre réunion Zoom, mais je lui ai dit qu’elle était une exception. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas en admiration devant tout ce qu’elle fait – je le suis assurément. Mais je ne suis pas du tout envieux. J’aurais aimé participer au cocktail le plus septentrional du monde (faites défiler vers le bas pour découvrir la recette des canapés). Mais très peu de choses sur Terre auraient pu me convaincre de me joindre au groupe d’intrépides qui ont skié, campé et bravé les glaces en mouvement du pôle Nord pendant des jours afin de m’y rendre.
Laura Thomas, quant à elle, était impatiente de le faire. En 2016, elle était psychologue-conseil au Royaume-Uni et adepte du tourisme d’aventure. Elle a commencé à s’intéresser aux environnements extrêmes et a assisté à une conférence de l’exploratrice britannique Felicity Aston, MBE. Elles ont bavardé et, peu de temps après, Laura l’a rejointe pour effectuer un voyage de trekking en Éthiopie. Quelques années plus tard, elle se dirigeait vers le pôle Nord, vivait à Calgary et donnait une toute nouvelle orientation à sa carrière.
Faire un trek jusqu’au pôle Nord apparaît comme un long périple... parce que c’est le cas. Pensez-y : la distance qui sépare le pôle magnétique nord actuel de la base militaire d’Alert, au Nunavut – le lieu habité le plus au nord de la planète – est d’un peu plus de 800 km. La distance entre la Terre et la Station spatiale internationale n’est que de 400 km.
Vous arrive-t-il de regarder la SSI lorsqu’elle passe au-dessus de votre tête et de vous demander ce que font les astronautes? Un peu de recherche, on le suppose, et beaucoup de cuisine lyophilisée? Une forme d’exercice qui ressemble à la scène de 2001, L’Odyssée de l’espace? En tant que Canadiens, nous savons que certains d’entre eux répètent des airs de David Bowie à la guitare, car il est impossible que Chris Hadfield ait pu accomplir cette performance sans s’exercer.
Laura sait ce que font les astronautes. Ou, du moins, ce qu’ils pourraient faire. Et comment ils peuvent le faire, compte tenu des longs mois d’isolement, de l’intimité imposée par la promiscuité et des changements physiques que l’on subit dans ces conditions. Laura étudie les gens, et leur comportement, dans un isolement extrême.
Laura est la cofondatrice de PARSEC Space, une nouvelle entreprise qui a pour but de former les exploitants d’engins spatiaux commerciaux. Elle travaille aux côtés de scientifiques, de pilotes et d’ingénieurs de la NASA, de l’ESA et de l’armée pour sélectionner, former et préparer la prochaine génération d’astronautes. Il ne s’agira pas nécessairement de voyageurs de l’espace qui rejoindront l’ISS. Il existe de nombreux autres projets d’exploration spatiale.
« Plutôt que sur le tourisme spatial en tant que tel, nous nous concentrons principalement sur la recherche et les spécialistes de charge utile, m’explique Laura. Des personnes qui vont proposer leur expertise dans le cadre de divers projets et recherches menés dans l’espace. Le problème avec les astronautes des agences gouvernementales, c’est qu’il faut énormément de temps et d’argent pour les former. Et ce sont des généralistes. Ils ne sont pas nécessairement des experts des types de technologies qu’ils testent ou des expériences qu’ils mènent dans l’espace. Dans le futur, il y aura beaucoup plus de recherche spatiale. »
Les entreprises pharmaceutiques, par exemple, aimeraient tester de nouveaux médicaments dans l’espace. Les éléments réagissent différemment dans l’espace en raison des conditions qui y règnent. En micropesanteur, les bactéries se développent différemment. L’observation de la croissance des organismes en l’absence de gravité pourrait être très utile. Les entreprises manufacturières ont également tendance à vouloir tester leurs produits et leurs systèmes dans l’espace. La NASA envisage de construire une base permanente sur la lune, qui comporterait sans aucun doute un important centre de recherche.
Lorsque cela se produira, PARSEC sera là pour former les astronautes qui s’y rendront, et Laura évaluera la forme mentale des participants et préparera ceux-ci à affronter les rigueurs d’un voyage dans l’espace.
« Les qualités recherchées chez les astronautes ont quelque peu évolué au fil des ans. C’est ce que nous appelons le “new Right stuff”, les nouvelles qualités. Auparavant, les missions étaient relativement courtes; il fallait donc des personnes possédant les compétences techniques nécessaires pour mener à bien le travail à accomplir. Mais si l’on veut que les gens survivent et se développent dans l’espace à long terme, avec un tel niveau d’isolement et de confinement, il faut se demander comment ils font pour s’adapter. Il faut comprendre leur résilience innée, leur capacité à faire face à différents types d’agents stressants, leur capacité à s’entendre avec les autres, leur capacité à fonctionner en équipe. Le côté “plus doux”, les traits de personnalité, deviennent beaucoup plus importants. »
Laura ne peut pas aller dans l’espace pour observer les gens et les guider dans cet environnement précis, du moins pas encore, donc elle devra se contenter d’environnements analogues sur Terre (ceux qui présentent le plus de similitudes avec les conditions qui règnent dans l’espace). Des systèmes de grottes souterraines, des jungles et des montagnes isolées et, bien sûr, les régions polaires. Laura, par exemple, était la psychologue de l’équipage lors d’une mission en conditions analogues, dans le désert de Mojave, où les participantes étaient isolées pendant 10 jours.
« C’était vraiment intéressant, nous étions dans un habitat qui était en fait une série de capsules. Huit femmes seules, isolées dans le désert de Mojave et vivant comme des astronautes. Nous avions une médecin de vol, une ingénieure mécanicienne, une commandante d’équipage. Notre routine quotidienne comportait des exercices et des activités que nous aurions à faire en tant qu’astronautes. »
Sur place, Laura a observé et aidé ses coéquipières afin de s’assurer que tout le monde gérait bien la situation, en déterminant les meilleures interventions possibles et adaptations à apporter dans ce contexte. Il s’agissait du premier projet en conditions analogues à être entièrement féminin, ce qui a attiré des scientifiques du monde entier. Les membres de l’équipage venaient de Jordanie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et d’ailleurs. Le projet a permis à Laura d’approfondir ses recherches sur la salutogenèse dans des environnements analogues. La salutogenèse est une approche qui met l’accent sur les facteurs qui favorisent la santé et le bien-être, et produisent des effets positifs sur les individus.
De nombreuses personnes vivent des expériences très positives dans ce type d’environnement. Souvent, les astronautes qui vont dans l’espace peuvent regarder la Terre à travers les fenêtres de la coupole d’observation, ce qui peut créer une profonde connexion avec le transcendant. Ils reviennent sur Terre avec une vision différente de la beauté et de la fragilité de la planète et éprouvent une plus grande compassion pour l’humanité. C’est ce qu’on appelle « l’effet de vue d’ensemble », qui dure bien plus longtemps que le moment où l’astronaute regarde par le hublot de son vaisseau spatial. Des états extrêmes d’émerveillement et de connexion au transcendant ont également été observés dans le cadre de missions en conditions analogues menées sur terre.
« De loin, on peut voir que la Terre est composée de masses terrestres et d’eau. On ne peut pas dire où commence la frontière d’un pays et où s’arrête celle d’un autre. Cela nous convainc que nous participons tous à la même chose. »
Des études ont également fait état d’une plus grande confiance en sa force personnelle, d’une meilleure résistance au stress et d’une amélioration de la santé physique à long terme. Parfois, plus la situation est stressante pour les participants, plus la transformation de leur psychisme est profonde. Laura explique que c’est comme s’il y avait un seuil de stress à atteindre pour que les effets positifs se fassent sentir.
Il est difficile d’imaginer une expédition plus stressante qu’une expédition au pôle Nord. En 2024, Laura et ses camarades d’exploration, toutes des femmes, sont parties prélever des échantillons de glace, de neige et d’eau à l’emplacement du pôle magnétique nord de 1996. L’expédition B.I.G. (Before It’s Gone) était prévue depuis 2020, mais les retards causés par la COVID et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont obligé certains membres de l’équipe à se retirer et Laura a pu prendre la relève.
L’équipe, dirigée par l’exploratrice britannique Felicity Aston, MBE, s’est exercée au ski de fond en Norvège et en Islande pendant des semaines. Les coéquipières d’expédition se sont ensuite rendues en avion à Iqaluit, puis à Resolute Bay et enfin à Isachsen, une station météorologique abandonnée datant des années 1970, qui était la piste d’atterrissage la plus proche du pôle magnétique. Chacun des vols reliant ces destinations a été retardé par des conditions météorologiques défavorables, ce qui a écourté la durée du voyage. Chaussées de skis, tirant leur équipement dans leurs traîneaux, elles se sont dirigées vers le pôle.
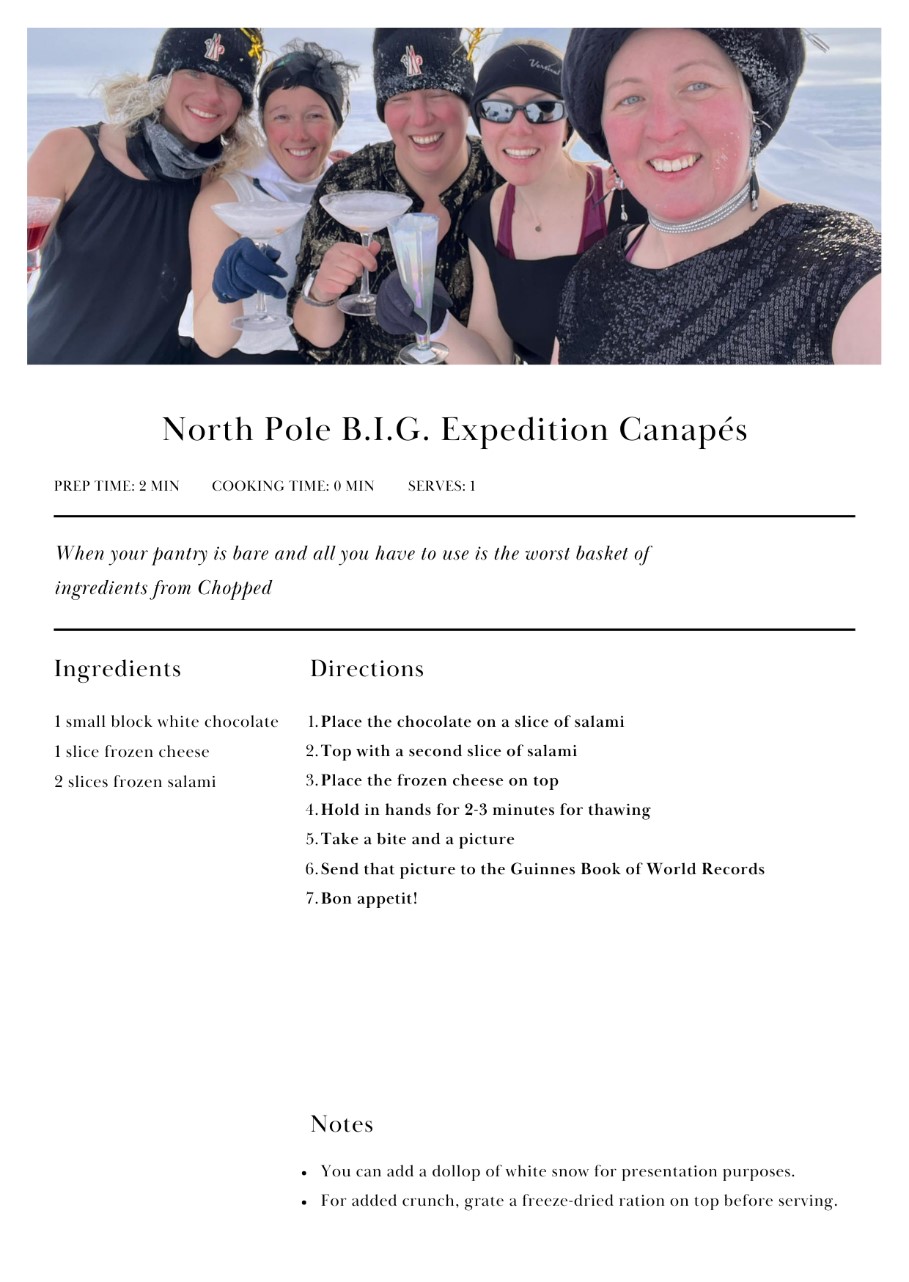
Il y a eu d’autres retards en cours de route. Le mauvais temps les a bloquées dans leurs tentes pendant près de trois jours. Bien que physiquement épuisées et gravement déshydratées, elles ont dû continuer à avancer pour éviter l’arrivée d’une tempête. L’équipe était toujours à l’affût, à la fois de la glace en mouvement et des ours blancs.
« C’est toute une expérience, mais c’est difficile, me confie Laura. Tout le monde vous dira que ces environnements sont difficiles. Il faut avoir le bon équipement, mais même là, c’est dur. En fait, vous êtes dans un endroit où tout s’acharne à vous tuer. Le froid, la glace de mer, et même les ours blancs. Lorsque nous sommes arrivés à Resolute Bay, les habitants nous ont dit que c’était la saison des amours des ours blancs et que nous allions certainement en rencontrer. »
Sur le chemin, l’équipe a recueilli des données. Celles-ci ont révélé que toutes sortes de microplastiques se retrouvent dans la glace du pôle Nord, de même que des métaux lourds comme le plomb et, surtout, du carbone noir. Le carbone noir est généré par les voitures, les installations industrielles et les incendies de forêt. Sa présence dans la glace arctique est assez préoccupante : les petites particules noires qui le composent font fondre la glace plus rapidement qu’elle ne le fait déjà, ce qui accélère les effets des changements climatiques.
Laura a également recueilli des données pour son projet sur la salutogenèse, lui permettant d’en apprendre davantage sur la façon dont les gens réagissent lorsqu’ils sont poussés à de tels extrêmes. Malheureusement, elles n’ont pas réussi à atteindre le pôle magnétique nord, en raison des retards dus aux conditions météorologiques et de la durée écourtée du voyage. Mais elles se sont arrêtées pour établir un record Guinness!
Le processus entourant les records du monde, du moins celui établi par Guinness, est assez amusant. Il faut prendre contact directement avec l’organisation des records Guinness à l’avance et lui faire part de son intention de battre un précédent record du monde ou d’en établir un nouveau (Salut, Guinness, c’est moi! Je prévois organiser le plus grand atelier de fabrication de peluches du monde, est-ce que mon projet pourrait être pris en considération?) Ensuite, il y a des critères précis à remplir pour pouvoir revendiquer ce record.
Et c’est ainsi que l’équipe de l’expédition B.I.G., en plus de son équipement scientifique et de son équipement de survie, a transporté jusqu’au pôle Nord des verres à cocktail, des robes de cocktail et un appareil pour faire jouer de la musique. L’un des commanditaires du voyage était une société de boissons alcoolisées (Axia Spirit), et l’événement était un clin d’œil à cette société. Mais selon l’organisation des records Guinness, il n’y a pas de cocktail sans musique, table, tenue de cocktail et canapés.
Son esprit d’aventure, sa quête de connaissances et d’expériences et sa détermination ont fait de Laura Thomas la candidate idéale pour une expédition à ski au pôle Nord. Mon affection pour le confort, ma condition physique moyenne et mon penchant pour la variété en matière culinaire ont fait de moi la personne idéale pour rester à la maison et écrire sur son expédition. Et c’est amusant d’écrire sur une « psychologue de l’espace ». Il y a quelques années, il n’y en avait peut-être qu’une poignée sur Terre. Aujourd’hui, alors que l’espace s’ouvre, il est possible de faire appel à un large éventail d’experts pour garantir la sécurité et l’efficacité de ces nouvelles missions spatiales.
La formation de psychologue de Laura et sa passion pour la recherche lui ont été très utiles sur Terre. Elle travaille sur des projets qui mettent en lumière certains des problèmes les plus graves du monde. Et ce sont ces qualités et ces qualifications qui serviront la prochaine génération d’explorateurs. Ceux qui se dirigeront vers les régions les plus inexplorées de notre monde – celles qui se trouvent au-delà de notre monde. Ils pourront réussir grâce à une équipe d’experts dévoués qui les aideront dans leur travail, et à Laura qui les aidera dans leur tête. Qui de mieux qu’une personne possédant ce type d’expérience pour accomplir d’aussi grandes choses?

Jessica Strong
Nous prévoyons tous vieillir. Alors pourquoi si peu d’entre nous sont attirés par le fait de travailler avec des personnes âgées? La Dre Jessica Strong est spécialiste en gérontopsychologie au département de psychologie de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle nous parle de la réserve cognitive, lutte contre l’âgisme et explique comment sa passion pour la musique l’a amenée à poursuivre son parcours professionnel actuel.
« You see the hood's been good to me, ever since I was a lowercase g. But now I’m a Big G. »
Traduction libre : « Tu vois, le hood a été bon pour moi, quand j’étais un “g minuscule”. Mais maintenant, je suis un “g majuscule”, je suis Big. »
- Montell Jordan
Dans son énorme succès de 1995, This Is How We Do It, Montell Jordan fait la distinction entre un « g minuscule » et un « g majuscule ». Dans son cas, il fait référence au fait qu’étant enfant, il a compris et incarné l’état de « gangster », avant de devenir adulte et d’accéder au statut de gangster professionnel respectable en lançant un premier titre d’une popularité phénoménale.
Tout comme pour Montell Jordan, c’est la musique qui a conduit la Dre Jessica Strong à sa carrière, une carrière où elle fait elle aussi la distinction entre les « g minuscules » et les « g majuscules ». Les « g majuscules » sont les spécialités des experts : gériatrie, gérontologie et gérontopsychologie, la spécialité de la Dre Strong. Le « g minuscule » fait référence aux compétences mineures que tout le monde doit posséder. Les travailleurs sociaux, les médecins de famille, les préposées aux bénéficiaires dans les résidences pour personnes âgées, les aidants naturels ou les travailleuses du secteur de la vente au détail. Tous ceux et celles qui ont affaire à une population âgée dans leur vie quotidienne. La Dre Strong confie :
« J’ai beaucoup d’étudiants qui ne sont pas nécessairement intéressés par la gérotonpsychologie (un “g majuscule”), mais nous travaillons au développement de cette main-d’œuvre “g minuscule”, qui ne travaille pas exclusivement avec des personnes âgées. Il peut s’agir d’un psychologue généraliste, mais qui possède les compétences nécessaires pour travailler avec les personnes âgées. Ces personnes comprennent les enjeux relatifs aux cohortes et les différences générationnelles, et elles savent comment modifier une intervention ou dépister un trouble cognitif léger.
Je dis à tous nos étudiants en psychologie clinique : “Vous voulez travailler auprès d’une clientèle pédiatrique, super! Combien de grands-parents élèvent des enfants de nos jours? Pour votre client pédiatrique, si vous remarquez quelque chose d’anormal chez son grand-parent, vous allez vouloir déterminer s’il s’agit d’anxiété et de stress parce qu’il élève un enfant de neuf ans, ou s’il peut s’agir d’un trouble cognitif léger. Et comment déterminer cela d’une manière qui serve les intérêts de votre patient pédiatrique?” »
La Dre Strong est professeure adjointe au Département de psychologie de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et psychologue clinicienne agréée, spécialisée en gérotonpsychologie. La gérotonpsychologie est une sous-section de la gérontologie, soit l’étude générale du vieillissement, de la durée de vie, du développement et de l’identité à un âge avancé. C’est une discipline qui se concentre sur les relations, la santé mentale, la cognition et, plus généralement, la psychologie du vieillissement.
C’est la musique qui l’a conduite vers cette carrière, puisqu’elle a commencé à jouer du piano à l’âge de 9 ans et s’est rapidement mise à jouer d’autres instruments, notamment du saxophone alto dans la fanfare de l’école secondaire. C’est durant cette période qu’elle a commencé à envisager une carrière de musicothérapeute. Mais il s’agit d’une profession assez spécialisée, et Jessica est une personne qui aime garder autant d’options ouvertes que possible.
Au cours de sa dernière année de secondaire, à l’époque où nous écoutions tous ces paroles : « southcentral does it like nobody does », elle s’est renseignée sur le programme de musicothérapie de l’université locale. Elle s’est vite rendu compte qu’il y avait un moyen de s’engager dans cette voie tout en gardant d’autres portes ouvertes, et elle a fini par obtenir simultanément deux diplômes de premier cycle, l’un en interprétation musicale et l’autre en psychologie. L’idée était qu’à partir de là, elle pourrait obtenir une maîtrise en musicothérapie si elle choisissait cette voie.
Mais la recherche en psychologie attirait vraiment Jessica, qui a commencé à s’intéresser de plus près aux mécanismes qui expliquent pourquoi la musique touche les gens, plutôt que de l’utiliser comme un simple outil. Elle avait déjà travaillé avec des personnes âgées dans un laboratoire d’ergothérapie à l’Université Washington à St. Louis. Elle s’est ensuite installée en Allemagne, où elle a travaillé dans un établissement de santé mentale pour personnes âgées, le Central Institute for Mental Health, à Mannheim. Elle était devenue une « g minuscule ».
Elle n’a pas tardé à se rendre compte que ce qu’elle voulait vraiment faire, c’était travailler avec les personnes âgées. Elle n’avait jamais entendu le terme « gérotonpsychologie » auparavant, mais elle a eu la chance de participer à un programme à l’Université de Louisville, dans le Kentucky, et a été acceptée dans le programme de psychologie clinique, travaillant sous le mentorat et la supervision de deux gérotonpsychologues. Elle a obtenu son doctorat, est devenue une « g majuscule » et affirme qu’elle n’a jamais regardé en arrière.
« L’un des aspects les plus gratifiants du travail avec les personnes âgées est qu’elles font partie des êtres humains les plus complexes au monde. Il s’agit d’une population tellement hétérogène parce qu’elle présente toutes les différences démographiques que nous avons tous (genre, origine ethnique, etc.), mais aussi toutes les expériences vécues et les changements qui en découlent. Vieillissement physiologique, émotionnel et cognitif. C’est vraiment stimulant et passionnant pour moi sur le plan intellectuel parce que ce sont des personnes beaucoup plus complexes que les personnes des autres groupes avec lesquels j’ai travaillé et qui n’ont pas fait autant de choses. »
La Dre Strong a par la suite travaillé à Boston dans un centre de réadaptation de l’administration de la santé des anciens combattants. Elle a étudié comment l’intégration de la musique dans un groupe de santé mentale pouvait déstigmatiser le sujet de la santé mentale pour des anciens combattants masculins âgés. Les réactions ont été très positives : les anciens combattants avaient l’impression que ce groupe était différent des autres auxquels ils avaient déjà participé et que l’utilisation de la musique leur permettait de parler plus facilement de sujets qu’en tant qu’hommes et anciens combattants, ils avaient été conditionnés à éviter. La musique leur a permis de ressentir les choses sans avoir à trouver les mots.
L’une des séances de la Dre Strong avec ce groupe prévoyait le recours à une technique de musicothérapie. Ils commençaient la séance de groupe en lisant les paroles d’une chanson à voix haute, comme un poème. Ils parlaient des images que cela évoquait et de ce qu’ils pensaient que l’artiste essayait de transmettre. Ensuite, ils écoutaient la chanson pour voir si le sentiment était différent de celui qu’ils avaient ressenti en lisant les paroles. L’ajout d’une musique a-t-elle atténué le message ou y a-t-elle ajouté quelque chose? Les anciens combattants du groupe, des hommes qui, en raison des conditionnements liés à leur genre et au service militaire, éprouvaient une réticence à s’exprimer de manière vulnérable, sont allés très profondément en eux lors de la dissection de la musique.
Selon la Dre Strong, la chanson What A Wonderful World était l’une des préférées des groupes. Compte tenu de l’âge des participants (certains anciens combattants du Vietnam, d’autres de la guerre de Corée et d’autres encore ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale), il est logique qu’une chanson des années 60 ait eu autant d’écho. La musique est souvent associée à la mémoire et à la nostalgie, en particulier la musique que nous avons entendue lors d’événements marquants de notre vie, à l’adolescence et au début de l’âge adulte. Par exemple une chanson de mariage, une chanson qui jouait durant la fin de vos études ou une chanson que vous avez entendue lors de votre départ pour la guerre.
Lorsque des séances similaires seront organisées dans quarante ans, il y a fort à parier qu’une psychologue comme la Dre Strong intégrera une musique bien différente dans ce type de thérapie de groupe. Ils discuteront de ce que Montell Jordan essaie de faire comprendre lorsqu’il suggère de « flip the track, bring the old school back » (réarranger les pistes, ramener la vieille école). Les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence qui font participer les gens en utilisant une musique chantée ressembleront à l’un de ces mashups de Pitch Perfect. « I reach for my 40 and I turn it up / designated driver take the keys to my truck ».
La musique ne fait pas que ramener des souvenirs, elle façonne notre cerveau au fur et à mesure que nous vieillissons. La Dre Strong s’intéresse plus particulièrement au cerveau des musiciens et à l’effet d’une vie passée à jouer de la musique sur le processus de vieillissement. Elle parle de ce que l’on appelle la réserve cognitive. Il s’agit de l’idée selon laquelle tout ce que nous faisons dans notre vie s’accumule et devient une réserve dans notre cerveau. La Dre Strong décrit cela comme une batterie que l’on peut charger. Le fait d’avoir reçu une éducation formelle, de parler une deuxième ou une troisième langue, d’avoir des relations sociales solides, voilà des facteurs qui chargent notre batterie et nous rendent plus résistants aux troubles cognitifs plus tard dans la vie.
« Si une personne dispose d’une réserve cognitive très élevée, l’image de son cerveau obtenue par tomodensitométrie peut sembler horrible, montrant la présence de maladies ou de lésions vasculaires. Mais elle peut encore fonctionner correctement parce qu’elle a accumulé cette réserve au fil du temps, qui permet à son cerveau de contourner ces voies endommagées. Une personne dont la réserve cognitive est plus faible peut avoir un cerveau qui semble relativement en bon état sur une image par tomodensitométrie, mais elle peut montrer des signes de démence légère ou modérée dans son fonctionnement. »
D’après les études de la Dre Strong et des études similaires menées par ses pairs, les musiciens ont tendance à mieux réussir dans certains domaines en vieillissant, notamment les fonctions exécutives et le langage, mais pas dans tous les domaines. La mémoire est l’un des domaines dans lesquels ils n’ont pas tendance à faire mieux que les non-musiciens. Certains ont suggéré que les tests de mémoire étaient imparfaits, ce qui pourrait expliquer l’absence de corrélation entre la mémoire et l’aspect musical. Lorsque la Dre Strong prendra un congé sabbatique l’année prochaine, c’est l’une des choses qu’elle espère apprendre à partir d’un ensemble de données longitudinales qu’elle a recueillies. Mais elle a déjà beaucoup appris de ses recherches jusqu’à présent.
« J’ai comparé les personnes qui ont cessé de jouer à celles qui ont continué à jouer. Il s’agit d’une étude intéressante, dans laquelle j’ai constaté que les personnes qui ont arrêté de jouer perdaient les avantages qu’elles avaient dans certaines des capacités plus fluides, comme les fonctions exécutives, mais conservaient les avantages qu’elles avaient dans les capacités cristallisées, comme le langage. Les personnes qui ont continué à jouer conservent les deux avantages. »
Travailler avec des populations âgées comporte certains défis, en particulier celui de définir ce que sont ces populations. La limite générale (arbitraire, selon la Dre Strong) à partir de laquelle les gérontopsychologues et les gérontologues commencent à considérer les personnes comme « âgées » est l’âge de 65 ans. Mais ils travaillent également avec des personnes beaucoup plus âgées que cela.
« Ce qui devient compliqué lorsqu’on utilise 65 ans comme seuil arbitraire, c’est que l’on y inclut des personnes de 80, 90, voire plus de 100 ans. Des personnes de plus de 100 ans participent à des recherches, et vous vous retrouvez face à un casse-tête scientifique très intéressant, à savoir la présence de personnes qui ont une différence d’âge de 30 à 40 ans dans un échantillon scientifique. Ce qui est absurde – on ne mettrait jamais des enfants de 10 ans et des adultes de 50 ans dans le même échantillon, et c’est un peu ce qui se produit ici.
C’est donc un problème lorsque nous travaillons avec des adultes âgés, et une grande partie de la gérontologie et de la gérotonpsychologie divise ces groupes comme ceci : “jeunes vieux” (65-74 ans), “vieux plus âgés” (75-84 ans) et “les plus âgés” (85 ans et plus), tentant ainsi d’obtenir une perspective un peu plus nuancée. Ces personnes ont grandi de manières complètement différentes et font partie de cohortes complètement différentes. On ne peut ni ne doit s’attendre à ce qu’une personne de 65 ans se trouve au même stade de sa vie qu’une personne de 95 ans.
Il est beaucoup plus facile d’avoir accès à des participants à la recherche qui font partie du groupe des jeunes vieux, et ceux-ci ont donc tendance à être surreprésentés dans la recherche. Il est beaucoup plus difficile d’obtenir un échantillon représentatif des groupes plus âgés. »
Un autre défi est celui de l’âgisme. C’est un sujet qui préoccupe beaucoup la Dre Strong, et elle s’enflamme lorsqu’elle parle de la façon dont nous négligeons notre population âgée. L’âge est un facteur de diversité souvent négligé, et les gérotonpsychologues rappellent constamment à leurs organisations, et à tous ceux qui veulent bien les écouter, que l’âge doit être considéré et inclus comme un facteur de diversité. L’absence de valorisation des personnes âgées, les attitudes négatives que nous avons à l’égard de la vieillesse, du fait de paraître vieux ou d’agir comme une personne âgée, tout cela crée des torts dans le monde réel. Selon la Dre Strong, ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles nous ne prenons pas de mesures pour réformer le système de soins de longue durée du Canada.
« Nous savons ce qui fonctionne dans les soins de longue durée, il s’agit simplement de le mettre en pratique. L’intention de départ n’était pas nécessairement l’existence de ces établissements de type médical. Les gens ne veulent pas aller y vivre parce qu’ils savent que c’est le début de la fin, et ils pensent ainsi en raison du fonctionnement de ces établissements, qui manquent de personnel et sont négligés. C’est en Scandinavie que l’on trouve certains des modèles les plus étonnants de soins de longue durée et de soins aux personnes atteintes de démence. Il existe des “villages de la démence” fermés où les personnes vivent dans leur appartement, mais peuvent aller faire leurs courses et se promener dans le parc. La personne qui tond la pelouse est une infirmière spécialisée dans la démence, tout comme le barista du café. Mais beaucoup d’entre nous ne considèrent pas les personnes âgées, et en particulier les personnes âgées atteintes de démence, comme suffisamment importantes pour qu’on s’en préoccupe. »
Nous allons tous vieillir. Comme le dit la Dre Strong à ses étudiants, « si on ne vieillit pas, c’est qu’on est mort – c’est un privilège de vieillir ». Alors pourquoi est-il difficile de recruter des jeunes, et des étudiants en particulier, pour travailler avec des populations âgées? L’âgisme, les attitudes négatives et l’angoisse de la mort sont des facteurs importants. Il en va de même pour l’exposition au vieillissement. Les jeunes qui ont grandi auprès de personnes âgées, ou dont les enseignants ou les parents travaillent avec des populations âgées, ont tendance à être beaucoup plus réceptifs.
« Je dois mon intérêt pour le vieillissement à ma grand-tante Lila. Ma mère était sa principale aidante naturelle lorsque j’étais enfant, elle passait donc beaucoup de temps chez nous et j’ai passé beaucoup de temps avec elle. Je la trouvais fascinante. Elle portait une perruque et je l’ai vue sans perruque, ce qui était fascinant à neuf ans. Elle me racontait qu’elle avait un rat domestique lorsqu’elle avait mon âge et c’était incroyable de penser qu’elle avait déjà eu mon âge. J’ai eu de bonnes relations avec mes grands-mères et j’ai souvent eu des adultes âgés dans ma vie durant mon enfance. »
La gérotonpsychologie est un domaine relativement nouveau, et passionnant. Il reste encore énormément de recherches à mener et de nombreuses occasions de travailler avec des personnes dont les expériences de vie, la sagesse et les récits sont à la fois fascinants et instructifs. Ces gens sont les témoins vivants d’une époque que nous n’avons pas connue et ont vécu des vies que nous ne pouvons pas imaginer. Selon la Dre Strong, il est impossible de surestimer à quel point ce travail peut être gratifiant.
« Il s’agit d’un groupe qui a été marginalisé, qui ne se fait pas beaucoup entendre, et lorsqu’on prend le temps d’interagir avec eux, ils sont tellement reconnaissants. Ils ont tellement de sagesse et d’expérience que je ne peux m’empêcher d’apprendre d’eux. Ils ont vécu à des époques et fait des choses auxquelles je n’aurai jamais accès.
La communauté de la gérotonpsychologie et de la gérontologie est très accueillante, parce que nous voulons que les gens travaillent avec les personnes âgées. Et parce que les personnes qui finissent par travailler dans ce domaine sont par nature chaleureuses et accueillantes. C’est tout simplement une merveilleuse famille professionnelle. »
Nous avons besoin des experts des spécialités en « g majuscule » pour en apprendre davantage sur le vieillissement et sur la création d’une société accueillante, prospère et saine pour les personnes qui prennent de l’âge. Nous avons également besoin que tout le monde développe des compétences de type « g minuscule », afin de faire partie de la solution. À mesure que chacun d’entre nous vieillira, nous voudrons que le monde qui nous entoure change afin que nous puissions continuer à construire une communauté et à vivre une vie pleine de sens et marquante, aussi longtemps que nous serons là. C’est comme ça que ça se passe (dans le hood).
Documents de recherche :
Mental health and music group development and evaluation (with manual published in the appendices)
Deux articles sur la cognition chez les musiciens âgés
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262622000410
- https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0305735618785020
Et une étude récente sur les attitudes envers les aînés
Crise climatique et adaptation : Facteurs, effets et rôle de la psychologie
Le thème du Mois de la psychologie de 2024 est la crise climatique. Comment le comportement humain influence-t-il les changements climatiques et comment pouvons-nous aborder la question de ce point de vue? Quels sont les effets des changements climatiques sur la santé mentale et comment pouvons-nous les aborder? Les psychologues ont un rôle à jouer dans toutes les phases de la réponse collective à la crise qui nous frappe. Nous mettrons en lumière ce que beaucoup d’entre eux font et ce que nous pouvons tous faire pour atténuer les dégâts de cette catastrophe mondiale.
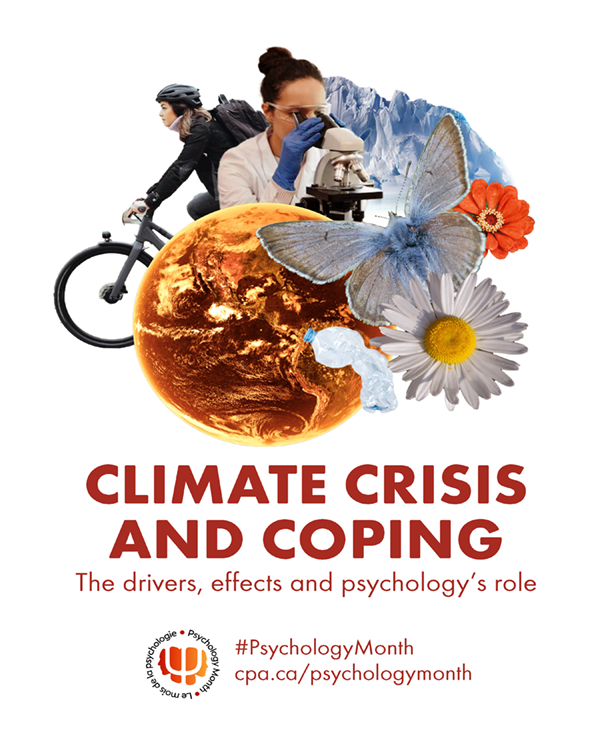
Le Mois de la psychologie 2024 portait sur la crise climatique et le rôle de la psychologie par rapport à celle-ci. Notre spécialiste des communications revient sur la campagne, les messages clés et les prochains pas que nous pouvons tous faire pour lutter contre la plus grande menace de notre époque.
Réflexions sur le Mois de la psychologie, les changements climatiques et la voie à suivre
Je m’appelle Eric Bollman, je suis le spécialiste des communications à la Société canadienne de psychologie (SCP). Je me présente ici parce que je n’ai pas l’habitude d’écrire à partir de mon propre point de vue; j’écris généralement à propos des autres ou de leur travail. J’ai pensé écrire ce dernier article du Mois de la psychologie d’un point de vue personnel, car j’ai beaucoup appris au cours de ce mois et je tenais à en parler, mais je tiens également à préciser qu’il s’agit d’opinions et de perspectives personnelles qui sont le fruit de mes réflexions. Dans notre courriel hebdomadaire La psychologie dans les médias que j’envoie aux membres, cet article figurerait dans la section Blogues et opinions.
J’ai commencé à écrire cet article avec l’intention explicite de trouver le juste équilibre qu’exige l’action contre les changements climatiques, c’est-à-dire reconnaître qu’il s’agit d’une crise qui peut terrifier beaucoup d’entre nous, si ce n’est la plupart, mais que formuler les faits de manière positive est la seule façon d’inciter les gens à agir. En relisant ce que j’avais écrit initialement, je me suis rendu compte que malgré mon intention de départ, je n’étais absolument pas parvenu à atteindre cet équilibre. En fait, j’avais passé tellement de temps plongé dans le sujet des changements climatiques et de la désinformation en ligne que je n’avais pas remarqué la négativité qui s’était infiltrée dans mes pensées et qui imprégnait presque chaque phrase que j’avais écrite, jusqu’à ce qu’une pause de quelques jours amène un certain recul.
Je pense que c’est un phénomène qui affecte bon nombre d’entre nous, alors j’espère que les anecdotes personnelles que je raconte seront utiles et qu’elles serviront peut-être même de mise en garde! Ce qui suit est ce que j’ai retenu de la multitude de conversations que j’ai eues ce mois-ci. Je vous présente trois domaines dans lesquels je pense que la psychologie peut être la plus utile, et sur lesquels nous pouvons tous (psychologues et non-psychologues) concentrer nos efforts et notre attention.
Orienter la conversation (et présenter les solutions) de la manière la plus positive possible
Dès le départ, il m’est apparu évident qu’il serait difficile de présenter de manière positive le thème du Mois de la psychologie (soit la crise climatique). À tel point que lorsque j’ai essayé, j’ai d’abord échoué. Il s’agit de la menace existentielle la plus importante à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd’hui et, dans les années à venir, la situation deviendra de plus en plus chaotique et catastrophique. C’est objectivement terrifiant. Plus nous parlons de la crise climatique et des situations que nous vivons actuellement et de celles qui nous attendent, plus notre frayeur grandit (à juste titre).
Cela dit, il n’est généralement pas utile d’aborder la question des changements climatiques sous l’angle du catastrophisme. Cela génère de l’anxiété et un fatalisme et dissuade les gens de chercher des solutions. Imaginez que vous êtes un enfant et que vous apprenez l’existence de la fonte des glaces polaires, de la disparition d’espèces, de l’élévation du niveau de la mer – et que vous essayez de vous représenter un avenir heureux. Comme le dit Paul De Luca, étudiant au Prime Family Lab de l’Université York :
« En nous inspirant des principes de la psychologie positive et en nous concentrant sur le bien-être subjectif, nous pouvons potentiellement intégrer notre relation à l’environnement pour renforcer ou favoriser des résultats positifs en matière de santé mentale chez les enfants et les adolescents qui, à mon avis, sont probablement les plus touchés par l’anxiété parce que c’est leur avenir qui est en jeu. » [traduction]
Paul a raison : le fait de se concentrer sur le bien-être subjectif peut à la fois soulager la détresse et l’anxiété et renforcer les comportements pro-environnementaux. Dans sa conférence TED et dans la conversation qu’elle a eue avec moi dans le balado de la SCP Mind Full, la Dre Jiaying Zhao insiste beaucoup sur ce point, et je pense qu’elle répétera ces arguments lors de sa prochaine allocution en plénière au congrès de la SCP en juin prochain. Il n’y a aucune raison pour que les comportements pro-environnementaux ne nous rendent pas heureux. Lorsque les gens sont dehors et font du vélo, cela améliore leur santé, et les rend donc plus heureux. Pourquoi ne pas intégrer cela dans notre vie quotidienne? Pour beaucoup de gens (moi y compris), sortir prendre l’air en été et s’occuper d’un jardin peut procurer un grand sentiment de paix (et une belle récolte de navets).
Chaque personne dans le monde contribue d’une manière ou d’une autre aux changements climatiques. Il n’y a aucun moyen d’éviter cette réalité. Chaque fois que je prends ma voiture, j’y pense. Lorsque je dois décider entre faire tourner le lave-vaisselle ou laver les casseroles à la main, je calcule inconsciemment l’impact de l’un par rapport à l’autre. Si l’on obsède sur l’impact de chaque geste quotidien, on peut finir par se sentir submergé, comme ce fut le cas pour moi à certains moments. Lorsque je pose des gestes concrets que je sais bénéfiques (entretenir mon jardin intérieur, planifier mes repas de manière à utiliser tous les légumes du frigo), je me sors d’un état d’esprit négatif tout en améliorant la santé de ma famille.
Ces choix que nous devons faire sont, je pense, le mieux résumés par la magnifique série télé The Good Place, où Ted Danson dirige (à défaut d’un meilleur mot) l’enfer. Les gens s’efforcent d’être bons, et lorsqu’ils meurent, ils espèrent avoir été assez bons pour entrer au paradis. Mais les complexités de la vie moderne ont fait en sorte qu’il est littéralement impossible pour quiconque d’atteindre un niveau suffisant de « bonté », et personne n’a été admis au paradis depuis des siècles. Le personnage de Ted Danson résume la situation en ces termes :
« Le simple fait d’acheter une tomate à l’épicerie signifie que vous soutenez sans le vouloir les pesticides toxiques, l’exploitation de la main-d’œuvre, et que vous contribuez au réchauffement climatique. Les humains pensent qu’ils font un seul choix, mais ils en font en réalité des dizaines dont ils n’ont même pas conscience. » [traduction]
Il y a de bonnes nouvelles dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a dix ans, une partie du débat se résumait à dire : soit vous adoptez les énergies renouvelables, mais vous sacrifiez l’économie et le PIB, soit vous ignorez les énergies renouvelables afin de permettre la croissance économique. Aujourd’hui, ces concepts ont été dissociés et les énergies renouvelables sont un moteur économique à part entière. Les thermopompes, les panneaux solaires et les véhicules électriques sont de moins en moins chers et de plus en plus accessibles. Les grands pays et les entreprises se sont engagés à réduire fortement les émissions de méthane, l’un des moyens les plus efficaces de limiter le réchauffement de la planète dans les années à venir. Il y a lieu d’être optimiste!
Cela n’a pas beaucoup de sens de s’astreindre à une norme arbitraire. Nous ne pouvons pas nous priver de tout plaisir par crainte de notre empreinte carbone ou de notre impact, sinon nous deviendrons comme le Doug Forcett de Michael McKean dans The Good Place, vivant dans un état d’anxiété perpétuel où notre monde entier s’écroule chaque fois que nous marchons accidentellement sur un escargot. Au lieu de cela, nous pouvons chercher à devenir plus heureux – et à rendre le monde meilleur – grâce à des actions qui auront un effet sur ces deux aspects à la fois.
Gagner la guerre de la confiance
Comme le souligne Kyra Simone, doctorante en sciences de l’environnement à l’Université McMaster, ceux qui nient l’existence des changements climatiques ont depuis longtemps adopté une tactique consistant à s’attaquer au messager plutôt qu’au message. Il s’agit de dénoncer l’hypocrisie de ceux qui s’expriment le plus sur les solutions, comme si cela signifiait que ce qu’ils disent sur le climat doit être faux. Al Gore s’est rendu en avion à une conférence! David Suzuki a plusieurs maisons! Greta Thunberg possède des vêtements! Bien sûr, certaines de ces choses peuvent être qualifiées d’hypocrites, mais aucune d’entre elles ne fait du message un mensonge.
Ce type particulier de désinformation semble relativement récent pour ce qui est par exemple de la vaccination, mais on l’observe depuis longtemps en ce qui concerne les changements climatiques, à commencer par les sociétés pétrolières et gazières qui ont financé des études frauduleuses il y a plusieurs dizaines d’années pour brouiller les pistes et faire en sorte que personne ne puisse distinguer ce qui est vrai de ce qui est inventé. Ces contre-discours imitent l’approche scientifique et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes continuent à être sceptiques à l’égard de la science aujourd’hui, en particulier de la climatologie.
Nous entendons souvent parler d’une guerre contre la vérité. Que le climat politique et le discours en ligne actuels sont conçus pour rendre la vérité subjective (eh bien, c’est peut-être vrai pour vous, mais moi, je connais des faits « alternatifs »). Selon moi, il s’agit en fait d’une guerre menée pour gagner la confiance. Des efforts concertés pour délégitimer les établissements d’enseignement, les médias et les experts de toutes sortes ont permis à des charlatans et à des personnalités publiques malhonnêtes de remplacer la confiance que les gens accordaient autrefois à ces institutions par une confiance en eux, en leurs balados, en leurs publications dans Substack et en leurs marques de suppléments. Ces efforts ont fonctionné jusqu’à un certain point. Les États-Uniens font désormais davantage confiance à ce qu’ils lisent dans les médias sociaux qu’aux médias traditionnels. Au Canada, nous n’en sommes pas encore là, mais nous tendons vers cette direction.
En tant que personne qui passe beaucoup de temps sur les médias sociaux (je suis chargé de publier le contenu des médias sociaux de la SCP, de surveiller les tendances et de traiter les réponses et les messages directs), je passe probablement plus de temps sur les médias sociaux que la personne moyenne, et (je suppose) plus que ce que les psychologues jugeraient comme étant sain. Passer du temps dans cet espace, en particulier sur Twitter, c’est être exposé à un barrage constant de personnes et de robots qui ne demandent qu’à contredire les experts dans leur domaine d’expertise, à attaquer leur personnalité et à rechercher une influence en ligne par les moyens les plus négatifs qui soient. Il devient difficile de se rappeler que ces personnes sont une très petite minorité, puisque ces plateformes ont fait de cette minorité la minorité la plus bruyante de notre histoire collective.
J’ai l’impression que la Dre Katherine Arbuthnott me dirait qu’en fait, je ne vois pas ce genre de choses aussi souvent que je le crois. Ce qui est probablement vrai puisque je n’ai en tête qu’une vingtaine d’exemples directs, mais ceux-là occupent une place démesurée dans ma mémoire. Elle est ardemment convaincue que nous, les êtres humains d’Amérique du Nord, avons été conditionnés à faire trop peu confiance aux autres. Que nous sous-estimons constamment la volonté des étrangers et même de nos amis de nous aider, de faire ce qui est juste et de faire passer les besoins de nos quartiers et communautés avant certains des leurs.
Tout au long du mois de février, je n’ai pas réussi à garder ces faits à l’esprit. Ce n’est que lorsque j’étais sur le point d’écrire une réponse furieuse à un gazouillis bizarrement non factuel et conspirationniste sur les changements climatiques de la part d’une personnalité publique canadienne bien connue que j’ai dû m’arrêter un instant pour réfléchir à mon état d’esprit. Je me suis rendu compte que j’avais dépassé les limites que je m’étais fixées. Mais que pouvons-nous faire alors?
Nous pouvons travailler sur notre propre littératie médiatique : cette histoire provient-elle d’une source digne de confiance? Avons-nous la certitude que le ou la scientifique qui a réalisé l’étude à laquelle il est fait référence est bel et bien un ou une scientifique? Et spécialiste dans le domaine dans lequel l’étude a été menée? L’article est-il hébergé sur une plateforme qui vérifie les faits?
Une autre option consiste à répondre à ce qui n’est pas factuel par du factuel. Je ne parle pas de commenter le mème que votre ami Facebook a partagé sur le fait qu’Al Gore est riche et que, par conséquent, les changements climatiques ne sont pas réels. Comme le dit Rachel Salt de Science Up First, commenter, citer un gazouillis ou partager une publication dans le but de la démystifier ne fait rien d’autre qu’amplifier une information erronée. Elle suggère plutôt de faire des captures d’écran du contenu qui peut alors être vu et traité sans alimenter les algorithmes destructeurs qui nous ont conduits là où nous sommes. Ou alors, vous pouvez simplement publier vos propres pensées, votre propre science et votre propre contenu – plus il y a de vérité en ligne, moins elle est susceptible d’être noyée par le volume démesuré de la minorité bruyante.
Nous pouvons avoir l’assurance que la plupart des personnes que nous connaissons, et la plupart des personnes que nous rencontrons ont un niveau de préoccupation similaire sur des questions majeures comme les changements climatiques. Nous pouvons croire que tout geste que nous posons sera également posé par une multitude d’autres personnes, et qu’en posant ces gestes suffisamment de fois, nous obtiendrons les changements à grande échelle que ces gestes sont censés engendrer. Et nous pouvons ignorer les voix les plus fortes dans la pièce et sur Internet, sachant que la majorité des gens ressentent la même chose que nous, agissent de la même façon que nous et poursuivent les mêmes objectifs que nous.
C’est simplement qu’ils ne sont pas aussi bruyants sur ce sujet. Vous pouvez avoir une influence sur Internet pendant quelques jours en partageant une théorie selon laquelle Kate Middleton est en fait une agente ayant subi un lavage de cerveau comme dans le film Un crime dans la tête, infiltrée dans la famille royale britannique dans le but de rendre le fromage illégal. Vous avez moins de chances de faire parler de vous en parlant de votre jardin de radis. Ainsi, l’utilisateur moyen d’Internet que je suis a beaucoup plus de chances d’entendre parler du fromage illégal que de vos radis. Et c’est bien dommage.
S’appuyer sur les autres
Les solutions aux changements climatiques sont interdisciplinaires. Ce terme fait généralement référence à des experts de différents domaines qui travaillent ensemble pour faire avancer une science, ce qui leur permet d’être plus efficaces que s’ils étaient chacun de leur côté. Comme la fois où Amy et Sheldon ont partagé un prix Nobel dans la série The Big Bang Theory. C’est également vrai en ce qui concerne la crise climatique : une avancée scientifique s’appuie sur les travaux de quelqu’un d’autre, et une discipline améliore les autres du simple fait de la collaboration qui existe entre elles.
Prenons l’exemple des jeunes scientifiques du Prime Family Lab de la Dre Heather Prime à l’Université York, Paul De Luca et Alex Markwell, qui intègrent les changements climatiques dans les études qu’ils mènent auprès des familles et des enfants. Ils n’ont pas à déterminer si les changements climatiques constituent une menace ou s’ils sont réels; ils peuvent considérer qu’il s’agit d’un fait et, à partir de là, passer à l’étape scientifique suivante. Les scientifiques de l’environnement ont fait ce travail pendant des décennies, malgré les coupes budgétaires, le musellement des autorités et les voix sceptiques bruyantes évoquées plus haut qui cherchent à anéantir leur travail.
Tandis que Paul et Alex s’appuient sur la climatologie, Kyra Simone, étudiante au doctorat à l’Université McMaster et collaboratrice de Science Up First, de son côté, est en train de créer une nouvelle climatologie qui repose sur des décennies de travail dans le domaine de l’environnement et elle ouvre la voie à des percées dans des dizaines de domaines pour les décennies à venir. Des psychologues combinent leurs spécialités à l’Université de la Colombie-Britannique, où la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la durabilité des comportements, la Dre Jiaying Zhao, s’est associée à la Dre Elizabeth Dunn, chercheuse sur le bonheur, pour trouver des moyens de favoriser des comportements qui sont bons pour l’environnement et qui nous rendent heureux.
Du côté de l’action communautaire, le Dr Kyle Merritt, urgentologue, s’est associé à de nombreux autres professionnels de la santé pour former Doctors and Nurses for Planetary Health (médecins et infirmières pour la santé de la planète) à Nelson, en Colombie-Britannique. Le Dr Todd Kettner, psychologue, en est également membre, et ils étudient ensemble les moyens de rendre leurs pratiques et leur travail plus respectueux du climat (les gaz anesthésiques contribuent largement au réchauffement de la planète!). En tant que groupe, ils sont amenés à collaborer avec les autorités municipales afin de trouver des moyens d’améliorer la durabilité par des projets d’infrastructure et des politiques municipales.
La Section de psychologie de l’environnement de la SCP est une section qui ne s’intéresse pas directement aux questions environnementales en tant que telles (comme la pollution, les émissions de gaz à effet de serre et la disparition de la glace de mer), mais plutôt au comportement des personnes par rapport à leur environnement, ce qui désigne les environnements physiques construits (tels que leurs maisons, leurs bureaux ou les rues et les quartiers qu’ils traversent lors de leurs trajets domicile-travail), de même que les espaces naturels (tels que les parcs, les forêts ou les cours d’eau). Cette année, la Section a décidé de créer un groupe de travail afin de réunir des psychologues de tous horizons pour travailler ensemble sur des solutions climatiques. La Dre Phoenix Gillis a fait le premier pas, puis la présidente de la Section, la Dre Lindsay McCunn, s’est rapidement jointe au groupe, et les réunions ont été animées, instructives et très fréquentées.
Leur initiative pourrait donner de très bons résultats, grâce à la diversité des compétences des psychologues qui sont mises en commun. Les psychologues du travail et organisationnels, qui étudient le comportement humain sur le lieu de travail, collaborent avec les psychologues de l’environnement afin de concevoir des espaces de bureaux respectueux de l’environnement où les gens sont plus heureux de venir travailler. Les psychologues cliniciens qui voient leurs patients exprimer leur anxiété par rapport à cette menace existentielle peuvent travailler avec des psychologues sociaux et des psychologues de la personnalité pour proposer des actions concrètes qui peuvent améliorer l’environnement tout en atténuant les craintes ressenties par les gens.
Je suis la personne responsable de l’initiative du Mois de la psychologie à la SCP, ce qui veut dire que cette année, j’ai dû me pencher sur les conséquences des catastrophes climatiques et sur les objectifs manqués des dernières décennies, ainsi que sur la peur existentielle qui les accompagne, la plupart du temps seul. J’avais besoin de quelqu’un d’autre pour me faire remarquer ma négativité croissante, dont j’étais largement inconscient. Ce fut ma conjointe, Jen, qui fit un commentaire anodin à ce sujet, ce qui provoqua en moi un moment de clarté. J’ai parlé avec des dizaines de personnes merveilleuses au cours des quatre derniers mois pour préparer cette campagne, mais à la fin, j’ai manqué ou oublié plusieurs des leçons que j’essayais moi-même de transmettre ce mois-ci.
Nous pouvons tous demander à quelqu’un que nous connaissons si nous pouvons participer à son travail, s’il veut se joindre à notre travail, ou bien lancer un nouveau projet. Il est pratiquement certain que les personnes à qui nous tendons la main partagent le plus souvent le même point de vue sur les changements climatiques et qu’elles saisiront l’occasion d’agir. Nous sommes plus heureux lorsque nous collaborons les uns avec les autres, et les gestes que nous posons en tandem réduisent notre appréhension et notre anxiété qui sont liées aux menaces existentielles.
Post-scriptum : la Terre est notre partenaire
Après avoir terminé de rédiger cet article, j’ai eu une autre conversation au cours du mois qui, je pense, pourrait ajouter un quatrième aspect à prendre en considération. J’ai parlé avec kukum Beverly Keeshig-Soonias, psychologue anishinabe et membre de la Première Nation des Chippewas de Nawash. Nous parlions de la reconnaissance territoriale, de la raison pour laquelle nous la pratiquons et de la signification qui la sous-tend.
Les peuples autochtones pratiquent la reconnaissance territoriale depuis des milliers d’années. Ce n’est que récemment, dans un esprit de vérité et de réconciliation, qu’ils ont invité le reste d’entre nous à se joindre à eux. La reconnaissance territoriale ne se limite pas à rappeler qu’Ottawa est le territoire ancestral des Haudenosaunee et que les colons et le colonialisme les ont déplacés par la force il y a des décennies ou des siècles.
La reconnaissance territoriale est l’expression verbale ou écrite de la compréhension du fait que non seulement les peuples autochtones vivaient sur ce territoire avant l’arrivée des Européens, mais qu’ils entretenaient également une relation avec ce territoire. C’est une reconnaissance du fait que, même si aujourd’hui sur ce territoire il y a un terrain de golf, un Jean-Coutu ou la Tour CN, la relation entre le peuple et le territoire demeure intacte.
Kukum Beverly parle de la Terre comme d’une partenaire, l’autre moitié d’une relation qui vous nourrit tous les deux. La Terre vous fournit de la nourriture, de l’eau et un abri. L’air que vous respirez et la subsistance dont vous avez besoin pour rester en vie. En retour, vous fournissez à la Terre ce dont elle a besoin. Vous préservez le sol, vous aidez à acheminer l’eau vers les plantes et les plantes vers les animaux et vous la traitez, elle, la Terre, comme une partenaire égale dans une relation qui vous profite à tous les deux.
Ce n’est que lorsque nous commençons à considérer la Terre comme une chose, comme inanimée, que nous nous en servons pour extraire des ressources à notre profit, au détriment de la Terre. Les peuples autochtones, qui ont été les gardiens de la Terre pendant des milliers d’années et qui en sont encore les gardiens, n’agiraient jamais de la sorte. Agir ainsi reviendrait à abuser d’un partenaire, à ignorer une relation, à exploiter un membre de la famille.
Ainsi, la façon ultime d’aborder la question des changements climatiques est peut-être de considérer d’une manière différente la Terre, l’environnement et le territoire sur lequel nous nous trouvons. Non pas comme une chose que nous essayons d’aider, ou comme une victime à qui nous essayons de faire pardonner le mal que nous avons fait. Mais plutôt comme une collaboratrice et une entité avec laquelle nous entretenons une relation. Une partenaire avec laquelle nous travaillons à améliorer le sort l’une de l’autre.
Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c’est en agissant ensemble que nous irons plus loin

Tout au long du Mois de la psychologie en février, le sujet de la désinformation en matière de changement climatique est revenu à maintes reprises. Pour conclure le mois, nous avons parlé avec Kyra Simone et Rachel Salt à Science Up First de nos réponses à la désinformation, des moyens de la combattre et des conversations difficiles avec les amis et la famille.

Cet été, des feux de forêt ont ravagé les Territoires du Nord-Ouest, forçant l’évacuation d’environ 70 % de la population. Le psychologue de Yellowknife Merril Dean, l’un des évacués, a vu la dévastation sous de nombreux angles. Dans cet épisode du balado Mind Full de la SCP consacré au Mois de la psychologie, elle nous fait part de ses propres expériences ainsi que de quelques réflexions sur la réponse du gouvernement et sur ce que les collectivités du Nord pourraient faire à partir de maintenant.

Il y a un peu plus d’une décennie, la science du climat au Canada a subi un revers important lorsque le gouvernement fédéral a réduit le financement de la recherche environnementale et empêché les scientifiques de parler aux médias et de partager leurs découvertes. Les climatologues ressentent encore les effets de ces politiques et n’ont toujours pas complètement repris pied. Entre-temps, d’autres disciplines scientifiques ont commencé à s’intéresser davantage au changement climatique et à faire des progrès. L’une de ces disciplines est la psychologie.
Les chercheurs en psychologie intègrent le climat dans leurs études
Lorsqu’un chercheur ou un étudiant demande de l’argent pour mener des recherches, il doit convaincre les bailleurs de fonds non seulement que son idée est bonne, mais aussi qu’il est la meilleure personne pour mener ces recherches. Les bailleurs de fonds tiennent compte d’un grand nombre d’éléments, notamment les répercussions de la recherche, la manière dont les connaissances seront partagées, le temps nécessaire à la réalisation de la recherche et le rendement de leur investissement (optimisation des ressources).
Au Prime Family Lab de l’Université York, la directrice du laboratoire, la Dre Heather Prime, discute de l’avenir avec son étudiante Alex Markwell. En raison de la manière dont elles demandent et reçoivent leur financement, leurs projets de recherche doivent être étroitement liés au laboratoire lui-même — dans leur cas, il s’agit de l’étude des dynamiques familiales. Comment les parents et les frères et sœurs influencent les enfants de la naissance à l’adolescence, ou comment des événements extérieurs majeurs ou mineurs touchent les familles. Le laboratoire a été lancé en 2020, au moment où la pandémie de COVID-19 est devenue un événement extérieur majeur qui a bouleversé les dynamiques familiales au Canada et dans le monde entier.
Les étudiants choisissent un laboratoire en raison de l’expertise que le programme de recherche et le superviseur apportent à ce laboratoire. C’est ce qui a amené Alex au Prime Family Lab. La famille est son domaine d’intérêt et le prisme à travers lequel elle envisage tout projet potentiel. Elle s’intéresse vivement à la lutte contre les changements climatiques, mais la question ne faisait pas partie des discussions avant son arrivée. Ce n’est qu’en discutant avec la directrice du laboratoire qu’Alex a découvert que les deux femmes s’intéressaient toutes deux fervemment à la question des changements climatiques. Heather dit :
« Alex a souligné il y a un an ou deux que la façon dont nous étudions la pandémie est tout à fait transposable à la façon dont nous pourrions étudier les changements climatiques. »
Elles ont donc commencé à réfléchir aux moyens de faire passer leur programme de recherche dans la sphère des changements climatiques. Tandis qu’Alex pense à son doctorat, qu’elle commencera en septembre, elle rédige une demande de bourse d’études et envisage de consacrer la recherche qu’elle propose au thème du climat. L’une des possibilités envisagées par Alex est la création d’un modèle théorique du point de vue du système familial.
« Parce que les changements climatiques vont concerner de plus en plus de gens, il faut une carte — ce qui peut sembler ennuyeux parce que c’est théorique, mais cette carte permettra de créer un cadre balisant ‘ce que nous pensons qu’il va arriver sur la base de tout ce que nous savons déjà’. Cela demande beaucoup de travail — il faut parcourir la documentation, rassembler plusieurs théories, puis créer cette ‘carte’ ».
Plus précisément, Alex veut étudier les dysfonctionnements familiaux qui pourraient résulter des changements climatiques. Elle pense que ce modèle serait similaire au modèle de perturbation familiale lié à la COVID que Heather a publié et qui présente la façon dont les bouleversements causés par la pandémie se répercutent dans les familles et influencent leur dynamique.
Elles peuvent déjà commencer à examiner des interventions réalisables — des activités psychopédagogiques qui pourraient apprendre aux parents et aux personnes qui s’occupent des enfants à parler des changements climatiques à ces derniers. Ou peut-être les répercussions sociales et économiques des changements climatiques sur les relations familiales, dont les enfants pourraient souffrir, étant donné qu’ils sont étroitement dépendants de leurs relations avec leurs parents. Mais elles doivent d’abord définir les paramètres de leur étude.
S’agit-il de familles qui ont subi un phénomène climatique majeur — comme la perte de leur maison à cause d’un incendie de forêt — ou de familles qui sont menacées par un tel phénomène (vivant à proximité d’une zone inondable), ou encore de familles qui sont tout simplement angoissées par tout cela? Peut-on sonder ces personnes à Toronto?
Avant de demander une subvention de recherche, il faut répondre à de nombreuses questions. De nombreuses autres questions se posent une fois le financement obtenu.
Les climatologues canadiens se sentent encore étouffés
La Dre Alana Westwood est directrice du laboratoire Westwood pour la gestion des ressources naturelles et les politiques scientifiques de l’Université Dalhousie. Son laboratoire a récemment réalisé deux études sur l’ingérence dans la recherche environnementale. Sur les 741 spécialistes de l’environnement interrogés, 92 % ont déclaré avoir subi de l’ingérence dans la conduite ou la communication de leurs recherches. La Dre Westwood, avec son associée de recherche Manjulika E. Robertson et l’étudiante à la maîtrise Samantha M. Chu, ont écrit un article dans The Conversation qui présente leurs constatations et les ramifications de ces obstacles invisibles omniprésents.
Beaucoup d’entre nous se souviennent des manifestations organisées par des scientifiques en 2013 pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié de « guerre contre la science » menée par le gouvernement fédéral à l’époque. Le financement de la science était considérablement réduit, et les scientifiques qui pouvaient encore faire de la recherche se voyaient empêchés de communiquer les résultats de leurs recherches au public — ce qui est en quelque sorte l’objectif de la recherche au départ. Une grande partie de ce musellement concernait la climatologie, le gouvernement fédéral cherchant à minimiser les effets les plus dangereux — voire l’existence même — des changements climatiques.
Depuis, les politiques à l’échelon fédéral ont changé. En théorie, cela signifie que les scientifiques peuvent reprendre leurs travaux et partager leurs résultats en toute impunité. Les études d’Alana semblent indiquer que ce n’est malheureusement pas le cas.
Le climat d’incertitude en est en partie responsable : pendant longtemps, certaines disciplines scientifiques n’ont pas été financées et ont été expressément rejetées. Les scientifiques peuvent-ils se remettre à étudier la pollution, les espèces menacées et les émissions de gaz à effet de serre? Obtiendront-ils du financement s’ils le font? Qu’en est-il des bailleurs de fonds? Ils subissent aujourd’hui une forte pression extérieure pour ne financer que certains types de recherche, pression qui ne s’est pas nécessairement atténuée du seul fait d’un changement intervenu dans la politique fédérale.
« Nous avons classé l’ingérence en deux catégories, dit Alana. L’une d’entre elles est imposée de l’extérieur, c’est-à-dire que l’organisation impose des restrictions à la capacité du chercheur à mener des recherches ou à communiquer ses résultats de recherche. Cela peut découler des politiques du lieu de travail, de leur responsable, de la haute direction ou de leur service des communications. Ce qui était nouveau et plus insidieux, c’était l’ingérence intériorisée. Cela se produit lorsque les chercheurs eux-mêmes ne veulent pas communiquer avec les médias, soit par crainte de mal paraître ou d’une réaction négative du public. »
Les climatologues évoluent dans un système où les effets de la guerre contre la science se font encore sentir. Il en résulte que le paysage canadien de la climatologie, qui s’est fracturé il y a 10 ans, reste fracturé à ce jour, et que des travaux importants dans ce domaine ont été retardés ou carrément mis en veilleuse.
De retour au Prime Family Lab, à l’Université York, Heather affirme qu’elle n’a ressenti aucune pression extérieure qui pourrait être considérée comme un musellement et qu’elle n’a subi aucune ingérence quant aux sujets qu’elle choisit d’aborder. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que son laboratoire est tout nouveau. C’est peut-être aussi parce que jusqu’à présent, son laboratoire a choisi de se concentrer principalement sur la COVID. Mais il est probable que cela s’explique en grande partie par le fait que le Prime Family Lab est un laboratoire de psychologie, une discipline qui n’a pas fait l’objet du même type d’examen et d’ingérence au cours des deux dernières décennies.
La psychologie a un rôle à jouer dans le débat climatique
« Je crois qu’à ce stade, la psychologie a probablement un rôle primordial à jouer dans la réponse à la crise climatique. Les climatologues, les écologistes et les ingénieurs en environnement ont pratiquement trouvé les solutions à nos problèmes. Il y a encore beaucoup de travail à faire, c’est évident, mais il s’agit désormais de faire en sorte que les gens adoptent ces solutions. »
La Dre Katherine Arbuthnott est professeure émérite au Collège Campion de l’Université de Regina. Elle a passé les deux dernières décennies à étudier les bienfaits pour la santé de la proximité avec la nature et du temps passé dans la nature. Passer du temps à l’extérieur, interagir avec les arbres, la faune et le soleil, a des effets bénéfiques sur notre santé physique et mentale, et nous incite en outre à respecter l’environnement.
Katherine n’hésite pas à souligner que la psychologie est depuis longtemps une science qui s’intéresse aux comportements individuels. Ce qui fait qu’Une personne fait Une chose. En tant que chercheuse en neurosciences cognitives, elle étudie les cerveaux des individus pour analyser les processus cognitifs. Les psychologues cliniciens travaillent généralement avec une seule personne à la fois, afin de l’aider de la manière la plus personnalisée possible. Une grande partie de la recherche en psychologie sur les interventions liées aux changements climatiques s’est concentrée sur cette thématique.
La Dre Jiaying Zhao est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la durabilité des comportements et professeure agrégée au département de psychologie et à l’Institute for Resources, Environment and Sustainability de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a dirigé des études telles que celle qui a démontré que l’apposition d’images de tortues et de dauphins piégés dans des déchets plastiques sur les bacs de recyclage et les poubelles réduisait la quantité de déchets plastiques jetés par les citoyens.
« Nous avons constaté qu’en installant ces images sur les poubelles, la quantité de déchets plastiques diminuait, c’est-à-dire la quantité de déchets plastiques rejetés dans tous les flux de déchets, qu’il s’agisse d’ordures ou de recyclage. Les gens réagissent à ces images, et le principe consiste à essayer de relier nos actions (jeter des objets) aux conséquences en aval de ces actions (dauphins en détresse). »
Jiaying a également lancé une initiative visant à établir un lien entre les comportements durables et le bonheur. Jiaying, une scientifique du comportement, a collaboré avec sa collègue, Elizabeth Dunn, chercheuse en psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique, spécialisée dans l’étude du bonheur humain. Il en est ressorti l’idée de recadrer le débat sur les changements climatiques en passant d’une logique de sacrifice (renoncer à la viande, acheter moins) à une logique de bonheur. Beaucoup de choses qui sont meilleures pour l’environnement (manger plus de légumes, faire du vélo) améliorent également notre santé mentale et font de nous des personnes plus heureuses!
Jiaying a donné une conférence TED sur ce même sujet, qui aborde ce que les enfants appelleraient des « trucs » pour être plus heureux tout en bénéficiant à l’environnement — comme organiser le contenu de son réfrigérateur selon les principes du feng-shui. Ou encore, faire l’effort de faire du covoiturage avec des personnes qui peuvent rendre le morne trajet vers le travail aux heures de pointe plus agréable et plus stimulant pour le cerveau.
Pour faire vraiment bouger les choses dans la lutte contre les changements climatiques, il faudra que beaucoup de gens fassent beaucoup de petites choses, et que beaucoup de pays fassent beaucoup de grandes choses. Les personnes qui font de petites choses sont plus susceptibles d’exiger de grandes choses de leur communauté et de leur pays. Et nous sommes en train d’y arriver. Plus de gens que nous ne le pensons sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour éviter les pires conséquences des changements climatiques.
Katherine parle beaucoup de confiance. La confiance que nous avons dans la capacité des autres à faire ce qui est juste, et l’écart entre nos perceptions et la réalité lorsqu’il s’agit des intentions d’autrui. Nous avons tendance à sous-estimer le niveau d’engagement des étrangers à faire ce qui est bien, alors qu’en réalité, chacun d’entre nous est plus enclin que le contraire à vouloir prendre des mesures qui profitent à l’ensemble de la collectivité. Elle reconnaît également que, pour s’attaquer véritablement à la crise climatique, il ne suffit pas d’inciter les individus à agir différemment.
La psychologie peut aider. Certes, la discipline de la psychologie est un peu en retard dans ce domaine. Mais elle est désormais une actrice du débat sur le climat — et peut être un acteur essentiel, en comblant le fossé entre les conclusions et les solutions proposées par les climatologues et la mise en œuvre de ces solutions par les personnes et les communautés. Les spécialistes de l’environnement au Canada accusent un certain retard et commencent à peine à reprendre pied. Mais ils ont accompli un travail considérable pendant des décennies en nous informant de ce qui se passe et de ce que nous devons faire. Ils ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d’alarme. Jiaying, Katherine, Heather, et bientôt Alex et bien d’autres comme elle, apporteront leur expertise dans le cadre d’un effort de collaboration véritablement interdisciplinaire visant à tous nous mettre sur la bonne voie, celle de la durabilité, de la santé de la planète et de notre bonheur collectif.

Tant de discours sur la crise climatique sont pessimistes. Il est difficile pour beaucoup de ne pas devenir un peu défaitistes ou de lever les mains et d’ignorer le problème. La solution à ce genre de désespoir est l’action – de petites actions qui nous poussent tous vers un avenir plus durable. Et ces actions – et la conversation à leur sujet – peuvent être heureuses! L’invité d’aujourd’hui est le Dr. Jiaying Zhao, qui relie l’action climatique à notre propre bonheur personnel d’une manière qui, nous l’espérons, stimule cette action – et vous rend heureux en cours de route!

Dre Heather Prime, Paul De Luca, Alex Markwell
Beaucoup de mesures pour lutter contre les changements climatiques sont ambitieuses. Les engagements, les pactes et les accords sont souvent non contraignants et ne comportent aucun mécanisme d’application. Mais une action ambitieuse est une action, et elle fonctionne souvent – surtout lorsque l’action est entreprise par beaucoup. Le Département de psychologie de l’Université York est le premier au Canada à adhérer au projet 1 sur 5, une initiative qui demande aux universitaires et aux étudiants de faire du changement climatique le sujet d’un projet ou d’une affectation sur cinq.
C’est en 1992 que l’Organisation des Nations unies a reconnu pour la première fois que les changements climatiques constituaient un problème mondial majeur et urgent. Cette année-là, le Sommet de la Terre de Rio a débouché sur les premiers accords internationaux sur les changements climatiques. En 1997, le protocole de Kyoto a imposé aux pays développés de réduire leurs émissions de 5 % par rapport aux niveaux de 1990, mais les pays en développement (dont la Chine et l’Inde à l’époque) en ont été exemptés. Depuis, les pays développés ont réussi à réduire leurs émissions de 17 % (collectivement). Avant 2020, l’Allemagne avait réduit ses émissions de 30 %. Les États-Unis se sont retirés de l’accord de Kyoto en 2001.
D’autres conférences, réunions et sommets ont suivi : Copenhague en 2009, Cancún en 2010, Durban en 2011, Doha en 2012, Varsovie en 2013. Des accords sont conclus, des objectifs sont fixés, les pays se retirent, les objectifs ne sont pas atteints, les accords tombent à l’eau.
En 2015, la conférence de Paris a marqué un tournant dans l’action contre les changements climatiques. Cent quatre-vingt-seize pays ont signé l’accord de Paris, le plus important accord mondial sur le climat jamais conclu. Les résultats? Ils restent à déterminer... les pays peuvent choisir leurs propres objectifs et aucun mécanisme d’application n’est prévu pour s’assurer qu’ils les atteignent. Depuis, les réunions se sont multipliées, avec des résultats mitigés.
Cela dit, de nombreux pays — dont certains des plus importants — ont fait un effort concerté pour atteindre les objectifs fixés par ces séries d’accords et de pactes. Bien qu’il n’existe pas de mécanisme d’application permettant de les obliger à rendre des comptes, le simple fait de signer un accord mondial a, en fait, encouragé de nombreuses puissances mondiales à s’orienter vers les énergies renouvelables et une infrastructure plus verte, même si cela n’a pas été aussi rapide que beaucoup d’entre nous l’auraient souhaité.
Les progrès en matière de climat sont lents. Mais il s’agit tout de même de progrès. Cela peut être frustrant. On peut avoir l’impression que les choses avancent à un rythme d’escargot et pas assez vite compte tenu de l’urgence de la question. Mais les choses avancent, et l’on peut espérer que les conséquences les plus graves des changements climatiques pourront être évitées grâce à cela.
L’année dernière, le département de psychologie de l’Université York a rejoint le 1 in 5 Project. Ce projet mondial est un cadre permettant à la communauté universitaire de concentrer une partie de son intelligence collective sur le climat et la biodiversité, et le département de psychologie de l’Université York est le premier département universitaire au Canada à s’y associer. Cette initiative vise à ce que les établissements universitaires s’engagent à faire en sorte qu’un devoir, un projet ou un cours sur cinq comporte un élément lié aux changements climatiques. À l’instar d’autres accords, conventions et pactes sur le climat, il n’existe, dans le cadre de ce projet, aucun mécanisme d’application ni aucune obligation de rendre des comptes, si ce n’est la volonté d’améliorer l’avenir de tous les habitants de la planète.
Heather Prime, directrice du Prime Family Lab de l’Université York, s’est lancée avec enthousiasme dans ce projet, ce qui l’a amenée à intégrer la question des changements climatiques dans son propre programme d’études et à réfléchir plus régulièrement à la crise climatique. Les universités et les institutions qui adhèrent au 1 in 5 Project ne sont pas expressément tenues de respecter le mandat. Mais l’effet est toujours là. Il peut être lent — plus lent que nous ne le souhaiterions — mais ce n’est pas le cas des chercheurs d’aujourd’hui. La lenteur des travaux scientifiques sur les changements climatiques est le résultat d’années passées à éviter la question au sein de la communauté scientifique dans son ensemble. Selon Mme Prime,
« [Le 1 in 5 Project] est en quelque sorte un défi lancé à chacun pour qu’il réfléchisse à la manière dont il peut aborder la question des changements climatiques dans le cadre de sa discipline. De plus, il implique les étudiants dans le processus. À bien des égards, les nouvelles générations sont plus engagées dans la cause, car ce sont elles qui seront les plus touchées ».
Il n’a pas été facile pour Mme Prime de mettre en œuvre le mandat du 1 in 5 Project dans ses cours, et il se peut qu’il ne soit pas encore totalement intégré. Son laboratoire s’intéresse tout particulièrement aux dynamiques familiales — comment les enfants assimilent leurs croyances et leurs valeurs au sein de leur famille, comment les facteurs de stress des parents et des soignants se répercutent sur les enfants dont ils ont la charge, etc. À première vue, ce n’est pas le genre de cadre où la recherche sur les changements climatiques peut jouer un rôle majeur.
Mais comme le disent Heather et ses étudiants, les changements climatiques interviennent dans pratiquement tous les aspects de notre vie, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir un impact sur pratiquement tous les projets de recherche que l’on peut concevoir, non seulement en sciences de l’environnement, mais aussi en sciences sociales. Vous étudiez les inégalités de revenu? Elles seront exacerbées par les changements climatiques. La dépression et l’anxiété? Pour beaucoup, ces problèmes sont aggravés par la crainte d’une catastrophe imminente à laquelle nous sommes tous confrontés.
Ainsi, bien que le département de psychologie de l’Université York ait adhéré au 1 in 5 Project, il n’a pas encore atteint son objectif, à savoir qu’un devoir sur cinq donné à ses étudiants porte sur les changements climatiques. Comme c’est le cas de nombreuses initiatives en matière de changement climatique, il s’agit davantage d’une aspiration que d’un engagement. Mais son effet est indéniable.
Paul De Luca est étudiant au Prime Family Lab de l’Université York.
« Je pense que le mandat du 1 in 5 Project est très motivant, car la lutte contre les changements climatiques peut donner l’impression d’être un combat difficile. Mais lorsqu’on se rend sur le site Web du projet et qu’on voit tous les projets extraordinaires qui sont en cours, on a l’impression de faire partie d’un mouvement collectif. D’une certaine manière, cela oriente mon travail, car je peux faire défiler les pages et voir sur quoi travaillent d’autres écoles et d’autres laboratoires. Je peux m’en inspirer pour mon travail et peut-être repérer certaines lacunes. Je considère cela comme un mouvement collectif vers un objectif commun : parler des changements climatiques. »
C’est en quelque sorte une cible floue. Un projet sur cinq portera sur les changements climatiques… un jour. Mais le simple fait d’adhérer au projet et de s’engager a permis au département de psychologie de York de prendre part au débat et à ses étudiants de se familiariser avec la climatologie, et les a encouragés à réfléchir à leurs propres spécialités à travers ce prisme. Paul poursuit en parlant d’une étude qu’il a vue sur le site du 1 in 5 Project.
« Un projet proposé portait sur l’évolution, en fonction de l’âge, de la compréhension des changements climatiques par les enfants et de leur attitude à l’égard de l’environnement. De nombreuses recherches ont été menées du point de vue des adolescents, mais pas autant du point de vue des jeunes enfants d’âge scolaire. Lorsque je vois cela, je me mets à réfléchir aux mesures dont nous disposons actuellement et qui se sont avérées efficaces auprès des populations pédiatriques. Avons-nous les outils nécessaires pour aborder des sujets tels que la conscience de la crise climatique, les attitudes à l’égard de l’environnement et l’anxiété découlant de cette conscience? Et je ne sais pas si c’est le cas actuellement. »
Alex Markwell, une autre étudiante au laboratoire, prépare son doctorat et réfléchit à des sujets de thèse. Elle n’a pas accordé beaucoup d’attention au 1 in 5 Project et ne s’est pas penchée sur le sujet en profondeur, son engagement à lutter contre les changements climatiques étant déjà acquis. Pour elle, le site Web et le fait que l’Université York se soit engagée dans le projet sont encourageants.
« Cela fait du bien de savoir que beaucoup d’autres étudiants s’intéressent aux mêmes choses et sont passionnés par le même genre de choses. J’ai surtout étudié les recherches publiées au cours de la dernière décennie, mais c’est une bonne ressource pour examiner de plus près ce qui se fait actuellement. »
Pour l’instant, c’est ce que le 1 in 5 Project représente pour les étudiants et les professeurs de York : une ressource. C’est également une aspiration. Jusqu’à présent, les changements apportés au programme sont mineurs. Par exemple, Mme Prime donne un cours de premier cycle intitulé Atypical Development, qui porte sur l’évaluation et le traitement des problèmes de santé mentale chez l’enfant. Depuis trois ans, elle donne aux étudiants un devoir sur le thème de la COVID et les familles. Cette année, le devoir portait sur les changements climatiques.
Les étudiants ont proposé des modèles d’étude très intéressants. L’une d’entre elles étudiait le lien entre pénurie alimentaire et développement du cerveau. Une autre suivait les appels aux lignes d’écoute téléphonique en fonction des phénomènes météorologiques extrêmes. Une troisième étude se penchait sur les sécheresses récurrentes dans les régions rurales du Canada et sur les liens entre ces sécheresses et les problèmes de santé mentale. Les étudiants ont adhéré au projet, et pour ceux qui se sentaient anxieux face à la crise climatique, il s’agissait d’un moyen efficace de canaliser les efforts en ce sens. C’est une façon de relier les gens au rôle qu’ils jouent dans le devenir du monde.
Les changements sont minimes, mais ce sont des changements. L’idée derrière le 1 in 5 Project est assez simple : réunir des universitaires de toutes les disciplines pour s’attaquer collectivement au problème le plus grave au monde, tout cela en faisant un petit geste. Il semble que ce soit la voie à suivre et le moyen de sortir du pire de la crise climatique — nous n’avons pas tous besoin de changer de vie pour nous consacrer à cette cause. Nous pouvons tous faire de petites choses, et observer ceux qui nous entourent faire de petites choses à leur tour, et collectivement, cela est important pour aujourd’hui et pour l’avenir.

La Dre Alana Westwood et son laboratoire de l’Université Dalhousie ont récemment terminé une étude sur les chercheurs en environnement au Canada. Leurs résultats ont montré que les chercheurs dans ce domaine se sentent encore muselés malgré les changements de la politique fédérale conçue pour leur permettre une plus grande liberté de parole et de partager leurs résultats. Nous discutons des raisons, des ramifications et, plus précisément, de ce que cela signifie pour la science environnementale – et la communication de cette science – au Canada.

Merril Dean
Au cours de l’été 2023, des incendies de forêt ont forcé l’évacuation de 70 % des habitants des Territoires du Nord-Ouest. Le fait de devoir quitter leur maison a provoqué de nombreux traumatismes. Mais les personnes évacuées ont également dû faire face au stress lié à la difficulté d’obtenir du soutien en raison des barrières culturelles et linguistiques, ainsi qu’au choc provoqué par le retour dans des communautés dévastées. Merril Dean, psychologue à Yellowknife, donne un aperçu des expériences vécues par les habitants des Territoires du Nord-Ouest et propose quelques suggestions sur la manière dont les écoles pourraient aider au mieux leur personnel et leurs élèves après leur retour d’événements climatiques dévastateurs comme ceux-là.
Le nombre sans précédent d’incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) au printemps et à l’été 2023 a entraîné le déplacement de plus des deux tiers (environ 70 %) des habitants de ce territoire. Une grande partie de la population a été évacuée de son domicile pour des périodes dépassant un mois. Certaines communautés ont été évacuées plusieurs fois. Le 14 mai à 16 h 30, la réserve de Katlodeche est évacuée de l’autre côté de la rivière vers Hay River. À 23 h le soir même, la ville de Hay River a émis un avis d’évacuation et les citoyens des deux communautés ont été invités à se rendre à Yellowknife ou à se diriger vers le sud de l’Alberta. Le 6 juin, la population a été autorisée à rentrer chez elle. Puis, le 12 août, la population de Fort Smith a été évacuée vers Hay River. Moins de 30 heures plus tard, les communautés de Hay River et de Katlodeche ont à nouveau dû être évacuées, cette fois vers l’Alberta, avant de pouvoir rentrer chez elles le 13 septembre. Les communautés situées au nord de Hay River ont été évacuées tout au long du mois d’août, et Yellowknife a été évacuée le 13 août. Au total, environ 25 900 personnes ont été évacuées de leur domicile dans les Territoires du Nord-Ouest au cours de l’été 2023.
Gerald Antoine, grand chef national de la Nation Déné, a demandé la tenue d’une enquête publique indépendante afin d’encourager tous les citoyens à parler de leur expérience, étant donné que l’analyse des incendies de forêt prévue par le gouvernement des T.N.-O. ne prévoit pas la participation du public.
Les évacuations massives de petites et grandes communautés des T.N.-O. cet été ont mis en lumière des problèmes qui ne sont pas forcément propres au Nord, mais qui sont devenus beaucoup plus aigus en raison de l’isolement relatif et des spécificités linguistiques et culturelles d’un grand nombre de communautés autochtones du Nord. Par le passé, les communautés qui devaient être évacuées étaient généralement encouragées à se réfugier dans la grande communauté la plus proche du territoire, ce qui permettait de garantir la disponibilité d’au moins un certain soutien culturel et linguistique; cependant, l’ampleur des évacuations de 2023 a poussé les familles à se réfugier dans le Sud. Pour les familles disposant de leur propre moyen de transport et habituées à voyager, les évacuations, bien que stressantes et effrayantes, ont été supportables. Pour les familles des petites communautés, ou même de Yellowknife, qui disposaient de peu de ressources et n’avaient pas de moyen de transport, l’évacuation a été plus difficile. Les familles ont été mises à bord d’avions pour être transportées vers le sud. Elles n’ont pu apporter qu’un petit sac à dos par personne. Dans certains cas, les personnes ne savaient même pas où leur avion les emmenait au moment de décoller. Au moins un vol a été redirigé en plein vol et les passagers ont été emmenés à Calgary au lieu d’Edmonton. Dans d’autres cas, les Aînés, qui ne parlent que la langue de leur peuple, ont été évacués vers des villes où il n’y avait pas de soutien linguistique. Une éducatrice a raconté que sa grand-mère avait été envoyée à Vancouver lors de l’évacuation médicale et qu’il avait fallu quatre jours à sa famille pour la localiser et faire venir un membre de la famille pour qu’il la rejoigne et fasse office de traducteur.
The National Association of School Psychologists a publié en 2017 un article sur l’aide à apporter aux enfants et aux familles après un incendie de forêt. Cet article explique comment les évacuations massives perturbent la sécurité et la normalité. La nécessité de déménager, même temporairement, provoque un traumatisme, des réactions émotionnelles et des problèmes d’adaptation.
Pour les enfants et les familles qui ont évacué les T.N.-O. par la route au cours de l’été 2023, un stress supplémentaire a été engendré par le fait de devoir rouler au milieu des incendies faisant rage de part et d’autre de la route, tout en étant confronté à une qualité de l’air et une visibilité extrêmement mauvaises en raison de la fumée. Au cours de l’été, les familles qui quittaient le Nord ont traversé la communauté d’Enterprise, dont 90 % des habitations avaient été incendiées quelques jours avant l’évacuation du nord. La vue de la communauté incendiée a été dévastatrice pour les enfants comme pour les adultes.
Pour certains élèves des T.N.-O., les évacuations ont entraîné une interruption des cours en mai et juin, puis en septembre, avant qu’ils ne soient autorisés à rentrer chez eux. Les élèves qui ont regagné leur communauté en voiture ont vu de vastes étendues de terres brûlées et des incendies actifs qui brûlent ou couvent encore. La qualité de l’air était toujours mauvaise. Ces images ont fait prendre conscience aux enfants que, bien qu’ils aient été autorisés à rentrer chez eux, les incendies étaient toujours bien réels et tout proches.
Les évacuations dans le Nord ont coûté cher aux familles. Bien que des logements aient été fournis par la Croix-Rouge ou par des organisations locales d’aide aux sinistrés dans les communautés qui ont accueilli des personnes évacuées (ces logements étaient payés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – GTNO), les personnes les plus vulnérables sur le plan économique ont tout de même connu des difficultés économiques considérables. Les salariés payés à l’heure se sont soudainement retrouvés sans revenus, et les familles bénéficiant d’un soutien au revenu avaient déjà dépensé une grande partie de leur allocation mensuelle en nourriture qu’elles n’ont pas pu emporter avec elles pendant l’évacuation. Des promesses de financement ont été faites par le gouvernement, mais ce n’est que vers la fin de l’évacuation que les détails en ont été communiqués — et le soutien financier à l’évacuation a été très minime. En conséquence, les enfants et les familles ont été confrontés à l’insécurité alimentaire pendant et après l’évacuation.
En retournant dans le Nord après l’évacuation, les familles ont été confrontées à des changements considérables autour de leurs maisons et de leurs communautés. Les maisons situées en dehors de leur quartier ont été détruites par le feu et les zones brûlées se sont rapprochées des communautés, empiétant parfois sur leur territoire. En route vers leur ville d’origine, les enfants et les familles ont été constamment exposés à des rappels de l’évacuation et de sa menace permanente. Les incendies de forêt se sont déplacés sous terre dans le Nord, dans la tourbe et, par conséquent, à l’heure où nous écrivons ces lignes (janvier 2024), les incendies couvent encore — émettant de la fumée et parfois des flammes dans les zones brûlées. En circulant sur l’autoroute entre les communautés où des incendies importants ont eu lieu, les gens sentent encore l’odeur des feux actifs et en sont témoins. Bien que les brûlis ne menacent pas actuellement les habitations, leur seule présence est source de malaise et d’inquiétude.
Le nombre massif de personnes évacuées signifie que toutes les communautés ont été touchées. Les enseignants et les conseillers ont été touchés par l’évacuation et la menace d’incendies de forêt, et en ont subi les conséquences, tout comme leurs élèves et leurs familles. Le stress financier supplémentaire causé par les évacuations a aggravé l’insécurité alimentaire et les soucis financiers des familles du Nord.
Il est important de prendre des mesures pour soutenir le personnel des écoles afin qu’il puisse également soutenir les élèves. La National Association of School Psychologists (NASP) recommande que le personnel scolaire ait la possibilité de partager son expérience et ses sentiments et de les gérer afin de pouvoir aider ses élèves. Le personnel doit être conscient des réactions traumatiques possibles de ses élèves et être prêt à partager cette information avec les parents, qui pourraient avoir l’impression que le comportement de leur enfant a changé depuis les évacuations.
(Fait intéressant, les psychologues qui travaillent dans les communautés touchées par les incendies signalent une augmentation du nombre de demandes d’information de la part des parents pour des enfants présentant des symptômes d’anxiété et des problèmes de comportement qui sont apparus pendant l’évacuation et qui ne se sont pas résorbés).
Les écoles qui disposent de services de counselling devraient être encouragées à organiser des séances d’intervention en cas de crise avec leurs élèves afin de les encourager à partager leur vécu, à exprimer leurs inquiétudes et à les aider à comprendre les incendies de forêt. Dans les écoles et les circonscriptions scolaires qui disposent de psychologues scolaires, ces derniers pourraient être chargés d’animer ces séances de discussion. Dans les T.N.-O., il n’y a pas de psychologues employés par les écoles ou les circonscriptions scolaires, mais on peut trouver un soutien similaire auprès des conseillers en santé mentale pour les jeunes.
Au moment où la communauté commence à revenir, il est important que les écoles continuent à fournir du soutien pour permettre aux élèves d’explorer et d’assimiler leur expérience. Il est également important de discuter des mesures concrètes que les élèves peuvent prendre et de la manière dont ils peuvent prendre part à des activités qui peuvent les aider à acquérir des compétences en matière de résolution de problèmes pour l’avenir.
Les événements liés au climat entraînant davantage de bouleversements et de perturbations au sein d’un grand nombre de groupes de population, il est important que les écoles et les systèmes élaborent des plans pour soutenir à la fois leurs élèves et leur personnel. Comme le montre la situation vécue dans les T.N.-O., la réponse se fait par étapes, depuis les besoins immédiats liés à l’évacuation jusqu’aux inquiétudes, préoccupations et conséquences à long terme d’une évacuation prolongée. Les circonscriptions scolaires sont encouragées à veiller à disposer de plans de « retour à l’école » qui comprennent des mesures de soutien à plus long terme en matière de santé mentale pour les élèves et les familles. Elles sont également encouragées à promouvoir des mesures à long terme pour faire face aux crises liées au climat qui sont de plus en plus fréquentes partout au pays.
Cet article de Merril Dean est paru à l’origine dans le bulletin d’automne-hiver de la Section de l’éducation et de la psychologie scolaire de la SCP.
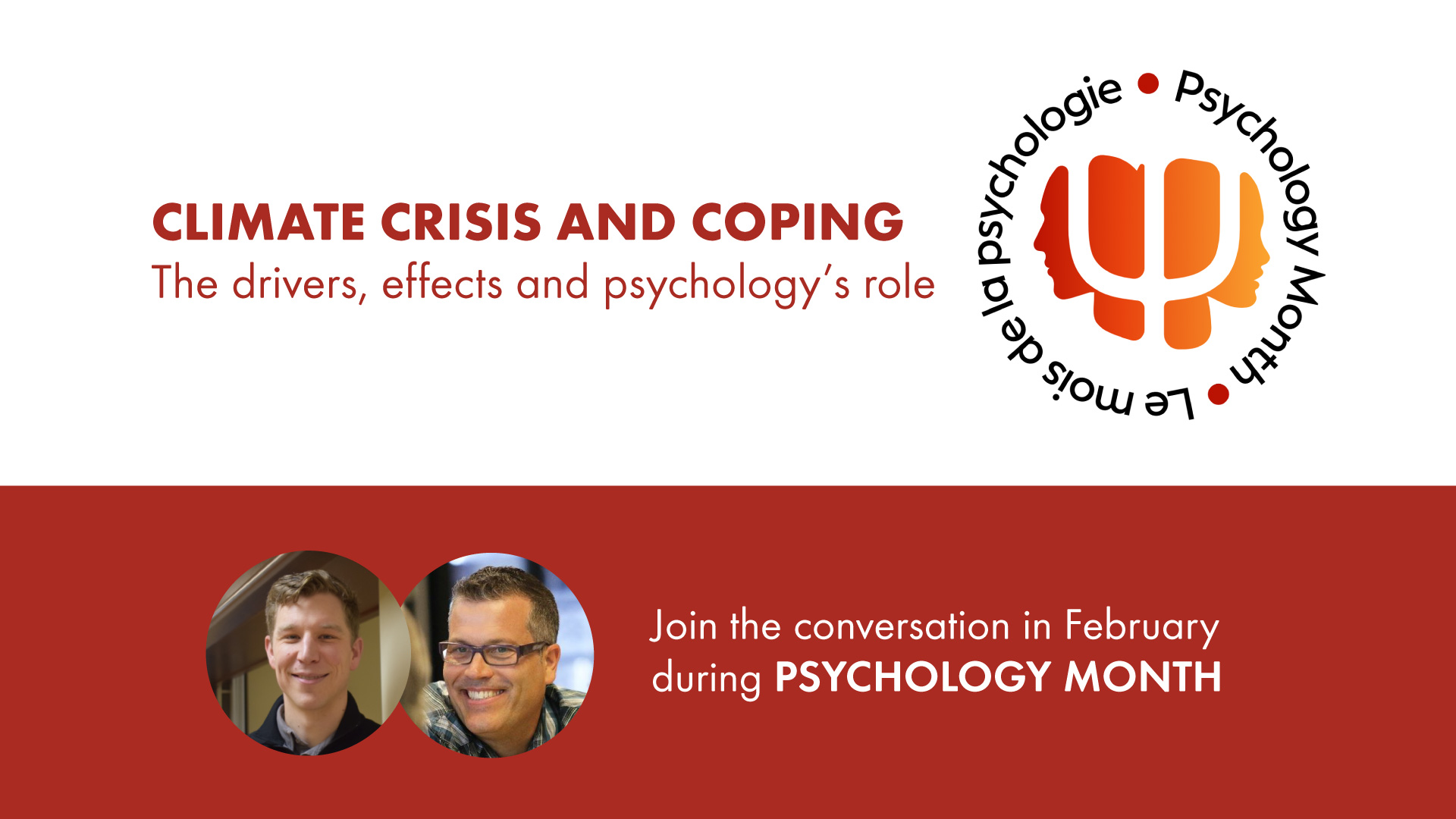
Dr Todd Kettner et Dr Kyle Merritt
Nelson, en Colombie-Britannique, était tout près de certains des événements climatiques les plus extrêmes et dévastateurs de 2021. Le dôme de chaleur et les feux de forêt ont eu un effet profond sur la ville et les environs. Le Dr Todd Kettner et le Dr Kyle Merritt sont intervenus pour faire quelque chose à ce sujet dans leurs propres pratiques et milieux de travail. Le Dr Kettner est psychologue et le Dr Merritt est médecin urgentologue. Ils font tous deux partie d’une organisation appelée Doctors and Nurses for Planetary Health, formée à la suite de la dévastation de 2021.
Fin juin 2021, la Colombie-Britannique vivait sous un « dôme de chaleur ». Les températures atteignaient régulièrement les 50 degrés Celsius et, le 1er juillet, près de 500 feux de forêt brûlaient dans la province, dont celui qui a détruit la ville de Lytton. À Nelson, dans la région de Kootenay, le Dr Todd Kettner, psychologue, déménageait avec sa conjointe dans un nouveau lotissement à faible empreinte écologique. Le lendemain de la prise de possession de la dernière maison de ce hameau, un incendie s’est déclaré à un kilomètre de là. Ces bâtiments écologiques étaient désormais occupés par des propriétaires inquiets, à mesure que s’accumulaient sur leurs beaux toits neufs les braises de l’incendie voisin.
Au centre médical de Kootenay, à Nelson, le Dr Kyle Merritt, chef du service des urgences, a vu arriver des patients présentant des symptômes liés à la fumée des feux de forêt et au dôme de chaleur. Les problèmes cardiaques aigus sont plus fréquents en présence de fumée de feu de forêt dans la région, et d’autres problèmes de santé peuvent s’aggraver en cas de chaleur intense. L’hôpital ne se trouvait pas en situation de débordement, mais la situation était suffisamment préoccupante pour que le Dr Merritt intervienne et, ce faisant, fasse la une des journaux.
« J’ai rencontré une patiente ayant été admise à cause de la chaleur causée par le dôme. J’ai donc consigné mes observations par écrit, comme le font tous les médecins lorsqu’ils ont un patient devant eux, et dans ma note, j’ai indiqué que le changement climatique était la cause sous-jacente. De la même manière que vous diriez qu’une personne a fumé toute sa vie et qu’elle est maintenant atteinte d’un cancer du poumon. Vous ne diagnostiquez pas qu’une personne a fumé des cigarettes, vous lui diagnostiquez un cancer du poumon, mais vous pouvez écrire que l’usage du tabac est la cause sous-jacente. »
Ce geste a fait sensation, car les journaux locaux et étrangers ont repris l’histoire d’un médecin qui avait diagnostiqué le changement climatique chez une patiente. Bien sûr, ce n’est pas vraiment ce qu’a fait le Dr Merritt. On ne peut pas « diagnostiquer » un changement climatique à une personne, et la mention de la cause sous-jacente n’est pas la même chose que le diagnostic. Mais un titre à sensation reste une force puissante dans notre société, et l’histoire s’est répandue comme de la menthe dans mon jardin.
Note de l’auteur : Il est peut-être temps de mettre à jour nos expressions idiomatiques lorsqu’il s’agit de la vitesse à laquelle quelque chose se propage. À l’heure actuelle, la quasi-totalité de ces expressions fait référence à des maladies de type pandémique ou à des feux de forêt. Il me semble que ce n’est pas la bonne expression à utiliser, étant donné que nous sommes toujours confrontés à une pandémie mondiale qui a tué des millions de personnes et que, dans le cas présent, nous parlons de feux de forêt qui ont déplacé des milliers de personnes et causé plusieurs décès. C’est pourquoi je suggère humblement d’utiliser « se répand comme de la menthe dans mon jardin ». Lançons le mouvement!
La chaleur, les incendies et les problèmes dévastateurs qu’ils ont causés ont incité le Dr Merritt à se joindre à quelques collègues pour créer un organisme appelé Doctors and Nurses for Planetary Health (DNPH) (médecins et infirmières pour la santé de la planète). Dans un contexte où les professionnels de la santé constataient les effets directs du changement climatique sur la santé des personnes qu’ils soignent, ils se sont dit qu’ils pouvaient faire plus. Depuis, l’organisation s’est élargie pour inclure des professionnels de la santé de toutes sortes, dont le Dr Kettner. Il s’agit à la fois d’un groupe de pression, d’un organisme consultatif et d’un collectif, dont l’objectif est de faire de la lutte contre le changement climatique un élément central de ses propres pratiques à Nelson et dans les environs.
Nelson est une petite localité de la région de Kootenay composée d’une population d’environ 10 000 habitants et fortement associée au secteur des ressources. C’est une ville dont la création il y a 130 ans tire son origine de l’exploitation minière et qui entretient toujours des liens étroits avec le secteur forestier. À l’instar de nombreuses petites villes au cadre pittoresque, ses résidents ont tendance à se sentir connectés au territoire qui les entoure. Si l’on ajoute à cela l’afflux à la fin des années soixante de jeunes étatsuniens, pour la plupart libéraux, qui ont fui la conscription associée à la guerre du Vietnam, on obtient le genre de ville où la création d’un collectif tel que Doctors and Nurses for Planetary Health n’est pas si incongrue. Comme le dit le Dr Kettner, Nelson s’en va sur ses « 50 ans de vie hippie ».
Deuxième note de l’auteur : Je voulais vraiment intituler ce texte « 50 ans de vie hippie » parce que j’adore cette tournure. J’ai même promis, lorsque je l’ai entendue, que je le ferais. Mais je me suis ravisé au dernier moment, car je suis réticent à renforcer le stéréotype négatif selon lequel l’action climatique et l’intérêt pour les questions environnementales sont quelque chose d’éthéré qui n’appartient qu’aux hippies vieillissants et aux jeunes musiciens punks. Il s’agit, bien sûr, d’un sujet qui nous concerne tous et dont les gens de tous les milieux se préoccupent, au-delà de toutes frontières culturelles.
Bien que les membres de DNPH soient des militants écologistes sous une forme ou une autre, c’est leur position en tant que prestataires de soins de santé qui confère à leur message une certaine autorité. Selon le Dr Kettner, « si l’on regarde à qui les gens font confiance lorsqu’il s’agit d’environnement, ce ne sont ni aux politiciens, ni aux militants écologistes, ni aux bûcherons, ni aux mineurs, mais souvent aux professionnels de la santé – les infirmières ou leur médecin de famille ».
Ces dernières années, nous avons assisté à une érosion de la confiance du public à l’égard des professionnels de la santé. Des gens qui manifestent dans les hôpitaux, des gens qui perturbent la vie de tous les autres parce qu’ils croient à tort que le vaccin contre la COVID-19 serait en quelque sorte responsable d’un plus grand nombre de décès que la COVID-19 elle-même. Si ces gens sont les plus bruyants, ils ne représentent pas la majorité des Canadiennes et Canadiens, et la médecine reste une profession qui jouit de la confiance générale de la population.
C’est particulièrement vrai à Nelson. Une autre raison pour laquelle les Drs Merritt et Kettner et leur groupe parviennent à obtenir des résultats est que Nelson est une très petite ville. Les personnes avec lesquelles vous jouez au hockey le mardi soir sont les mêmes que celles que vous voyez à l’épicerie et celles qui vous demandent une aide professionnelle. Dans le cas du Dr Merritt, cela signifie qu’il a des patients dont il est le médecin depuis leur naissance. Pour le Dr Kettner, cela signifie que sa pratique et son travail sont étroitement liés à la communauté, qu’il considérait déjà comme son foyer bien avant de devenir psychologue. Les relations entre les membres de la communauté créent des liens solides, difficiles à rompre. Le genre de liens qui peuvent résister à la tempête de la désinformation en ligne.
Le groupe DNPH a été très efficace à plusieurs égards (projets locaux d’infrastructures et de transport, réduction de l’empreinte de son système de santé), mais son plus grand exploit est peut-être celui d’avoir réussi à établir un lien entre la santé planétaire et la santé humaine. Récemment, le groupe a collaboré avec la Ville pour augmenter la distribution d’électricité dans les foyers tout en réduisant la quantité de combustibles fossiles dans ces foyers. Cette démarche est non seulement bénéfique pour l’environnement, mais elle améliore aussi la santé des personnes qui ne sont plus exposées à des émissions à l’intérieur de leurs propres murs.
Selon le Dr Merritt, « il ne peut y avoir de santé humaine sans un climat stable, un air sain et une eau saine. Pour certaines personnes, ce lien n’est pas aussi évident, et nous essayons d’intégrer cette notion dans tout ce que nous faisons. »
Dans tous les domaines d’activité, il existe de multiples possibilités de faire des choix durables et respectueux de l’environnement. En santé, ces choix s’accompagnent presque toujours d’un bénéfice pour la santé. Dans le cas du Dr Merritt, il s’agit de petites choses, comme le recyclage des piles et batteries utilisées dans l’hôpital, et de plus grandes choses, comme s’attaquer au problème des gaz anesthésiques et des inhalateurs qui contiennent des hydrofluorocarbures et des chlorofluorocarbures, importants contributeurs au changement climatique.
« L’un des avantages que j’ai à travailler dans le domaine des soins primaires au sein d’un système public est que j’ai l’occasion d’interagir avec des personnes de tous horizons, de la naissance à la mort, au sein de ma communauté. Cela me donne l’occasion d’apprendre à connaître ce qu’ils vivent. Et aux urgences, lorsque des événements tels que des feux de forêt ou la chaleur surviennent, ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont touchées. C’est aussi le cas pour la santé mentale : on observe lors de ces événements une exacerbation aiguë des symptômes des personnes ayant des problèmes de santé mentale, et celles-ci se présentent alors aux urgences. Une partie de notre rôle consiste à plaider en faveur de la santé, et le changement climatique en fait désormais partie. »
Troisième note de l’auteur : Selon le Dr Kettner, les nouvelles et informations récentes sont l’une des façons de maintenir le changement climatique au premier plan des préoccupations des gens et de les inciter à y prêter attention. Cela fait un moment que nous entendons parler des ours polaires, du pergélisol et de la Grande Barrière de corail, et certains ont fini par se désintéresser de ces enjeux. Une nouveauté susceptible de piquer l’intérêt d’une personne au cours d’une conversation pourrait la ramener à réfléchir à la question du climat. Par exemple quelque chose comme « Savais-tu que les gaz anesthésiques sont un contributeur important à la destruction de la couche d’ozone et au réchauffement par effet de serre? ».
Pour le Dr Kettner, sa participation à des organismes comme DNPH lui permet de partager son savoir-faire relativement aux effets du changement climatique sur la santé mentale. Son travail avec le MIR Centre For Peace du Selkirk College lui a permis d’aborder la crise climatique sous un angle supplémentaire, celui de l’intersectionnalité. Non seulement y a-t-il un recoupement entre santé physique et santé mentale, mais il existe une corrélation importante entre le changement climatique et la paix mondiale, la justice sociale et les inégalités.
« J’ai maintenant l’impression de me concentrer sur les questions les plus importantes : les déterminants sociaux de la santé, un meilleur accès aux services de santé mentale pour un plus grand nombre de personnes, le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones. C’est là que je veux concentrer une grande partie de mon énergie au cours des 20 dernières années de ma carrière professionnelle. »
Quatrième note de l’auteur : Lors de notre discussion sur la réconciliation avec les Autochtones, nous avons parlé du principe de la septième génération des Haudenosaunee. Il s’agit d’une philosophie à laquelle les Haudenosaunee adhèrent depuis des centaines d’années et qui veut que nous ne soyons pas seulement les gardiens de notre environnement pour nous-mêmes et nos descendants, mais aussi pour leurs descendants et la génération suivante, et ainsi de suite. Le Dr Merritt nous a fait part d’une information intéressante, que ce soit pour réfléchir à son application au Canada ou pour vous aider un jour à gagner à Jeopardy!. En 2015, le gouvernement du Pays de Galles a créé un nouveau poste : commissaire aux générations futures. C’est Sophie Howe qui a occupé ce poste jusqu’en 2023 et son successeur est Derek Walker.
Il y a plusieurs villes dans la région de Kootenay, et tant le Dr Kettner que le Dr Merritt évoquent une sorte de rivalité Springfield-Shelbyville entre ces villes. Mais cette rivalité disparaît rapidement lorsqu’il s’agit d’adopter des pratiques durables, en particulier à la suite des récents événements climatiques désastreux. Le Dr Kettner décrit la situation au moment où les feux de forêt de 2021 s’atténuaient.
« Des enseignants m’ont contacté depuis d’autres villes de la Colombie-Britannique à la recherche de ressources pour aider leurs élèves à surmonter leur anxiété lors du retour à l’école après les feux de forêt ravageurs qui les avaient renvoyés chez eux pendant un mois. C’est le genre d’appel que je ne recevais pas en tant que praticien privé recevant une personne dans mon cabinet pour une dépression. Élargir notre champ d’influence auprès du public et de nos patients est une chose qui me tient à cœur. »
Sortir du cadre de son travail immédiat est toujours un peu risqué. Cela signifie faire quelque chose qui se situe en dehors de notre zone de confort et s’exposer à une certaine dose de venin de la part des détracteurs qui exigent que l’on « reste à sa place ». Cela peut sembler un peu moins risqué dans un endroit comme Nelson, en Colombie-Britannique, mais il faut tout de même faire preuve d’un peu d’audace. Le fait que Todd et Kyle aient franchi ce pas témoigne de la passion qui les anime et de la nécessité immédiate d’agir, et leurs actions ont eu des retombées majeures.
Le groupe DNPH a participé activement au nouveau plan de transport actif de la Ville, en veillant à ce qu’il soit aussi durable et respectueux de l’environnement que possible. Quelques médecins et infirmières du groupe présentent certaines de leurs avancées aux villes voisines. Le groupe travaille avec des experts forestiers relativement à des terrains adjacents à la ville, afin de réduire les risques d’incendie tout en améliorant l’accès de la population aux bienfaits pour la santé mentale d’une promenade dans les bois. Ils sont désormais associés à de nombreuses décisions importantes et leur avis est sollicité sur des projets qui n’ont pas grand-chose à voir avec les soins de santé, à l’exception du thème central de Doctors and Nurses for Planetary Health, à savoir que la santé planétaire et la santé humaine sont inextricablement liées.
Note finale de l’auteur : Pendant que nous parlions, le Dr Kettner s’est souvenu avec émotion d’une série de publicités télévisées de sa jeunesse, qui mettaient en scène le glacier Kokanee dans des publicités pour la bière Kokanee. Il a déploré la vitesse à laquelle ce glacier disparaît aujourd’hui, rappelant une fois de plus les effets dévastateurs du changement climatique, là, dans sa propre arrière-cour. Au cours de cette discussion, nous avons découvert que la bière Kokanee est encore aujourd’hui l’une des marques les plus vendues au Canada. Cela m’a surpris, car je ne pensais pas qu’elle était encore brassée, du moins pas depuis mon passage au secondaire, époque à laquelle j’ai vu ces publicités. J’ai trouvé cela suffisamment intéressant pour l’ajouter à cet article – il semble que la Kokanee ait une bien plus grande longévité que je ne l’imaginais!
Une longévité à laquelle n’auront malheureusement pas droit les glaciers.

Nous lançons le Mois de la psychologie en février en parlant de la confiance avec la Dre Katherine Arbuthnott dans le balado de la SCP Mind Full. Nous avons tendance à penser que les autres sont intéressés par eux-mêmes, et nous sommes donc pessimistes sur des choses comme notre capacité à aborder des sujets majeurs comme le changement climatique. LA Dre Arbuthnott est ici pour nous dire que ce n’est pas vraiment le cas – que la plupart des gens sont, en fait, prêts à faire des sacrifices pour le bien des communautés et des gens qui les entourent. parlant de la confiance avec la Dre Katherine Arbuthnott dans le balado de la SCP Mind Full. Nous avons tendance à penser que les autres sont intéressés par eux-mêmes, et nous sommes donc pessimistes sur des choses comme notre capacité à aborder des sujets majeurs comme le changement climatique. LA Dre Arbuthnott est ici pour nous dire que ce n’est pas vraiment le cas – que la plupart des gens sont, en fait, prêts à faire des sacrifices pour le bien des communautés et des gens qui les entourent.
Le thème du Mois de la psychologie 2023 était « L'avenir de la psychologie », où nous avons présenté des étudiants en psychologie qui font des choses étonnantes ailleurs qu’en classe.

Marjolaine Rivest-Beauregard et Justine Fortin
Les étudiantes en psychologie de Montréal Marjolaine Rivest-Beauregard et Justine Fortin ont créé le balado Sors de ma tête au début de la pandémie de COVID-19 pour contrer la désinformation et rendre la science accessible aux non-scientifiques. Elles se sont joints au balado de l’SCP, Mind Full, pour discuter de leur travail qui s’est un peu élargi au moment où ils se préparent à lancer leur troisième saison.
Le transfert des connaissances est une compétence rare, que ne possèdent pas nécessairement la plupart des personnes qui pratiquent une discipline scientifique. Pour être bon dans le transfert des connaissances, vous devez posséder une base de connaissances dans votre domaine, mais aussi un style de communication qui incite ceux qui ne font pas partie de votre milieu scientifique à vouloir en savoir plus sur ce sujet. Le transfert des connaissances nécessite également une capacité à prendre de la hauteur par rapport aux connaissances scientifiques. Qu’est-ce que les gens ordinaires aimeraient savoir? Comment puis-je leur expliquer cela tout en restant aussi fidèle que possible au matériel source? Quels sont les mots que je pourrais utiliser et qui pourraient perdre mon public, et quelle terminologie et quels concepts apparemment complexes pourraient être saisis intuitivement?
Comme pour toutes les compétences que l’on peut perfectionner, l’un des meilleurs moyens de devenir un bon vulgarisateur est de s’entraîner. C’est dans cet esprit que Marjolaine Rivest-Beauregard et Justine Fortin se sont lancées dans un projet qui leur était cher : expliquer des concepts et des études psychologiques complexes au grand public dans le but de lutter contre la désinformation en ligne.
Justine et Marjolaine sont sur le point de lancer la troisième saison de leur balado francophone Sors de ma tête. Étudiantes en psychologie et collègues, résidant à Montréal, elles ont commencé ce projet en 2021 en s’intéressant à la COVID-19 et à la désinformation qui l’entoure. Elles voulaient recueillir les données dont elles disposaient sur la COVID-19, puis s’entretenir avec deux autres personnes. Un expert ou une experte pour parler de la science, et quelqu’un qui dispose d’une grande plateforme publique pour parler directement aux gens.
Justine est à l’UQAM, Marjolaine à McGill. Elles se sont connues parce qu’elles avaient le même superviseur, le Dr Alain Brunet. Celui-ci a bien sûr été le premier invité de l’émission (voir le balado de la SCP, Mind Full, où la première invitée est la Dre Karen Cohen, chef de la direction) pour discuter des réactions émotionnelles des gens à la COVID-19 et aux confinements. L’autre invitée de leur premier épisode était Cassandra Bouchard, créatrice de contenu sur Instagram. Cassandra publie des vidéos amusantes en ligne et parle de problèmes de santé mentale – relations toxiques, arrêt du tabac, troubles de l’alimentation, etc.
Le processus de sélection d’un influenceur en ligne pour participer à Sors de ma tête est probablement plus ardu que le processus de sélection de l’expert. Après tout, dans la plupart des domaines, il est facile de savoir qui possède l’expertise, mais pour ceux et celles qui ont un public et qui discutent de problèmes de santé mentale sur leurs plateformes, il est un peu plus difficile de déterminer qui possède à la fois les compétences et le talent de communicateur nécessaires pour faire le lien avec le public. Selon Marjolaine, voici quelques caractéristiques que ces personnes doivent posséder :
- Elles parlent ouvertement et souvent de santé mentale.
- Elles sont prêtes à parler ouvertement de leurs propres histoires et expériences.
- Elles sont disponibles le jour et l’heure où le balado sera enregistré!
Justine dit qu’elles regardent aussi l’auditoire des personnes qu’elles invitent. Elle explique : « Nous ne sommes pas connues des 18-35 ans, donc les personnes qui ont un grand nombre d’abonnés sont les bienvenues. Notre objectif est de toucher le plus de gens possible. » Elle ajoute que c’est en grande partie une question de personnalité et d’énergie. Elle essaie d’associer des personnes ayant un niveau d’énergie similaire et une bonne chimie entre elles pour une discussion qui produit un bon balado. L’obtention d’un jumelage réussi n’est pas une mince affaire, mais peut produire un contenu très enrichissant. Justine confie :
« L’un de mes épisodes favoris est le dernier que nous avons fait en 2022 [Trahison amoureuse avec Michelle Lonergan et Marie Gagné]. On s’est tellement amusées, on riait tout le temps, on parlait des trahisons qu’on avait vécues, des béguins qu’on avait eus étant enfants. C’est un sujet un peu triste, mais la conversation était légère et super agréable. »
Actuellement, Marjolaine se concentre sur la recherche. Elle espère obtenir son doctorat et poursuivre ses recherches sur les effets des catastrophes et des crises sur la santé mentale, dans une optique de prévention. Elle aimerait également être consultante en gestion de crise, c’est-à-dire quelqu’un qui permet de mobiliser les interventions en situation de catastrophe (le tremblement de terre en Turquie, la récente tragédie à Laval) d’une manière solide sur le plan scientifique et fondée sur des preuves.
Le parcours professionnel de Justine, du moins tel qu’elle le voit en ce moment, est un peu différent. Elle se concentre à la fois sur la recherche et sur le travail clinique, et espère un jour ouvrir une clinique en tant que neuropsychologue. Elle souhaite vraiment continuer à travailler avec les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer et parle avec passion du « chimio-cerveau » et des autres problèmes qui touchent les personnes traitées pour un cancer. Elle souhaite également continuer à faire de la recherche, et déclare : « Je ne veux pas être professeure en tant que telle, mais j’aimerais continuer à faire de la recherche. Peut-être dans le laboratoire de Marjo! »
Il est à espérer que ces deux partenaires et collaboratrices continueront à travailler ensemble sur des projets, petits et grands. La troisième saison de Sors de ma tête sera lancée très prochainement, et si Justine et Marjolaine restent discrètes sur le contenu de cette année, elles ont laissé entendre que les changements climatiques seront un sujet de premier plan en 2023.
On ne sait pas encore combien de temps le balado va durer. Est-ce que ce sera un projet qu’elles maintiendront jusqu’à la fin de leurs études? La fin de la COVID-19? Peut-être beaucoup plus longtemps? Seul le temps nous le dira. Ce qui est certain, c’est que ce sont des personnes comme Justine et Marjo, qui ont consacré temps et énergie au transfert des connaissances, qui seront les vulgarisatrices du savoir de demain. Des personnes qui peuvent combler le fossé entre les scientifiques et le public, qui peuvent pousser les gouvernements à prendre des décisions qui reposent sur des données concrètes et des études qui ne sont pas connues. Avec le balado Sors de ma tête, elles ont déjà passé deux ans à faire précisément cela.

Nardeen Yalda
Notre balado Mind Full a donné la parole à Nardeen Yalda et à sa professeure à l’Université Western, la Dre Leora Swartzman. La Dre Swartzman a créé un programme visant à jumeler des étudiants avec des organismes communautaires afin de mettre en œuvre le changement sur le terrain. Ce programme a permis à Nardeen de collaborer avec des organismes qui aident les sans-abri.

Nancy Tangon
Nancy Tangon est une représentante des étudiants de la SCP à l’Université de l’Alberta. Sa famille originaire du Soudan du Sud a exercé une influence considérable sur sa vie, y compris sur sa décision de faire carrière en psychologie.
Avec son amie Priscilla Ojomu, Nancy a créé le forum en ligne Canada Confesses, qui recueille des témoignages anonymes de personnes qui mettent en lumière le racisme latent dans la société canadienne. Elles parlent de leur projet dans le balado Mind Full de la SCP https://soundcloud.com/user-389503679/mindful-9-canada-confesses-01162023-mixdown-1/s-Y9IhuOvB5gY
« Nous avons fait un camp d’entraînement de trois heures sur Zoom sur la façon de créer une présentation et de devenir un bon conférencier. »
La première leçon, lorsqu’il s’agit de créer une présentation, est de faire en sorte que cette présentation ne dure pas trois heures. Mais un camp d’entraînement? Cela peut durer aussi longtemps que vous le voulez. Dans ce cas, Nancy Tangon et ses collègues étudiants représentant la SCP à l’Université de l’Alberta ont choisi le format « camp d’entraînement » — et le format Zoom — par nécessité. En raison de la pandémie, bien des choses sont devenues plus compliquées. Trouver des moyens de communiquer de manière virtuelle avec les gens a engendré un certain chaos, mais aussi beaucoup de créativité!
Ce fut le cas lorsque Nancy et sa camarade Priscilla Ojomu ont voulu créer un projet. Avant la pandémie, elles se sont rencontrées dans le cadre du programme de sensibilisation à la diversité et de développement des compétences pour les jeunes de l’organisme On-Site Placement offert sur le campus — en personne, si vous vous souvenez de l’époque où cela se faisait! Grâce à ce programme, elles ont appris beaucoup de choses sur la question de la diversité dans différents contextes, et ont été chargées de créer un projet à la fin du cours. Malheureusement, à ce moment-là, la COVID-19 a surgi et le projet a dû passer en mode virtuel.
Au cours de la pandémie, les gens sont devenus plus conscients de plusieurs problèmes, notamment ceux liés à la discrimination et aux inégalités. Au Canada, beaucoup d’entre nous se sentaient étrangers à ces questions, comme s’il s’agissait d’une particularité américaine ou que nous faisions d’une certaine manière mieux que les autres. Comme le dit Priscilla, « beaucoup de Canadiens ne savent pas que ces problèmes existent partout au Canada ». Alors, comment Nancy et elle pouvaient-elles contribuer à cette prise de conscience?
Leur réponse est Canada Confesses, un projet qui, au départ, était modeste, mais qui, depuis, a pris une ampleur et une signification beaucoup plus grandes. Le concept du projet était simple. Il y a un décalage entre ce que Nancy et Priscilla ont appris dans leur programme, ainsi que leurs propres expériences, et ce que les autres Canadiens comprennent de la situation. Elles ont donc créé un lieu où les personnes marginalisées peuvent raconter leur histoire de manière anonyme, accéder à des ressources pouvant les aider, et aider les autres Canadiens à comprendre la vérité sur ce qui se passe dans notre pays. Ce n’est pas la personne qui publie anonymement un message qui se confesse, même si on appelle ces messages des « confessions » — c’est le Canada lui-même qui avoue les préjudices que subissent aujourd’hui de nombreuses communautés ainsi que la marginalisation structurelle de plusieurs d’entre elles. Pour tout savoir sur Canada Confesses, écoutez le balado Mind Full de la SCP.
En tant que co-créatrice de Canada Confesses, Nancy n’a pas encore présenté sa propre « confession » — elle est très occupée! En plus de gérer une plateforme en ligne qui connaît un succès soudain et qui continue de croître à pas de géant, elle en est également à sa quatrième année d’études à l’Université de l’Alberta, où elle effectue une majeure en psychologie et une mineure en sciences biologiques. Elle est très présente au sein de la SCP : elle a été pendant deux ans représentante des étudiants sur le campus et a joué un rôle important au Comité des droits de la personne et de la justice sociale de la SCP en tant que responsable du groupe de travail sur la discrimination fondée sur le capacitisme et les handicaps.
« J’étais un peu intimidée [à l’idée de rejoindre le Comité des droits de la personne et de la justice sociale]. Toutes les personnes qui en font partie sont soit des étudiants de cycle supérieur, soit des professeurs, et au début, j’avais un peu l’impression d’être l’étudiante de premier cycle qui suivait derrière. Mais c’est vraiment génial! J’ai beaucoup appris de la Dre Ada Sinacore et de la Dre Laurie Ford, qui font également partie du sous-comité. »
Nancy, qu’elle soit finissante ou non, apporte beaucoup d’expérience au comité du conseil d’administration de la SCP — et à sa propre vie, ses études et ses activités. Cela tient en grande partie à sa famille et à sa communauté, dont elle est très proche. Sa famille, du côté de son père, est originaire de la tribu Bari, au Soudan du Sud, un endroit où Nancy n’a pu se rendre qu’une seule fois. Elle garde le contact et correspond avec les membres de sa famille qui vivent encore là-bas, et entretient également des liens étroits avec la communauté sud-soudanaise d’Edmonton.
« La communauté sud-soudanaise d’Edmonton est assez importante, je connais beaucoup de gens ici — surtout lorsque je compare avec l’époque où je vivais à Halifax avec ma famille. Je croise même certains membres de la communauté dans mes cours, ce qui est vraiment bien. Lorsque j’ai décidé d’aller à l’université, je voulais faire quelque chose d’extraordinaire dans ma communauté. Dans la communauté sud-soudanaise, la psychologie est très intéressante pour beaucoup de gens. »
Sa famille et sa communauté sont quelques-uns des facteurs qui ont façonné le désir de Nancy de s’orienter vers la psychologie, et qui l’ont même guidée dans le choix de certains cours qu’elle a suivis une fois à l’université. Dans la famille de Nancy, on adore parler de ses rêves. Elle dit : « Lorsque je me réveille, je dois parler de mes rêves. J’en parle à au moins cinq personnes avant de commencer ma journée! Je dois les analyser un tout petit peu, je dois connaître l’interprétation de quelqu’un d’autre, et j’adore vraiment l’analyse des rêves. » Bien sûr, elle s’est sentie obligée d’étudier cette matière avant d’obtenir son diplôme, et elle parle maintenant avec enthousiasme des niveaux « subjectif » et « objectif » de l’analyse des rêves.
Il n’a pas fallu longtemps à Nancy pour déterminer que la psychologie était le programme qui lui convenait — ou dans quelle direction elle voulait aller.
« Dès le premier jour, mon tout premier professeur m’a motivée. Son nom est Peggy St-Jacques. Elle venait tout juste de commencer à enseigner à l’université, et elle effectuait des recherches sur la mémoire. Je lui ai dit : ‘Je ne sais pas exactement ce que je veux faire comme recherche, mais c’est sûrement en recherche que je veux faire carrière jusqu’à la fin de mes jours’. »
Nancy est maintenant sur la bonne voie, puisqu’elle travaille comme assistante de recherche et envisage un avenir où la recherche fera partie de son quotidien. Elle est particulièrement attirée par la psychologie du développement et espère travailler avec des enfants d’âge préscolaire âgés de trois à cinq ans. La route sera longue, mais Nancy a la détermination, l’ingéniosité et la curiosité nécessaires pour en faire une réussite. Et lorsqu’elle y parviendra, cette réussite s’ajoutera à une longue série de succès qui auront commencé ici même, à Edmonton.
« Lorsque j’ai commencé à travailler au projet Canada Confesses, il était pratiquement impossible de savoir où cela nous mènerait. J’ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes qui travaillent dans le même domaine, et de participer à d’autres projets en ligne. J’ai désormais une amie pour la vie, une équipe formidable, et beaucoup de belles choses à anticiper pour l’avenir. »

Kevin Prada
Kevin Prada est étudiant à l’Université du Manitoba, où ses recherches portent sur les difficultés de la communauté francophone 2SLGBTQ+ au Manitoba.
Kevin et ses collègues, y compris Thilini Dissanayake, ont lancé une initiative dans leur région appelée A Listening Ear. Ils se sont joints au balado de l’SCP Mind Full pour expliquer le projet.
https://soundcloud.com/user-389503679/psychology-month-kevin-prada-and-thilini-dissanayake-lend-a-listening-ear/s-Ze0rXFQvsaN
« Le français est une langue assez binaire. On n’y pense peut-être pas, mais comment devenir neutre dans une langue qui dépend si fortement de la binarité de genre? »
Nous entendons beaucoup parler d’« intersectionnalité » ces derniers temps, en référence à la façon dont les catégorisations sociales interagissent les unes avec les autres. Un individu ou un groupe peut être lié aux autres en fonction de sa race, de sa sexualité, de son genre ou de son statut socio-économique, ainsi que d’une multitude d’autres identités distinctes, mais inextricables. En tant que telle, l’identité de chaque personne est unique, mais chacune se connecte et se croise, et se superpose à d’autres, ce qui entraîne des formes singulières d’oppression ou de stigmatisation pour certaines, des privilèges pour d’autres, ou un mélange des deux pour d’autres encore.
C’est le cas pour nous tous, mais peu d’entre nous ont une conscience aussi aiguë de cette intersectionnalité que Kevin Prada, tant sur le plan personnel que dans ses recherches. Kevin est étudiant au programme spécialisé en psychologie de l’Université du Manitoba. Franco-Manitobain et queer, Kevin constate depuis longtemps les lacunes du système de santé mentale manitobain, qui affectent tant la communauté 2SLGBTQ+ que la communauté francophone. Cela l’a amené à collaborer à son premier grand projet de recherche[i], qui lui a valu le Prix Ken Bowers pour la meilleure recherche réalisée par un étudiant, décerné par la SCP.
Sa recherche portait sur ces deux identités – les communautés 2SLGBTQ+ et les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Manitoba. Dans la première étude de ce genre réalisée dans l’Ouest canadien, Kevin et ses collègues ont lancé une analyse exploratoire des besoins des Manitobains qui sont à la fois francophones et membres de la communauté 2SLGBTQ+, et donc, doublement minoritaires. Lancé par le Collectif LGBTQ du Manitoba, dont le premier mandat était de recueillir des données sur les besoins de cette communauté très spécifique, ce projet communautaire a été mené par des chercheurs de l’Université de Saint-Boniface.
« Avant de commencer à faire quoi que ce soit pour une communauté, nous devons mieux comprendre où elle en est, quels sont ses besoins et quelles sont ses expériences sur le plan de la discrimination et de la stigmatisation. Nous savons que les populations francophones minoritaires du Manitoba affichent des indicateurs de santé inférieurs à ceux de la population générale. Nous savons que des tendances similaires ont été observées dans l’ensemble des populations queers au Canada et à l’étranger. Lorsque les deux identités sont réunies, il est logique que ces problèmes s’aggravent. »
Ce projet a toujours été conçu comme un projet de recherche à volets multiples. Kevin et ses collègues ont terminé la première phase du projet, en sondant 80 personnes âgées de plus de 18 ans. Les deuxième et troisième phases ont déjà commencé et se concentrent sur les contextes scolaires et familiaux, pour déterminer à la fois les besoins des mineurs francophones queers et en questionnement en milieu scolaire, et aussi pour examiner la transition vers la parentalité pour les familles queers dans un contexte de langue officielle minoritaire. Cela lui a valu de nombreuses occasions de prendre la parole lors de journées de perfectionnement professionnel pour des écoles d’immersion française et des circonscriptions scolaires francophones, qu’il commente ainsi :
« Beaucoup de membres du personnel sont prêts et désireux de créer proactivement des classes accueillantes pour les personnes queers, mais ne savent pas toujours par où commencer. Il s’en est suivi des questions et des discussions très utiles, qui m’ont montré à quel point il est important de discuter avec les gens de ces questions parfois complexes et ce, de manière ouverte et non menaçante, en particulier en tenant compte des implications qu’elles pourraient avoir dans les environnements scolaires. »
Lorsque l’intersectionnalité est abordée de la bonne manière, un effet d’entraînement se produit souvent, parfois de manière délibérée, parfois de manière involontaire et surprenante. Pour Kevin, ces effets d’entraînement ont été extrêmement positifs et encourageants, et ont renforcé l’orientation qu’il souhaite donner à sa carrière.
« Il y a maintenant des gens, en Alberta et ailleurs, qui s’inspirent de notre projet de recherche pour créer le leur dans leur propre province. Ainsi, les retombées de notre travail ont été encore plus importantes que ce que nous avions prévu. Et pour moi, qui suis un étudiant et un chercheur franco-manitobain queer, le fait d’avoir pu faire cela pour ma communauté m’a beaucoup apporté. Nous avons également mis l’accent sur le fait que ce projet devait être réalisé par la communauté, pour la communauté et à partir de la communauté. Non seulement les membres de la communauté ont été impliqués à chaque étape (moi y compris), mais ils ont également été les premiers à entendre ce que nous avons découvert. Nous avons organisé deux réunions de mobilisation communautaire auxquelles seules les personnes de notre communauté étaient invitées. À la suite de l’une d’entre elles, un participant a déclaré avec émotion : ‘c’est ce que nous savons et disons depuis des décennies – maintenant notre expérience est représentée dans ces données’. Ce fut une sorte d’expérience cathartique pour beaucoup de gens. »
Le grand objectif de Kevin, globalement, est de travailler avec les communautés minoritaires. Pour “entendre le silence et voir l’invisible”, comme il le dit lui-même. Pour lui, c’est comme un mantra qu’il se répète avant de lancer un projet ou de passer à la phase suivante, le genre de leitmotiv qu’il fera un jour broder, encadrer et accrocher au mur devant son bureau pour se rappeler constamment pourquoi il fait ce qu’il fait.
« Utiliser l’intersectionnalité comme l’un des principaux cadres de cette étude était vraiment primordial; elle permet de prendre conscience qu’une personne queer d’expression française ne peut pas être comprise par le seul fait de son identité francophone, ou simplement de sa diversité sexuelle ou de genre. C’est ‘c’est tout cela à la fois’. Ces deux identités ET leur âge, ET leur statut socio-économique, ET leur santé, leur appartenance à une minorité visible, la liste est longue. En fait, nous avons constaté que les répondants étaient assez nombreux à ne pas se sentir les bienvenus dans la communauté francophone en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, OU dans la communauté 2SLGBTQ+ du Manitoba parce qu’ils sont francophones. »
Bien sûr, il existe de nombreuses minorités linguistiques au Manitoba en plus du français. Dans le cadre d’un projet qui n’a rien à voir avec cette recherche, Kevin et ses collègues Saeid Maghsoudi, Thilini Dissanayake et Aman Mir ont lancé une initiative intitulée ‘A Listening Ear’ (une oreille attentive), dans le cadre de laquelle ils ont installé des stands dans toute la ville de Winnipeg pour converser avec de parfaits inconnus dans NEUF langues différentes – les incitant à s’arrêter pour discuter en affichant, par exemple, un drapeau sri-lankais. L’initiative a été couronnée de succès, et vous pouvez en entendre davantage dans le balado Mind Full de la SCP.
C’est le genre d’action de sensibilisation dont Kevin fait sa marque. Dès son plus jeune âge, il a pu constater à quel point il était important de se rapprocher des autres et à quel point la solitude peut être grande lorsque personne ne tend la main. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a choisi la psychologie comme carrière.
« J’ai grandi dans un foyer où les problèmes psychologiques étaient assez importants, notamment ceux de mère. J’ai vu l’échec du système alors que je n’étais qu’un petit garçon à qui personne ne se préoccupait de demander ‘Salut, comment ça va?’. » Chez moi, les tentatives de suicide ont été nombreuses, les épisodes maniaques aussi, et pendant tout ce temps, personne ne s’est arrêté pour se dire : ‘Oh mon Dieu, il y a un petit garçon de huit ans qui vit ici, est-ce qu’il va bien?’. Rétrospectivement, j’ai vu tout cela et je me suis dit que si j’étais passé par là, je n’étais sûrement pas le seul. Si j’ai choisi la psychologie, c’est avant tout pour m’assurer que l’impact collatéral des problèmes de santé mentale est une priorité, en particulier dans les familles qui sont aux prises avec des problèmes de cette nature. »
En grandissant, il a constaté de plus en plus de défaillances dans ce système – pour les jeunes 2SLGBTQ+, pour les communautés francophones, et surtout pour les personnes qui, comme lui, se trouvaient à l’intersection des deux.
« Je n’ai jamais eu l’occasion de parler à une personne queer dans mon enfance et mon adolescence, et encore moins à un psychologue queer. La première fois que j’ai rencontré un conseiller queer a été une véritable révélation pour moi, et je n’ai eu accès au soutien à cet égard qu’à l’âge de 27 ans. C’est donc formidable de pouvoir faire quelque chose pour une communauté marginalisée, en particulier dans le domaine de la psychologie qui, par le passé, a toujours été peu accueillante pour les personnes queers. »
Le but ultime de Kevin est de travailler comme clinicien et de rencontrer les gens, faire connaissance avec eux et offrir un soutien clinique adapté sur le plan culturel. Il ne connaît pas de psychologues cliniciens francophones pratiquant au Manitoba, n’a pas rencontré de psychologues cliniciens queers pratiquant ouvertement dans sa province, et souligne les difficultés extrêmes rencontrées dans la province pour obtenir des informations sur la santé physique et sexuelle queer en français. Il existe sans aucun doute un manque de représentation et, comme le montre sa recherche, un besoin de services plus adaptés à la culture dans la région immédiate dans laquelle vit Kevin. Il veut être l’un des premiers à fournir ces services.
« Avec les bons outils, le bon état d’esprit et une compréhension adéquate des traumatismes et du stress chez les minorités, n’importe qui peut être un bon psychologue clinicien auprès d’une personne queer. Mais on passe à un autre niveau quand on parle en connaissance de cause, sur la base de son expérience personnelle. »
La langue française, de par sa nature même, rend certaines communications difficiles pour la communauté 2SLGBTQ+. Lorsque même une table, un avion à hélice ou un bloc de fromage se voient attribuer un genre masculin ou féminin, cela peut rendre la tâche plus difficile pour les personnes qui ne s’identifient ni à l’un ni à l’autre. En anglais, nous utilisons « they » comme un pronom qui peut être compris par tout le monde. En français, des pronoms tout à fait nouveaux ont été proposés, le plus utilisé étant « iel/iels ». Cependant, à ce jour, ces nouveaux mots ne sont toujours pas officiellement acceptés par l’Académie française.
Appréhender notre identité propre à travers le prisme de l’intersectionnalité peut être un parcours porteur d’autonomie ou de privation de droits, d’oppression ou de valorisation, de confusion ou de clarté. Dans de nombreux cas, c’est tout cela à la fois. Naviguer dans ces eaux n’est pas chose facile, surtout pour les personnes dont les identités croisées sont à la fois marginalisées et en opposition les unes avec les autres. L’expérience personnelle de Kevin, son implication directe dans les communautés touchées et son mantra – « entendre le silence et voir l’invisible », comme il le dit lui-même, font qu’il est bien placé et bien équipé pour être à l’avant-garde du changement dont le Manitoba a désespérément besoin.
[i] Living in a liminal space: Experiences of 2SLGBTQ + official language minority Canadians during the COVID-19 pandemic

Dre Charlene Senn

Dre Lorraine Radtke
Dre Charlene Senn et Dre Lorraine Radtke, Section des femmes et de la psychologie
La Section des femmes et de la psychologie de l’ACP crée une communauté de chercheurs, d’enseignants et de praticiens intéressés par la psychologie des femmes et la psychologie féministe. Dans le cadre du Mois de la psychologie d’aujourd’hui, le Dr Lorraine Radtke et la Dre Charlene Senn discutent du travail qu’elles font dans ce domaine.
Section Femmes et psychologie de la SCP
Nous sommes en 1976. Martha Lear vient d’inventer le terme « deuxième vague féministe » dans le New York Magazine, et ce mouvement est en plein essor. Aux États-Unis, le Titre IX vient d’être adopté, interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans toute école recevant des fonds fédéraux. En Suède, le groupe 8 vient d’être fondé et milite pour l’égalité des salaires, le développement des garderies et la journée de travail de six heures. Au Canada, la SCP tient son congrès annuel dans un hôtel de Montréal.
Il y a un autre hôtel de l’autre côté de la rue, devant celui où se tient le congrès de la SCP. Bien que cet hôtel ne soit pas affilié à celui où se déroule le congrès, les deux établissements sont reliés par un tunnel souterrain qui passe sous la rue. Pendant que le congrès bat son plein, de nombreuses femmes s’éclipsent, passent discrètement dans ce tunnel pour tenir une réunion clandestine de leur côté de la rue. Ces étudiantes diplômées et chercheuses féministes non titularisées sont là pour présenter leurs communications les unes aux autres. Ces communications traitent de sujets relatifs à la psychologie des femmes et des jeunes filles, et elles ont un autre point commun. Lorsqu’elles ont été présentées à la SCP pour être incluses au programme du congrès, elles ont toutes été rejetées sommairement.
Cette réunion hors site, en marge du congrès, a été baptisée « Symposium souterrain ». Ce n’est pas tellement parce qu’elle était clandestine – les médias en ont fait grand cas – mais fort probablement parce qu’on y accédait par le tunnel souterrain reliant les deux hôtels. L’événement a connu un énorme succès, où les idées fusaient et la salle était pleine à craquer. C’est ce succès qui a mené, quatre ans plus tard, à la désignation d’un groupe d’intérêt appelé « Femmes et psychologie ». Ce groupe est devenu plus tard la Section Femmes et psychologie, ou SWAP (Section for Women and Psychology) – et c’est là que nous en sommes aujourd’hui.
Les membres de la Section Femmes et psychologie n’ont pas besoin de s’identifier comme des chercheuses ou des intellectuelles féministes, mais beaucoup d’entre elles le font encore. La présidente de la section, la Dre Lorraine Radtke, maintient certainement la tradition de ce récit des origines. La Dre Radtke est professeure émérite au département de psychologie de l’Université de Calgary, où elle a travaillé pendant près de 40 ans.
« Je m’identifie comme une psychologue féministe parce que j’accorde la priorité aux femmes et aux filles et que j’adopte une perspective critique à l’égard du statu quo. Je m’intéresse aux changements sociaux et à l’amélioration de la vie des femmes et des filles, » explique-t-elle.
La psychologie féministe a changé au fil des ans. L’un des principaux changements est le fait que la recherche et la pratique clinique sont désormais menées dans un cadre intersectionnel. Cela signifie qu’il faut être ouvert aux points de convergence et aux différences entre les femmes et les filles. Cela signifie également être attentif à la manière dont les facteurs sociaux, comme le sexe, l’origine ethnique, la sexualité et la situation socio-économique, influent sur leur vécu. La Dre Charlene Senn est professeure à l’Université de Windsor et affiliée au programme de psychologie sociale appliquée de la même université et dit de ses recherches et des recherches de ses collègues qu’elles sont toujours soucieuses de ce cadre intersectionnel. Elle affirme également que l’étude des femmes et de la psychologie est un sujet plus vaste que ce que beaucoup peuvent penser.
« Je suis une psychologue sociale féministe – la distinction me semble importante car la psychologie est perçue comme étant individuelle, alors qu’en fait elle s’intéresse aussi aux forces environnementales, culturelles et sociales. Je donne un cours de deuxième cycle en psychologie féministe et en psychologie des femmes et du genre. Nous étudions l’énorme travail effectué par les psychologues féministes dans de très nombreux domaines, où la psychologie se transforme grâce au travail qui se fait dans ces domaines. »
La Section Femmes et psychologie n’était pas réservée au départ aux psychologues féministes et elle compte aujourd’hui des chercheuses de tous les domaines, des étudiantes de divers départements du Canada et des psychologues cliniciennes, dont certaines travaillent principalement avec des femmes et des filles.
« Parallèlement à la recherche féministe ou à la recherche liée aux femmes et aux filles, il se fait de la recherche féministe sur une variété de sujets, comme la masculinité, et il existe un axe de recherche qui étudie également le statut des femmes en psychologie et s’intéresse à certaines questions comme les inégalités dans le domaine. Il y a donc une véritable variété », précise la Dre Senn.
La Dre Radtke abonde dans le même sens et déclare que cette grande variété de travaux réalisés sous l’angle de la psychologie des femmes et des filles constitue une grande partie de l’histoire de la section.
« Dans les premières années, les membres de la Section Femmes et psychologie étaient très actives au sein de la SCP et d’autres associations professionnelles au Canada et militaient pour l’égalité entre les sexes et la participation des femmes. Elles plaidaient en faveur de la révision des normes éthiques afin d’y intégrer une dimension qui tiendrait compte des préoccupations des femmes et des filles. La section a toujours eu un côté activiste, et encore aujourd’hui, elle compte un comité de la condition féminine, chargé de veiller à ce que tous les sexes et tous les genres soient égaux au sein de la discipline, et que ces normes continuent d’être respectées ».
C’est grâce à l’approche élargie et à la diversité des membres de la Section Femmes et psychologie et du comité de la condition féminine que la section a pu collaborer avec la Section de la psychologie des autochtones, la Section des étudiants et la Section de la psychologie des communautés rurales et nordiques pour organiser un débat d’experts virtuel lors du congrès de la SCP de 2021, portant sur les conclusions du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et sur son impact sur la psychologie au Canada.
« Ce fut une très belle collaboration et ce fut très réussi. Il a été décidé que le comité ferait le suivi de ce débat d’experts en produisant un rapport non seulement sur le débat lui-même, mais en présentant aussi quelques recommandations. Il s’agit d’une tâche considérable pour un comité qui est relativement petit, qui se concentrera sur cette question au cours de l’année à venir », dit la Dre Radtke.
Le débat d’experts sur les femmes autochtones disparues et assassinées était un événement central au congrès de la SCP de 2021; personne n’a eu besoin de se faufiler l’autre côté de la rue pour exprimer son point de vue. La Dre Radtke souligne que des progrès ont été réalisés tant au sein de la discipline qu’au sein de l’organisation elle-même.
« Il est évident que la SCP est devenue plus égalitaire. Il y a plus de femmes qui assument la fonction de présidente de la SCP, et plus de femmes qui siègent au conseil d’administration que par le passé. Bien que ces problèmes soient moins importants à l’heure actuelle, il y a encore quelques questions qui nécessitent une attention particulière, comme la mise en candidature d’un plus grand nombre de femmes distinguées pour les prix de la SCP. »
Ces questions ne disparaîtront jamais complètement, et il y a encore beaucoup de travail à faire pour les membres de la Section Femmes et psychologie et les psychologues qui travaillent dans le domaine de la psychologie des femmes. Pendant la pandémie, les emplois des maris ont pris le pas sur ceux des femmes – même lorsque la femme est une universitaire, même lorsqu’elle gagne plus que son mari – car la garde des enfants est encore trop souvent perçue sous un angle traditionnellement patriarcal. Les cas de violence à l’égard des femmes continuent d’augmenter, car beaucoup de femmes sont piégées à la maison avec leur agresseur. La Dre Senn, dont la spécialité est la prévention de la violence, dit que lorsque les campus rouvriront, le nombre d’agressions sexuelles reviendra probablement au niveau d’avant la pandémie. En fait, il n’a pas baissé depuis les années 1980.
Le domaine de la psychologie des femmes a beaucoup progressé depuis le Symposium souterrain, mais il reste encore beaucoup à faire pour que le travail des psychologues féministes soit reconnu. Selon la Dre Senn, « nous devons encore faire des efforts pour que les connaissances acquises grâce aux recherches exceptionnelles menées par les psychologues féministes soient davantage intégrées dans la société. » Elle fait une pause et échange un regard complice avec la Dre Radtke. « Y compris dans les manuels d’introduction à la psychologie ».

Dr Joshua Bourdage

Dre Winny Shen
Dr Joshua Bourdage et Dre Winny Shen, Psychologie industrielle et organisationnelle
La psychologie industrielle-organisationnelle est l’étude de la psychologie en milieu de travail. Nous avons parlé au Dr Joshua Bourdage et à la Dre Winny Shen de la culture du travail, la structure organisationnelle et la grande diversité du travail qu’effectuent les psychologues I/O.
Psychologie industrielle et organisationnelle
Lorsque j’étais à l’école secondaire, je suis allé passer une entrevue de sélection après avoir répondu à une annonce que j’avais vue dans le journal. J’ai été embauché sur-le-champ et j’ai été tout de suite intégré. J’ai commencé mon premier quart de travail une heure plus tard, sans avoir vraiment compris ce que le travail impliquait. La toute première chose que l’on m’a fait faire fut de me placer en cercle avec mes nouveaux collègues, les bras autour des épaules des uns et des autres; on a ensuite éteint toutes les lumières et fait jouer « Eye of the Tiger » dans son intégralité. Puis, apparemment suffisamment motivés, on nous a envoyés faire du porte-à-porte pour vendre des abonnements à des produits de boucherie pour la charcuterie Meat of the Month. J’ai alors su qu’il en serait ainsi chaque jour. « Eye of the Tiger ». Chaque jour. Je suis rentré à la maison au milieu de mon premier quart de travail et je ne suis jamais retourné.
C’était les années 1990; on peut le deviner, peut-être, parce que les offres d’emploi paraissaient encore dans le journal, et que les gens pensaient encore qu’« Eye of the Tiger » était la chanson énergisante ultime parce que Jurassic 5 n’avait pas encore fait paraître « Jayou ». C’était aussi avant que la psychologie industrielle-organisationnelle (I/O) ne devienne plus officielle au Canada. Le Dr Joshua Bourdage est professeur agrégé à l’Université de Calgary et le président actuel de la Société canadienne de psychologie industrielle et organisationnelle (SCPIO), la section de la SCP qui s’intéresse au domaine de la psychologie industrielle-organisationnelle. La discipline remonte à plusieurs décennies, la section a été fondée au milieu des années 1970 et, selon le Dr Bourdage, elle s’est vraiment implantée au Canada au début des années 1990.
« Elle repose en grande partie sur le concept d’organisation scientifique du travail et Frederick Taylor [un ingénieur mécanique américain reconnu pour avoir amélioré l’efficacité industrielle au cours du XXe siècle] et sur la façon dont nous pouvons optimiser les personnes et les tâches afin que le travail soit effectué le plus efficacement possible. Notre travail initial portait donc surtout sur la sélection, l’évaluation, le classement et l’augmentation de la productivité. Puis nous nous sommes adaptés, en même temps que le reste de la psychologie, à des concepts tels que le mouvement des relations humaines - l’idée que les gens ont des sentiments, des émotions et un état intérieur. Nous avons ensuite commencé à réfléchir et à nous interroger sur d’autres choses, par exemple : les travailleurs heureux sont-ils des travailleurs productifs? Ou encore, qu’est-ce qui motive les gens, outre la méthode de la carotte et du bâton – les motivations intrinsèques et extrinsèques? C’est là que nous nous penchons davantage sur l’étude du leadership, du changement, de la politique, etc. ».
La Dre Winny Shen est une psychologue du travail et des organisations et travaille à la Schulich School of Business de l’Université York. Elle est la présidente sortante de la SCPIO et ses études portent sur la diversité et l’inclusion, le leadership et le bien-être des travailleurs. Elle souligne que les deux premières guerres mondiales (à ce jour, les deux seules guerres mondiales...) sont le moment où la psychologie I/O est devenue une discipline officielle.
« Le désir d’appliquer la psychologie à la résolution de problèmes pratiques existe depuis le tout début. Les deux guerres mondiales ont été l’un des catalyseurs de la croissance de la psychologie industrielle/organisationnelle en tant que discipline. L’armée et le gouvernement se sont aussi rendu compte qu’il y avait un nombre considérable de personnes et une foule de postes à pourvoir, et ils ne savaient pas vraiment comment affecter les personnes au bon poste, pour s’assurer de tirer le meilleur parti des personnes qui occupent des postes militaires importants. C’est devenu la base d’une grande partie de la psychologie I/O – évaluations, tests d’intelligence, évaluation de la personnalité et analyse des emplois. Après les deux guerres, on a pris conscience qu’un grand nombre de ces processus et de ces compétences pouvaient être appliqués à des organisations et des industries privées, et que beaucoup de personnes avaient été formées dans ce domaine dans le cadre de l’effort de guerre. »
En termes simples, la psychologie I/O, c’est l’étude de la psychologie en milieu de travail. En termes encore plus simples, il s’agit de l’application de principes psychologiques pour étudier le monde du travail – les travailleurs dans le contexte des équipes de travail, dans le contexte de l’organisation dans son ensemble. C’est un domaine qui s’intéresse au travail à de multiples échelles et dans de multiples perspectives. Cela signifie que la psychologie I/O dispose d’un très large éventail de points de vue et de spécialités. La Dre Shen explique :
« Vous trouverez des psychologues du travail et des organisations dans un large éventail d’endroits. Certains psychologues I/O sont des universitaires comme Josh et moi. Nos recherches sont en grande partie axées sur la compréhension des expériences des travailleurs et des phénomènes organisationnels. Vous trouverez des psychologues I/O dans de nombreux contextes pratiques. Nous sommes généralement formés comme scientifiques-praticiens, alors nous faisons les deux. Nous travaillons par exemple pour des organisations, pour veiller à ce que leurs processus d’embauche soient scientifiquement fondés, ou les aider à former leurs employés pour qu’ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour accomplir leur travail. Notre travail pourrait également porter sur la motivation ou le climat – certains des côtés les plus agréables du travail, qui font que les travailleurs vivent des expériences positives au travail et qu’ils ont de bonnes relations avec leurs collègues et l’organisation dans son ensemble. Nous pouvons aussi être des coachs. Nous pouvons travailler dans l’analytique. Certains travaillent dans des domaines très précis, par exemple, un grand nombre de psychologues I/O travaillent actuellement dans le domaine des soins de santé. Beaucoup d’entre nous travaillent en collaboration avec des psychologues de l’éducation sur diverses questions, comme la délivrance de titres et certificats et l’autorisation d’exercer. Une fois que vous savez où chercher, vous nous trouverez à des tas d’endroits! »
Un ancien président de la SCPIO est l’un des psychologues du travail et des organisations qui contribuent à la compréhension des problèmes de santé en milieu de travail, où la collaboration avec de nombreuses autres disciplines de la psychologie fait partie intégrante de la description de poste. Le Dr Bourdage précise.
« L’un de nos présidents précédents, le Dr Tom O’Neill, travaille avec des équipes dans un milieu de soins de santé. Il travaille plus précisément avec des équipes de réanimation pour maximiser leur performance. Un spécialiste en ergonomie, comme un psychologue de l’environnement, pourrait examiner la disposition de la salle et l’équipement qu’elle contient pour voir comment cela influence le travail, si certains éléments gênent les gens. Tandis que Tom s’intéresse davantage à la communication, aux conflits et à d’autres choses de ce genre. »
Lorsque j’ai commencé à travailler à la radio, j’étais producteur d’une émission intitulée Sentimental Journey sur la station de radio pour adultes locale. L’animateur de l’émission enregistrait son émission sur un magnétophone à bobines, puis fournissait une liste des chansons qu’il avait mentionnées au cours de l’émission. Certaines étaient sur CD, d’autres sur ordinateur et d’autres sur vinyle. Je devais veiller à ce qu’il y ait 60 minutes de musique et d’animation par heure, mais l’animateur ne se préoccupait pas beaucoup de cela. Parfois, une « heure » contenait 35 minutes de musique et d’animation, et d’autres fois, 85 minutes. Je suis probablement la dernière personne à la radio, du moins à Ottawa, qui faisait passer de la musique à partir d’une table tournante à l’antenne, et qui devait coller les bobines à l’aide d’une lame de rasoir et de ruban adhésif. J’ai essayé de montrer à l’animateur comment utiliser le logiciel informatisé de suivi de la voix, qui nécessitait de démarrer le programme, puis d’appuyer sur la barre d’espacement pour enregistrer et appuyer de nouveau sur celle-ci pour arrêter l’enregistrement. Un psychologue I/O m’aurait vraiment été utile pour le convaincre qu’appuyer sur une barre d’espacement ne fait pas de quelqu’un un « geek » et que la technologie peut parfois aider et faciliter les choses!
La technologie et son évolution rapide sur les lieux de travail ont été un sujet de discussion important pour les psychologues I/O au cours des quelque 10 dernières années, mais, selon le Dr Bourdage, il s’agit d’une petite partie du travail et des recherches réalisés sur la culture et l’amélioration du lieu de travail.
« C’est extrêmement vaste – les types de travaux présentés ne serait-ce que l’année dernière au congrès de la SCP étaient très diversifiés. Il y a eu des présentations sur la sélection du personnel – comment améliorer l’embauche et recruter les bonnes personnes pour un emploi à pourvoir? Comment la personnalité et les différents éléments situationnels comme le leadership influencent-ils les attitudes et les comportements des employés? Nous avons également abordé des sujets plus actuels et urgents, comme le genre et la diversité en milieu de travail, ainsi que l’utilisation de la technologie au travail. De plus, beaucoup de personnes relèvent le défi de comprendre comment le travail et les pratiques dans lesquelles nous nous impliquons changent en raison de la COVID. Comment continuer de favoriser une bonne dynamique de groupe malgré le passage au travail à distance? Comment les gens font-ils face au travail à distance de manière productive? Et bien sûr, beaucoup de psychologues du travail et des organisations s’intéressent à la santé mentale. Certains d’entre nous travaillent avec des travailleurs de la santé pour mieux comprendre l’épuisement professionnel et le stress, ainsi que leur incidence sur le milieu de travail. Comment intervenir pour aider les travailleurs et les organisations dans ce domaine? »
Quand j’étais au collège, j’ai eu mon premier contact avec le travail virtuel. J’ai été embauché par une entreprise de matériel promotionnel, et après la première entrevue, je n’ai plus jamais revu un seul de mes collègues. Je recevais un appel me disant où était le « produit ». (Je plaisantais toujours avec la voix au téléphone sur les dangers de parler de « produit » sur un téléphone portable, mais je ne crois pas qu’il ait jamais compris ce que je voulais dire.) Je me présentais ensuite à l’adresse indiquée, où se trouvait un gros camion. J’entrais, je voyais quel était le « produit », puis je passais la journée à offrir des échantillons gratuits du nouveau pain Dempster’s dans une épicerie locale, d’eau Dasani dans une salle de sport ou de Miller Genuine Draft dans un bar. Bon, ce n’était pas du « travail virtuel » à proprement parler, mais simplement du travail sans collègues!
Il doit y avoir une étude sur la motivation entourant un cadre de travail comme celui-ci. Je n’avais absolument aucun moyen de savoir avec certitude si je faisais bien mon travail – ou, dans bien des cas, si je le faisais tout simplement! Je n’avais aucun contact avec mes collègues, je n’avais donc aucun cadre de référence pour savoir s’ils faisaient leur travail du mieux qu’ils le pouvaient ou si, à la fin de la journée, ils emportaient chez eux la caisse supplémentaire de Corn Nuts qu’ils n’avaient pas distribuée pour la partager avec leurs colocataires, tout aussi pauvres et affamés qu’eux. Comme dans tout travail virtuel, il y a probablement du bon et du mauvais, soutient la Dre Shen.
« Ce passage à grande échelle vers le travail virtuel est compliqué! Il y a sûrement de bonnes choses, comme l’évaluation plus objective du travail des employés, car on voit le travail indépendamment de la personne qui le fait. Mais il y a aussi des aspects négatifs, comme le fait que les gestionnaires ont l’impression de ne plus avoir de contrôle parce qu’ils ne peuvent pas voir directement les gens travailler. De plus, la frontière entre ce qui relève du travail et ce qui relève de la vie privée est un problème que les entreprises essaient de gérer parce que cela ne posait pas vraiment de problème dans le passé. »
Selon le Dr Bourdage, bien que le passage au travail virtuel et l’adoption des nouvelles technologies aient constitué un changement majeur – tant pour la main-d’œuvre que pour les psychologues – l’expertise des psychologues I/O a permis de faciliter la transition vers cette nouvelle réalité.
« Nous avions déjà constaté une évolution vers les nouvelles technologies, qu’il s’agisse de l’apprentissage automatique ou de l’intelligence artificielle, dans le cadre de la prise de décision, de l’embauche ou du passage à un travail plus virtuel. D’une certaine manière, la COVID n’a fait qu’accélérer certaines choses, de la même manière qu’elle a accéléré ou mis en évidence certaines inégalités – par exemple, les personnes qui sont le plus susceptibles de supporter le poids des responsabilités liées à la garde des enfants. Une grande partie du travail et de la recherche que nous effectuons depuis des décennies sert de base à certaines de ces choses – nous avons la chance de disposer d’une expertise dans des domaines tels que la santé mentale et la stigmatisation au travail, la sécurité au travail, la sélection, l’embauche et le recrutement. Donc, je dirais que nous avons déjà cette expertise et elle a simplement été transférée au nouveau contexte actuel. »
En ce qui concerne l’équité, la diversité et l’inclusion, l’une des spécialités de la Dre Shen, celle-ci affirme que la pandémie a été une arme à double tranchant lorsqu’il a été question de rendre les lieux de travail plus accueillants et plus agréables.
« Je pense que, d’une part, la possibilité de travailler de manière virtuelle est une idée que les porte-parole des personnes handicapées, par exemple, défendent depuis longtemps, car elle rendrait le lieu de travail beaucoup plus inclusif et constituerait une forme d’adaptation utile pour un large éventail de handicaps. Mais pour de nombreuses entreprises, cette solution n’est pas un aménagement « raisonnable » pour de nombreux emplois de leur registre. Mais la pandémie a mis en évidence le fait que certaines de nos idées sur la manière dont le travail est effectué ou sur le type de travail qui peut être effectué de manière virtuelle – souvent très efficacement – n’étaient pas assez audacieuses. Les entreprises et les organisations étaient peut-être auparavant trop frileuses pour essayer certaines choses de ce genre.
Le revers de la médaille est que nous devons être modérément prudents en ce qui concerne l’équilibre entre la responsabilité de l’employé et celle de l’employeur. C’est un peu une zone grise. Par exemple, si j’ai besoin d’une connexion Internet très coûteuse pour faire mon travail, qui va payer? Ou si je me blesse à la maison en faisant quelque chose qui est relié à mon travail – est-ce un accident du travail? Certaines recherches indiquent que nous ne sommes pas aussi prudents dans nos communications par courrier électronique que nous le serions en personne, ce qui peut contribuer à l’impression d’être victime d’intimidation.
Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Nous avons certainement la possibilité de remodeler le travail de manière plus équitable, mais il reste aussi beaucoup de problèmes potentiels qui sont moins visibles à certains égards. Parfois, les gens ne se sentent pas à l’aise de partager certains aspects de leur espace virtuel ou personnel. Les entreprises doivent bien prendre garde de ne pas supposer que tous les employés disposent du même type de ressources ou du même type de configuration. »
Au début de la pandémie, la Dre Shen a mené une étude avec ses collègues sur les expériences des Américains et des Canadiens d’origine asiatique sur les lieux de travail, au moment où des attitudes xénophobes commençaient à se manifester. Elle fait actuellement des recherches qui portent sur la division du travail dans les ménages pendant la pandémie et sur ses répercussions sur les attitudes au travail. En particulier, la tendance des femmes à avoir l’impression qu’elles doivent mettre leur carrière en veilleuse afin de s’adapter aux changements survenus dans les responsabilités du ménage. De manière plus générale, en raison de mouvements sociaux comme La vie des Noirs compte et Chaque enfant compte, les psychologues I/O ont un regain d’intérêt pour l’étude des expériences des travailleurs noirs et autochtones. Selon la Dre Shen, il est très important que les pratiques fondées sur des données probantes restent au premier plan lorsqu’on examine la question de la diversité et de l’inclusion au travail.
« Je fais partie d’un grand consortium qui essaie d’aider les employeurs à élaborer des outils pour les employeurs et les employés afin de faciliter les échanges sur la divulgation d’un handicap pendant le processus d’embauche. Beaucoup d’employeurs veulent s’impliquer, mais ne savent pas nécessairement comment procéder si un employé ou un candidat révèle un handicap. Un large éventail de questions découle de la notion de “nous voulons créer une atmosphère inclusive, qu’est-ce que cela signifie et à quoi cela ressemble-t-il?”
Au fur et à mesure que nous devenons plus conscients, un grand nombre de personnes veulent faire des changements. Mais beaucoup de ces questions peuvent être mal interprétées et entraîner des effets en cascade. Par exemple, de plus en plus d’études montrent que certaines politiques relatives à l’embauche et à l’équité en matière d’emploi peuvent être interprétées par les gens comme “les normes sont différentes” ou “ils ne sont là que pour X”, et cela peut avoir des conséquences insidieuses et négatives pour les personnes qui sont perçues comme ayant bénéficié de ces politiques en milieu de travail. C’est très important, mais aussi très complexe.
On a souvent tendance à se concentrer sur la représentation plutôt que sur l’inclusion. Cela peut créer des problèmes parce que l’on cherche à intégrer les gens, sans se rendre compte que l’environnement dans lequel on les intègre n’est pas très favorable. Cela peut en fin de compte conduire à des problèmes de maintien de l’effectif où les groupes sous-représentés se succèdent. »
L’importance de fonder les politiques et les procédures sur des données scientifiques de qualité est reprise par le Dr Bourdage.
« L’une des choses que nous soutenons est la pratique fondée sur des données probantes. Je crois que plusieurs de ces choses relèvent du bon sens, mais je pense qu’il faut beaucoup de connaissances, de formation et d’expertise pour comprendre non seulement l’équité, la diversité et l’inclusion, mais aussi le changement organisationnel, la culture organisationnelle, la façon dont les systèmes de récompense influencent les gens, ou les politiques organisationnelles. Ce sont là autant de domaines dans lesquels les psychologues I/O se plongent avec différentes optiques pour comprendre ces choses et alimenter la pratique fondée sur des données probantes.
En fait, tout, depuis le moment où vous décidez de postuler à un emploi jusqu’aux questions que l’on vous pose lors d’un entretien d’embauche, en passant par la manière dont vous êtes accueilli et intégré dans votre nouveau bureau, vos interactions quotidiennes sont toutes guidées et étudiées par les psychologues I/O. Cela touchera de manière tangible presque tous les individus, chaque jour, pendant une grande partie de leur vie. »
Lorsque j’étais à l’université, j’ai répondu à une offre d’emploi qui sollicitait des sauveteurs pour travailler dans les piscines des immeubles d’Ottawa pendant l’été. À la fin de mon entretien d’embauche, j’avais été engagé non seulement comme sauveteur, mais aussi comme cadre intermédiaire dans une société de sécurité, où je travaillais à la répartition des alarmes et supervisais les agents de sécurité de toute la ville. C’était une entreprise qui acceptait tous les contrats possibles – je répondais également aux plaintes des employés pour une variété de magasins de vêtements canadiens et je tenais des registres pour des entreprises d’entretien de bâtiments, entre autres choses. Les sauveteurs étaient payés au salaire minimum, les cadres intermédiaires du centre de contrôle étaient payés 0,15 $ de plus de l’heure. L’offre d’emploi de l’époque, qui remonte à 1999 environ, mentionnait seulement « sauveteur » et comprenait un numéro de téléphone. Aujourd’hui, les choses sont quelque peu différentes, dit la Dre Shen.
« Chaque fois que vous allez en ligne et que vous consultez une offre d’emploi, celle-ci a probablement été créée par une forme d’analyse de poste que les psychologues I/O effectuent pour comprendre ce qui est au centre de l’emploi en question. Pour savoir comment faire correspondre une personne à un emploi, nous devons d’abord comprendre la nature exacte de cet emploi et ce qu’il implique.
L’évaluation annuelle du rendement que vous détestez ou que vous adorez peut-être – la science y est pour beaucoup. Peut-être que votre milieu de travail utilise la rétroaction à 360 degrés, où vous évaluez votre patron et vos collègues. Beaucoup de psychologues I/O ont participé à l’élaboration de cette méthode et l’ont popularisée. »
Lorsque je travaillais à la radio, j’avais un examen annuel du rendement au cours duquel plusieurs patrons s’asseyaient avec moi pour fixer les objectifs de l’année suivante et examiner mes progrès par rapport aux objectifs de l’année précédente. La rencontre se présentait invariablement comme suit : « Vous avez dépassé les attentes à quatre de vos cinq objectifs et atteint le cinquième. Excellent travail! Je vais vous donner 4/5 dans tous les domaines ». Pourquoi recevais-je 4/5 alors que j’avais dépassé l’objectif? Et quand avais-je atteint l’objectif? Il s’avère qu’une politique de l’entreprise stipulait que si un employé recevait un 5/5 sur le rapport remis au siège social, il devait obtenir une augmentation. Le Dr Bourdage dit : « La psychologie I/O peut fournir les outils, mais que les gens les utilisent bien ou non, c’est en quelque sorte leur affaire! Le travail des psychologues I/O consiste à travailler avec les organisations pour les aider à adopter ces outils et ces meilleures pratiques. »
La station de radio pour adultes où j’ai travaillé n’existe plus, la compagnie de sécurité ne fait plus de sécurité ou de sauvetage et l’entreprise de matériel promotionnel a disparu. J’ignore si l’entreprise de vente porte-à-porte d’abonnements à des produits de boucherie fait toujours des affaires, car je ne me souviens plus de son nom. Je suppose qu’elles n’existent plus. Je me demande cependant, si elles étaient toujours là, comment elles se porteraient. D’une part, la pandémie a peut-être créé une demande qui n’existait pas auparavant et qui a permis d’offrir un service d’abonnement de produits de boucherie, mais elle a aussi voué à l’échec le modèle de vente en porte-à-porte. À l’heure où je vous parle, une partie du travail des psychologues I/O serait probablement parvenue à ces entreprises, et celles-ci offriraient probablement un meilleur environnement de travail – si ce n’est qu’en remplaçant « Eye of the Tiger » par « Turn Down For What ». Le Dr Bourdage croit que la plupart des entreprises évoluent dans une meilleure direction.
« En tant que président actuel de la SCPIO, je regarde le travail qui se fait autour de moi et j’ai l’impression que notre domaine est particulièrement bien placé pour aider à résoudre les problèmes contemporains. »

Dre Cheryl Harasymchuk

Dr John Zelenski

Dre Katherine Starzyk
Dre Cheryl Harasymchuk, Dre Katherine Starzyk, et Dr John Zelenski, Psychologie sociale et de la personnalité
La psychologie sociale et la psychologie de la personnalité sont deux disciplines différentes, mais qui sont inextricablement liées. Nous avons parlé avec la Dre Cheryl Harasymchuk, la Dre Katherine Starzyk et le Dr John Zelenski de l’histoire controversé et du présent harmonieux de ces deux champs d’études, et du travail qu’ils font pour nous inciter tous à devenir meilleurs.
Psychologie sociale et de la personnalité
La Dre Cheryl Harasymchuk est professeure agrégée au département de psychologie de l’Université Carleton, où elle effectue des recherches qui portent sur les relations dans une perspective sociopsychologique. Elle est la présidente de la Section de la psychologie sociale et de la personnalité de la SCP. La Dre Katherine Starzyk est professeure agrégée de psychologie sociale et de psychologie de la personnalité à l’Université du Manitoba, où elle étudie la façon dont les gens réagissent à l’injustice sociale. Le Dr John Zelenski est professeur de psychologie à l’Université Carleton et la psychologie de la personnalité est le plus ancien des nombreux domaines de recherche auquel il s’intéresse.
Si vous suivez notre série du Mois de la psychologie, vous vous souvenez peut-être du Dr Zelenski, qui a également participé à notre portrait sur la psychologie de l’environnement. Comme c’est le cas pour de nombreuses disciplines de la psychologie aujourd’hui, il existe de nombreux recoupements entre la psychologie sociale et de la personnalité, et d’autres domaines d’études.
« Mes premiers travaux en psychologie de l’environnement consistaient à essayer de mesurer les différences individuelles reliées à ce que nous appelons le “rapport à la nature”. Il s’agit du degré auquel les gens se sentent liés à la nature et à l’environnement et en font partie. La façon dont nous appréhendons l’environnement ressemble presque à une relation sociale, et nous empruntons donc certaines techniques et mesures à la psychologie sociale. Puisque le “rapport à la nature” est lié à de bonnes choses, comme le bonheur et les comportements écologiques, il serait bon de le renforcer. »
Cela fait écho à ce qui se passe plus largement en psychologie de la personnalité. Il y a 20 ans, ce champ d’études essayait de déterminer quelles étaient les dimensions les plus importantes de la personnalité. Il y a bien sûr des milliers de différences individuelles potentielles, et les chercheurs en psychologie sociale ont donc essayé de donner un sens à tout cela. Ce travail se poursuit, mais les psychologues de la personnalité sont parvenus à un certain consensus au cours des deux dernières décennies. Ils peuvent désormais commencer à poser des questions sur la façon dont les comportements et les traits psychologiques évoluent dans le temps, ou sur la façon d’accroître les traits psychologiques souhaitables et de susciter l’intérêt de certains types de personnes. Selon le Dr Zelenski, « la psychologie de la personnalité s’intéresse davantage à des questions de fond, au changement et à la stabilité, au lieu de se limiter simplement à comprendre de quoi on parle. »
Il y a une différence entre la « psychologie de la personnalité » et la « psychologie sociale », et à un moment donné, toutes les deux n’étaient pas dans de très bonnes dispositions l’une envers l’autre. Certains disent (comme le Dr Zelenski) que c’était comme une rivalité entre frères et sœurs. D’autres disent que c’était une bataille des extrêmes. D’une façon ou d’une autre, un rapprochement s’est opéré au fil des années, au point que toutes les deux font désormais équipe et sont à bien des égards inextricablement liées, comme Nas et Jay-Z, qui ont finalement cessé de s’insulter par chansons interposées et se sont réunis pour faire de la belle musique dans le cadre de la tournée du spectacle « I Declare War » (qui porte bien son nom). La Dre Harasymchuk fait la distinction entre les deux domaines.
« La psychologie est l’étude du pourquoi et du comment de nos comportements. Les psychologues sociaux étudient la façon dont les gens sont façonnés par les personnes qui les entourent et par l’environnement en général. Et les psychologues de la personnalité étudient comment définir et mesurer les différences importantes entre les personnes – allant des gènes jusqu’à la culture.
Au début, il y avait des positions extrêmes, où deux camps s’affrontaient. L’un disait que ce n’est que le contexte, et l’autre, que c’est la façon dont vous êtes né qui façonne votre comportement. Depuis ce temps, beaucoup de preuves ont montré que les choses ne se situent pas à un extrême ou à un autre. Par exemple, j’étudie les relations selon une perspective sociopsychologique, ce qui signifie que je m’intéresse surtout à la façon dont le conjoint d’une personne, ou son meilleur ami façonnent le comportement de cette dernière. Mais dans toutes mes recherches, j’examine aussi les variables relatives aux différences individuelles. Les situations dépendent de la personnalité de cette personne, et de la façon dont elle pourrait réagir face à son conjoint ou à son meilleur ami. Si elle a l’habitude de réagir très négativement aux facteurs de stress, dans le contexte d’une relation où elle se dispute avec son conjoint ou son meilleur ami, ses comportements pourraient être plus négatifs et démesurés que ceux d’une personne qui est plus apte à gérer ses émotions. »
L’intégration de la recherche sociale et de la recherche sur la personnalité présente beaucoup d’avantages concrets. La Dre Starzyk a travaillé avec des collaborateurs et des partenaires afin d’accroître la motivation du gouvernement à prendre des mesures en réponse à la crise de l’eau potable chez les Premières nations. Le groupe comprend des psychologues sociaux/psychologues de la personnalité, des sociologues, des économistes, des spécialistes du droit, des scientifiques en science du sol, etc.; ensemble, ils réfléchissent à la manière de faire pression pour atténuer la crise et soutiennent le travail des organisations de défense des droits qui constituent le visage public de cet effort. Il s’agit d’une approche à plusieurs volets, où les psychologues sociaux et les psychologues de la personnalité sont chargés d’influencer l’opinion publique.
« Certaines de nos recherches visent à comprendre, notamment, quand et pourquoi les gens commenceront à soutenir un meilleur accès à l’eau potable pour les Premières nations au Canada. Ou à quel moment les gens commenceront à se préoccuper du racisme ou aux éléments nécessaires à la réalisation de la (ré)conciliation. Même dans ce contexte, où nous étudions des choses qui semblent très basées sur le groupe, nous examinons cette année comment la plupart des variables individuelles de la personnalité permettent de prédire chacune de ces choses conjointement. Donc, encore une fois, nous avons affaire à une véritable intégration de la psychologie sociale et de la psychologie de la personnalité. Bien que nous puissions mettre en place des cadres plus susceptibles d’inciter les gens à agir et à se préoccuper de ces choses, nous souhaitons également comprendre quelles sont les personnes que ces cadres influenceront le plus, celles que nous pouvons mobiliser plus facilement et celles qui nécessitent peut-être une approche différente. Cela a pris beaucoup de temps, mais le croisement est enfin là! » Intégrant ses travaux en psychométrie et en relations intergroupes, le Canadian Reconciliation Barometer a publié son premier rapport en février 2022 (https://reconciliationbarometer.ca).
Au cours des dernières décennies, un autre changement important a été apporté à la façon dont les recherches elles-mêmes sont menées. La Dre Harasymchuk explique :
« L’un des principaux changements qui ont eu une incidence sur la psychologie en général, ainsi que sur la psychologie sociale et de la personnalité, est l’importance accrue accordée à la promotion de nos méthodes de recherche par la transparence et la réplication. Il est désormais plus courant dans notre domaine de voir les chercheurs préinscrire leurs hypothèses de recherche. Autrement dit, avant de commencer à mener leur étude et à recueillir des données, ils déclarent publiquement ce qu’ils s’attendent à trouver.
Dans le même ordre d’idées, nous assistons à une évolution vers une collaboration scientifique accrue. Si vous cherchez à obtenir un nombre suffisant de participants pour être plus confiant à l’égard de vos résultats, il faudra regrouper plusieurs laboratoires et ressources. Nous nous sommes toujours engagés à faire des recherches de qualité, mais au cours des 20 dernières années, nous avons beaucoup appris sur l’importance de la réplication et de la taille des échantillons. »
Le travail de la psychologie sociale et de la psychologie de la personnalité a non seulement subi de nombreux changements au cours des 20 dernières années, mais il a aussi grandement contribué aux changements que nous observons dans notre vie quotidienne. Toute publicité diffusée en ligne ou à la télévision, toute plateforme de médias sociaux ou application interactive est conçue en fonction de la façon dont les gens pensent. La Dre Starzyk dit qu’elle voit souvent Facebook, Google et des agences de publicité recruter explicitement des diplômés en psychologie sociale et en psychologie de la personnalité – ils ont même des kiosques à leurs congrès!
Si une grande partie de ce qui nous entoure s’inspire de la psychologie sociale et de la personnalité, nos propres comportements peuvent être expliqués (ou peut-être étudiés) par des chercheurs dans ce domaine – chaque décision que nous prenons, chaque acte que nous posons, intéressera probablement un psychologue quelque part! La Dre Harasymchuk en donne un exemple.
« Il existe une sous-discipline qui s’intéresse au jugement et à la prise de décisions. La question n’est pas de savoir quelles sont les choses objectives que nous vivons dans une situation donnée, mais quelle est notre perception relative à ces choses. Notre perception peut influencer notre décision de faire 10 minutes de route supplémentaires pour nous rendre à une station-service où nous savons que nous pourrons économiser quelques cents par litre plutôt que d’aller à la station la plus proche. »
Le rôle des psychologues sociaux et de la personnalité a été un peu plus étudié l’année dernière, car ceux-ci sont au premier plan lorsqu’il s’agit de trouver des moyens de faire adhérer les gens aux mesures de santé publique. Il ne suffit sûrement pas de « formuler votre message dans ce sens et tout le monde portera un masque et se fera vacciner ». La question est plutôt de savoir quel type de message, d’image et de rhétorique incitera le plus grand nombre de personnes à prendre les précautions nécessaires pour se protéger. Le Dr Zelenski dit que ce processus est très complexe.
« Lors de l’un de mes séminaires de deuxième cycle, pas plus tard que la semaine dernière, nous examinions des articles contradictoires dans une revue très prestigieuse, et l’un d’entre eux disait : “Voici les choses que les psychologues sociaux ont apprises; appliquez-les à la pandémie!” L’autre venait d’un groupe composé principalement de psychologues sociaux et de psychologues de la personnalité et disait : “Attendez une seconde. Nous avons fait une tonne d’études, mais surtout sur les étudiants. Ce qu’elles nous ont appris n’est peut-être pas suffisant ni prêt à être appliqué.” Entre les deux, il y a des politiciens et des décideurs qui doivent prendre des décisions dans l’immédiat et qui veulent savoir si ces données scientifiques sont utiles ou non. Donc, même au sein de notre domaine, il y a un débat. Nous ne manquons pas de poser ces questions et d’y répondre, et si nos conseils ne sont pas aussi avisés qu’ils pourraient l’être dans cinq ans, beaucoup de gens estimeront qu’ils sont au moins suffisamment judicieux pour être utiles dans l’immédiat. »
Selon la Dre Starzyk, ce qui est surtout difficile, c’est maintenir la confiance des gens envers le gouvernement afin de les amener à faire confiance aux mesures de santé publique préconisées par ce gouvernement.
« Les gouvernements ne transposent pas toujours les résultats de la recherche en politiques, et ils se comportent de manière vraiment incohérente. Nous savons beaucoup de choses sur ce qui suscite la confiance à l’égard du gouvernement. Lorsqu’il dit que l’on peut circuler sans masque partout où l’on veut, puis que trois jours plus tard, les directives sont différentes, les gens commencent à se demander si cette politique est fondée sur un motif valable.
Même si nous savons que la question des contacts n’est plus aussi importante et qu’il n’est plus nécessaire de désinfecter tout ce qui se trouve dans la maison, l’une des raisons pour lesquelles les gouvernements ont hésité à annuler ce type de conseils est que cela aurait pu diminuer la confiance des gens. Je pense que ce n’est pas très sage, il faut choisir ce que la science offre de mieux à ce moment-là et éviter que les gens dépensent de l’argent pour acheter des choses dont ils n’ont pas besoin. »
La recherche en psychologie de la personnalité et en psychologie sociale a beaucoup fait, mais reste un peu méconnue du grand public. Nous espérons que cela changera. Les psychologues sociaux et les psychologues de la personnalité nous aident à combattre le racisme, à nous comporter de façon plus écologique et tentent de nous convaincre de porter un masque et de nous faire vacciner. Pour vivre mieux.

Dr Randal Tonks

Dre Gira Bhatt
Dr Randal Tonks et Dre Gira Bhatt, Psychologie internationale et interculturelle
La psychologie internationale et la psychologie interculturelle sont deux domaines distincts, mais connexes. L’étude des différences et des similitudes culturelles apporte depuis longtemps une perspective nécessaire à la psychologie, et ce travail s’accélère à mesure que le monde devient de plus en plus connecté. Nous avons parlé au Dr Randal Tonks et à la Dre Gila Bhatt du travail qu’ils font dans ce domaine.
« J’avais un camarade de classe à l’école secondaire qui était extrêmement intelligent. Il n’était pas religieux à cette époque; la plupart des Kurdes sont séculiers et ils ne croient pas beaucoup en une religion fondamentaliste ou extrémiste. Alors que j’étais étudiant à la maîtrise à l’université, j’ai appris qu’il s’était associé à Al Qaeda en Afghanistan. À ce moment-là, je me demandais pourquoi les gens souhaitaient rallier Daech, Al Qaeda et d’autres groupes extrémistes. Surtout que la plupart de mes amis et moi-même avions toujours été contre ces groupes dans ma province. Environ un an après, j’ai entendu dire qu’il avait été tué en Afghanistan avec Abdullah Massoud. J’étais en état de choc. Pourquoi? Pourquoi les avait-il rejoints? Où étaient les racines psychologiques de tout ce processus? »
Le Dr Yusef Karimi est Kurde. Il est venu au Canada de l’Iran, quand sa femme a obtenu un bon emploi ici il y a un peu plus d’un an. Il a terminé son doctorat en psychologie du counseling en Iran, où il s’est particulièrement consacré à comprendre ce qui motive les gens à s’associer à des groupes comme Al Qaeda. Pendant quatre ou cinq ans, il s’est rendu dans les villages de long de la frontière de l’Iran et de l’Irak lors de la prière du vendredi, et passant le reste de la fin de semaine à interviewer les membres de groupes extrémistes.
« J’ai communiqué avec eux, recueilli beaucoup d’information à leur sujet, en plus d’interviewer 16 djihadistes salafistes. Malheureusement, après ces entrevues, trois d’entre eux se sont joints à Daech en Syrie et se sont fait tuer là-bas. En tant qu’être humain et psychologue, j’avais appris à connaître ces gens pendant un moment. Leur mort m’a beaucoup déprimé. À cette époque, ma première idée était de trouver le moyen de convaincre les gens de ne pas s’associer à ces groupes extrémistes au départ. À ce jour, j’essaie toujours de trouver la réponse à cette question. »
La réponse, selon le Dr Karimi, ne se trouve certainement pas dans ce que l’Occident a fait sur le plan du contre-terrorisme, en envahissant l’Afghanistan et l’Irak avec pour objectif l’édification de la nation, menant des frappes de drones en Syrie et en Somalie, sans compter les autres interventions qui commencent par des agressions et aboutissent à des occupations militaires. Il évoque les événements récents survenus en Afghanistan, la résurgence des talibans après le retrait des États-Unis, comme exemple patent des lacunes de cette stratégie.
« Je crois que ce qui a été fait au Moyen-Orient sur le plan de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme est voué à l’échec en raison des répercussions de l’emploi de méthodes inappropriées. L’éradication de l’extrémisme actuel requiert une approche phénoménologique qui s’attaque aux racines du problème. Les politiciens et les responsables des politiques préfèrent habituellement définir et évaluer les groupes extrémistes présentement actifs au Moyen-Orient en fonction de leur capacité organisationnelle existante, plutôt que des menaces réelles qu’ils posent.
En tant que psychologue, en tant que personne ayant visité ces pays du Moyen-Orient et qui fait partie de cette culture, ce que nous avons observé au cours des derniers mois en Afghanistan est l’échec des efforts des 20 dernières années visant l’édification de la nation. Nous pouvons considérer de multiples facteurs ayant mené à ce revers, mais à mon avis, il en est un que nous devrions examiner de très près. C’est-à-dire l’absence de connaissances des caractéristiques individuelles du peuple afghan. Dans cette situation, la psychologie peut nous fournir une très grande quantité de connaissances sur les caractéristiques d’une communauté donnée. Et cela peut nous mener loin sur la voie de la pacification et de la résolution des conflits. »
Les talibans, de retour aux commandes de l’Afghanistan, ont fait les gros titres ces dernières semaines lorsqu’ils se sont joints au reste du monde pour appeler à une résolution pacifique de l’invasion russe en Ukraine. En soi, cet appel a suscité beaucoup de réactions partout dans le monde : « quand les talibans réclament la paix, on sait qu’il se passe quelque chose de terrible… », ce qui traduit une sérieuse absence de nuance et de compréhension à l’égard de la région.
En 1989, les moudjahidines afghans ont défait l’Union soviétique, la repoussant hors de l’Afghanistan après une guerre longue et coûteuse. Puis, ils sont arrivés à renverser le gouvernement afghan soutenu par les communistes en place à ce moment, mais se sont rapidement fractionnés, et après une seconde guerre civile en Afghanistan, ont cédé le pouvoir aux talibans. Les moudjahidines se sont dispersés dans toutes les directions, dont l’une était menée par Oussama ben Laden, un des supporteurs les plus connus des moudjahidines.
L’agression soviétique, maintenant russe, n’a rien de nouveau. Avant l’invasion odieuse de l’Ukraine, ces derniers jours, les forces militaires de Poutine et les fermes de bots s’adonnaient au cyberterrorisme partout sur la planète, ce qui aurait pu être un signal pour le reste du monde qu’ils préparaient quelque chose de plus conventionnellement violent.
Le Dr David Nussbaum est le président de la Section de l’extrémisme et du terrorisme de la SCP. Le Dr Nussbaum a un doctorat en psychologie biologique, mais il souligne qu’il a vraiment appris la psychologie clinique au volant d’un taxi qu’il conduisait deux nuits par semaine pendant quatre ans, alors qu’il terminait son doctorat. Il a fait des études postdoctorales en neuropsychologie, au cours desquelles il s’est intéressé à la psychologie médicolégale. Il est devenu membre de la Section de la justice pénale de la SCP, et en a été le président pendant sept ans. Il y a fait la rencontre du Dr Wagdy Loza, alors psychologue en chef au pénitencier de Kingston. Le Dr Loza a lancé la Section de l’extrémisme et du terrorisme et le Dr Nussbaum fut l’un des premiers signataires ayant contribué à obtenir le statut initial de la section. Cela l’a orienté vers le terrorisme au Moyen-Orient, mais il parle du lien entre le communisme, l’extrémisme et le terrorisme depuis de nombreuses années.
« Les gens sont séduits par la promesse d’une utopie communiste, le paradis du travailleur. Sauf qu’après cinq ans dans une économie marxiste, ils sont chanceux de pouvoir manger. Ils pourraient invoquer qu’ils ressentent le remords de l’acheteur et qu’ils veulent se débarrasser du gouvernement. C’est à ce moment que la nature totalitaire, draconienne de l’étatisme émerge. Pensez aux goulags russes, et ainsi de suite. »
La nature totalitaire et draconienne de Poutine l’étatiste est actuellement manifeste, tandis que le monde réagit à l’invasion de l’Ukraine par une condamnation quasi universelle. Cependant, il est intéressant de noter la différence entre la réaction du monde à cette invasion, lorsqu’on la compare avec l’invasion américaine de l’Afghanistan ou l’offensive de l’Arabie saoudite au Yémen. La guerre est la guerre, qu’elle ait lieu au Moyen-Orient ou en Europe, et le Dr Nussbaum affirme sans ambages qu’il n’existe pas de lieu unique où le terrorisme, ou les idéologies qui le produisent prospèrent.
« Le terrorisme ne se limite pas à une région géographique, à une idéologie particulière; il y a des terroristes partout au monde, et ce, depuis des millénaires. Aujourd’hui, dans les 25 ou 30 dernières années, c’est devenu un enjeu majeur parce que diverses idéologies cherchent à prendre le contrôle de la planète (ou d’immenses parties de la planète). L’une des choses qu’ils font pour influencer les gouvernements et les citoyens est l’utilisation du terrorisme pour instiller la peur afin que les gens se soumettent à leurs diktats. C’est toujours fait dans un but politique. »
Le Dr Karimi mentionne qu’au cours de l’histoire, nous avons souvent dû revoir ce que nous pensions savoir, en raison d’une violence extrémiste que nous n’avions pas envisagée auparavant.
« Nous avons fait l’expérience du fascisme et du racisme en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Au XXe siècle, Hannah Arendt affirmait qu’avec la montée du totalitarisme nous étions confrontés à un nouveau phénomène et à une nouvelle réalité. La classe politique n’avait jamais fait face à cette situation auparavant, alors elle disait que nous devions établir une nouvelle science de la politique pour expliquer et interpréter le terrorisme. Tout comme ce qu’affirmait Alexis de Tocqueville au XVIIIe siècle après la Révolution française. Aujourd’hui, la psychologie, et la psychologie politique en particulier, fait face à un autre phénomène inédit et à une nouvelle réalité. Cela soulève plusieurs questions. Par exemple, comment pouvons-nous comprendre l’individu dans une société comme l’Afghanistan, ou la Syrie ou l’Irak, dans laquelle l’ordre social repose largement sur une structure tribale? Le fait de tenter d’édifier une nouvelle nation en Afghanistan n’était absolument pas aligné avec cette culture. »
Après le 11-Septembre, l’extrémisme a commencé à devenir un problème grave en Amérique du Nord, les groupes d’extrême droite à idéologie anti-islamiste essaimant partout. Les efforts déployés par l’Occident pour supprimer ces groupes et éviter de leur donner une tribune n’ont eu qu’un effet limité et, ces dernières années, l’extrémisme a atteint de nouveaux sommets en gagnant en puissance.
Selon le Dr Karimi, la solution à ce problème est semblable à la solution au terrorisme moyen-oriental : rejoindre les gens avant qu’ils ne deviennent extrémistes. Ce sera un processus de longue haleine, et ça ne peut se produire du jour au lendemain, mais le fait de comprendre la culture et de l’accueillir sèmera les graines d’une désescalade de l’extrémisme à l’avenir. Il dit du Canada, où il habite depuis un an,
« De nombreux immigrants viennent au Canada et c’est bien ainsi puisqu’ils apportent avec eux une grande quantité de connaissances de l’extérieur. Mais nous devrions avoir un plan pour intégrer ces gens et leur culture. C’est bien beau d’accueillir beaucoup d’immigrants et de réfugiés. Mais on doit compter sur un plan pour les intégrer à la société canadienne. Les voir vivre avec d’autres Canadiens de manière intégrée, pour qu’ils ne soient pas perçus comme “l’autre”, ce qui est actuellement le cas pour nombre d’entre eux. C’est bien que nous ayons un pays multiculturel, mais nous pourrions faire beaucoup plus pour tirer profit de ce multiculturalisme afin de rendre le Canada meilleur. »

Dr David Nussbaum

Dr Yusef Karimi
Dr David Nussbaum et Dr Yusef Karimi, Extrémisme et terrorisme
L’extrémisme et le terrorisme ne se limitent pas à une région géographique ou à une période donnée. Nous en voyons les résultats partout dans le monde, ici en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, et plus récemment, en Europe. Le Dr David Nussbaum et le Dr Yusef Karimi discutent du rôle de la psychologie dans la compréhension, et éventuellement, dans la prévention de la violence extrémiste.
« J’avais un camarade de classe à l’école secondaire qui était extrêmement intelligent. Il n’était pas religieux à cette époque; la plupart des Kurdes sont séculiers et ils ne croient pas beaucoup en une religion fondamentaliste ou extrémiste. Alors que j’étais étudiant à la maîtrise à l’université, j’ai appris qu’il s’était associé à Al Qaeda en Afghanistan. À ce moment-là, je me demandais pourquoi les gens souhaitaient rallier Daech, Al Qaeda et d’autres groupes extrémistes. Surtout que la plupart de mes amis et moi-même avions toujours été contre ces groupes dans ma province. Environ un an après, j’ai entendu dire qu’il avait été tué en Afghanistan avec Abdullah Massoud. J’étais en état de choc. Pourquoi? Pourquoi les avait-il rejoints? Où étaient les racines psychologiques de tout ce processus? »
Le Dr Yusef Karimi est Kurde. Il est venu au Canada de l’Iran, quand sa femme a obtenu un bon emploi ici il y a un peu plus d’un an. Il a terminé son doctorat en psychologie du counseling en Iran, où il s’est particulièrement consacré à comprendre ce qui motive les gens à s’associer à des groupes comme Al Qaeda. Pendant quatre ou cinq ans, il s’est rendu dans les villages de long de la frontière de l’Iran et de l’Irak lors de la prière du vendredi, et passant le reste de la fin de semaine à interviewer les membres de groupes extrémistes.
« J’ai communiqué avec eux, recueilli beaucoup d’information à leur sujet, en plus d’interviewer 16 djihadistes salafistes. Malheureusement, après ces entrevues, trois d’entre eux se sont joints à Daech en Syrie et se sont fait tuer là-bas. En tant qu’être humain et psychologue, j’avais appris à connaître ces gens pendant un moment. Leur mort m’a beaucoup déprimé. À cette époque, ma première idée était de trouver le moyen de convaincre les gens de ne pas s’associer à ces groupes extrémistes au départ. À ce jour, j’essaie toujours de trouver la réponse à cette question. »
La réponse, selon le Dr Karimi, ne se trouve certainement pas dans ce que l’Occident a fait sur le plan du contre-terrorisme, en envahissant l’Afghanistan et l’Irak avec pour objectif l’édification de la nation, menant des frappes de drones en Syrie et en Somalie, sans compter les autres interventions qui commencent par des agressions et aboutissent à des occupations militaires. Il évoque les événements récents survenus en Afghanistan, la résurgence des talibans après le retrait des États-Unis, comme exemple patent des lacunes de cette stratégie.
« Je crois que ce qui a été fait au Moyen-Orient sur le plan de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme est voué à l’échec en raison des répercussions de l’emploi de méthodes inappropriées. L’éradication de l’extrémisme actuel requiert une approche phénoménologique qui s’attaque aux racines du problème. Les politiciens et les responsables des politiques préfèrent habituellement définir et évaluer les groupes extrémistes présentement actifs au Moyen-Orient en fonction de leur capacité organisationnelle existante, plutôt que des menaces réelles qu’ils posent.
En tant que psychologue, en tant que personne ayant visité ces pays du Moyen-Orient et qui fait partie de cette culture, ce que nous avons observé au cours des derniers mois en Afghanistan est l’échec des efforts des 20 dernières années visant l’édification de la nation. Nous pouvons considérer de multiples facteurs ayant mené à ce revers, mais à mon avis, il en est un que nous devrions examiner de très près. C’est-à-dire l’absence de connaissances des caractéristiques individuelles du peuple afghan. Dans cette situation, la psychologie peut nous fournir une très grande quantité de connaissances sur les caractéristiques d’une communauté donnée. Et cela peut nous mener loin sur la voie de la pacification et de la résolution des conflits. »
Les talibans, de retour aux commandes de l’Afghanistan, ont fait les gros titres ces dernières semaines lorsqu’ils se sont joints au reste du monde pour appeler à une résolution pacifique de l’invasion russe en Ukraine. En soi, cet appel a suscité beaucoup de réactions partout dans le monde : « quand les talibans réclament la paix, on sait qu’il se passe quelque chose de terrible… », ce qui traduit une sérieuse absence de nuance et de compréhension à l’égard de la région.
En 1989, les moudjahidines afghans ont défait l’Union soviétique, la repoussant hors de l’Afghanistan après une guerre longue et coûteuse. Puis, ils sont arrivés à renverser le gouvernement afghan soutenu par les communistes en place à ce moment, mais se sont rapidement fractionnés, et après une seconde guerre civile en Afghanistan, ont cédé le pouvoir aux talibans. Les moudjahidines se sont dispersés dans toutes les directions, dont l’une était menée par Oussama ben Laden, un des supporteurs les plus connus des moudjahidines.
L’agression soviétique, maintenant russe, n’a rien de nouveau. Avant l’invasion odieuse de l’Ukraine, ces derniers jours, les forces militaires de Poutine et les fermes de bots s’adonnaient au cyberterrorisme partout sur la planète, ce qui aurait pu être un signal pour le reste du monde qu’ils préparaient quelque chose de plus conventionnellement violent.
Le Dr David Nussbaum est le président de la Section de l’extrémisme et du terrorisme de la SCP. Le Dr Nussbaum a un doctorat en psychologie biologique, mais il souligne qu’il a vraiment appris la psychologie clinique au volant d’un taxi qu’il conduisait deux nuits par semaine pendant quatre ans, alors qu’il terminait son doctorat. Il a fait des études postdoctorales en neuropsychologie, au cours desquelles il s’est intéressé à la psychologie médicolégale. Il est devenu membre de la Section de la justice pénale de la SCP, et en a été le président pendant sept ans. Il y a fait la rencontre du Dr Wagdy Loza, alors psychologue en chef au pénitencier de Kingston. Le Dr Loza a lancé la Section de l’extrémisme et du terrorisme et le Dr Nussbaum fut l’un des premiers signataires ayant contribué à obtenir le statut initial de la section. Cela l’a orienté vers le terrorisme au Moyen-Orient, mais il parle du lien entre le communisme, l’extrémisme et le terrorisme depuis de nombreuses années.
« Les gens sont séduits par la promesse d’une utopie communiste, le paradis du travailleur. Sauf qu’après cinq ans dans une économie marxiste, ils sont chanceux de pouvoir manger. Ils pourraient invoquer qu’ils ressentent le remords de l’acheteur et qu’ils veulent se débarrasser du gouvernement. C’est à ce moment que la nature totalitaire, draconienne de l’étatisme émerge. Pensez aux goulags russes, et ainsi de suite. »
La nature totalitaire et draconienne de Poutine l’étatiste est actuellement manifeste, tandis que le monde réagit à l’invasion de l’Ukraine par une condamnation quasi universelle. Cependant, il est intéressant de noter la différence entre la réaction du monde à cette invasion, lorsqu’on la compare avec l’invasion américaine de l’Afghanistan ou l’offensive de l’Arabie saoudite au Yémen. La guerre est la guerre, qu’elle ait lieu au Moyen-Orient ou en Europe, et le Dr Nussbaum affirme sans ambages qu’il n’existe pas de lieu unique où le terrorisme, ou les idéologies qui le produisent prospèrent.
« Le terrorisme ne se limite pas à une région géographique, à une idéologie particulière; il y a des terroristes partout au monde, et ce, depuis des millénaires. Aujourd’hui, dans les 25 ou 30 dernières années, c’est devenu un enjeu majeur parce que diverses idéologies cherchent à prendre le contrôle de la planète (ou d’immenses parties de la planète). L’une des choses qu’ils font pour influencer les gouvernements et les citoyens est l’utilisation du terrorisme pour instiller la peur afin que les gens se soumettent à leurs diktats. C’est toujours fait dans un but politique. »
Le Dr Karimi mentionne qu’au cours de l’histoire, nous avons souvent dû revoir ce que nous pensions savoir, en raison d’une violence extrémiste que nous n’avions pas envisagée auparavant.
« Nous avons fait l’expérience du fascisme et du racisme en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Au XXe siècle, Hannah Arendt affirmait qu’avec la montée du totalitarisme nous étions confrontés à un nouveau phénomène et à une nouvelle réalité. La classe politique n’avait jamais fait face à cette situation auparavant, alors elle disait que nous devions établir une nouvelle science de la politique pour expliquer et interpréter le terrorisme. Tout comme ce qu’affirmait Alexis de Tocqueville au XVIIIe siècle après la Révolution française. Aujourd’hui, la psychologie, et la psychologie politique en particulier, fait face à un autre phénomène inédit et à une nouvelle réalité. Cela soulève plusieurs questions. Par exemple, comment pouvons-nous comprendre l’individu dans une société comme l’Afghanistan, ou la Syrie ou l’Irak, dans laquelle l’ordre social repose largement sur une structure tribale? Le fait de tenter d’édifier une nouvelle nation en Afghanistan n’était absolument pas aligné avec cette culture. »
Après le 11-Septembre, l’extrémisme a commencé à devenir un problème grave en Amérique du Nord, les groupes d’extrême droite à idéologie anti-islamiste essaimant partout. Les efforts déployés par l’Occident pour supprimer ces groupes et éviter de leur donner une tribune n’ont eu qu’un effet limité et, ces dernières années, l’extrémisme a atteint de nouveaux sommets en gagnant en puissance.
Selon le Dr Karimi, la solution à ce problème est semblable à la solution au terrorisme moyen-oriental : rejoindre les gens avant qu’ils ne deviennent extrémistes. Ce sera un processus de longue haleine, et ça ne peut se produire du jour au lendemain, mais le fait de comprendre la culture et de l’accueillir sèmera les graines d’une désescalade de l’extrémisme à l’avenir. Il dit du Canada, où il habite depuis un an,
« De nombreux immigrants viennent au Canada et c’est bien ainsi puisqu’ils apportent avec eux une grande quantité de connaissances de l’extérieur. Mais nous devrions avoir un plan pour intégrer ces gens et leur culture. C’est bien beau d’accueillir beaucoup d’immigrants et de réfugiés. Mais on doit compter sur un plan pour les intégrer à la société canadienne. Les voir vivre avec d’autres Canadiens de manière intégrée, pour qu’ils ne soient pas perçus comme “l’autre”, ce qui est actuellement le cas pour nombre d’entre eux. C’est bien que nous ayons un pays multiculturel, mais nous pourrions faire beaucoup plus pour tirer profit de ce multiculturalisme afin de rendre le Canada meilleur. »

Dre Wendy Darr

Dr Allister MacIntyre

Dr Damian O’Keefe
Dre Wendy Darr, Dr Allister MacIntyre, Dre Susan Dowler et Dr Damian O’Keefe, Psychologie du milieu militaire
Les psychologues dans l’armée jouent de nombreux rôles, de la sélection du personnel à la conception de la formation en passant par un certain nombre de rôles thérapeutiques. Nous avons échangé avec la Dre Wendy Darr, le Dr Allister MacIntyre, la Dre Susan Dowler et le Dr Damian O’Keefe pour en apprendre davantage sur le sujet.
Psychologie du milieu militaire
Au milieu des années 1980, « un véritable exercice militaire était mené en Europe, impliquant des pays de partout dans le monde. Les Allemands de l’Ouest ont été chargés de la “guerre psychologique”. Il s’agissait d’un exercice d’entraînement et tous les individus qui y étaient engagés savaient que ce n’était pas une vraie guerre. Les Allemands de l’Ouest ont rédigé un seul tract qui a mis un terme à tout l’exercice. Ils ont attendu la fin de la deuxième semaine de l’exercice. Les soldats de première ligne avaient dormi dans la boue, ils étaient crasseux et ils étaient fatigués. S’ils dormaient un peu, ils étaient privés de sommeil – en fait, ils se sentaient absolument malheureux. Le tract que les Allemands de l’Ouest ont distribué ressemblait en tout point à une publicité de la pizzeria du coin, offrant de livrer des pizzas gratuitement à leurs camarades de l’échelon arrière : les infirmiers, les personnes chargées de l’approvisionnement et celles qui n’étaient pas au combat. Quand les soldats sur le terrain ont réalisé que pendant qu’ils vivaient dans la boue et mangeaient des boîtes de rations, leurs collègues soldats étaient derrière eux, à manger de la pizza gratuite, ils se sont dit merde, et ils ont démissionné. On ne ferait pas ça dans un vrai scénario de guerre, mais dans ce scénario en temps de paix, l’énorme écart entre leurs conditions de vie et ce qu’ils percevaient des conditions de vie des autres a suffi pour qu’ils décident de ne plus jouer le jeu ».
Le Dr Allister MacIntyre a passé 31 ans dans les Forces armées canadiennes en tant qu’officier de sélection du personnel. Il est titulaire d’un doctorat en psychologie sociale, mais sa thèse portait davantage sur les comportements au travail : la culture, le climat et le leadership au sein de l’Aviation royale canadienne. Quand il était encore un militaire en uniforme, il s’est rendu en Allemagne de l’Ouest. Il y a suivi un cours offert par l’armée sur la guerre psychologique, destiné aux officiers de l’OTAN. Il intègre aujourd’hui certains des principes qu’il a retenus au cours sur l’influence et la persuasion qu’il donne au Collège militaire.
En général, quand nous pensons à la guerre psychologique, nous pensons aux militaires américains faisant jouer du Van Halen à tue-tête pendant des jours pour faire sortir Manuel Noriega de sa forteresse au Panama. (Le fait de lancer Panama de Van Halen dans ce scénario était, selon l’humble avis de l’auteur de ces lignes, un moyen plutôt ringard et beaucoup trop direct.) Récemment, le soi-disant convoi de la liberté qui a bloqué Ottawa pendant trois semaines a été accusé de mener une guerre psychologique par les politiciens, les juges et les forces de l’ordre, parce qu’ils ont usé de leurs klaxons incessants et de sirènes stridentes pour perturber le sommeil et le quotidien des résidents du quartier. Le Dr MacIntyre affirme que le concept général est beaucoup plus vaste que cela.
« La “guerre psychologique” n’est pas vue comme une discipline de la psychologie, elle est beaucoup plus associée à une discipline militaire qui se sert de principes psychologiques. Elle implique des choses comme la propagande, pour influencer vos ennemis et aussi pour obtenir le soutien sur le front intérieur. Les gens croient que la guerre psychologique vise à faire quelque chose à l’ennemi, mais il s’agit surtout d’obtenir le soutien de sa propre nation pour dire “nous faisons vraiment un travail légitime ici”. Certaines des choses que j’ai apprises dans ce cours étaient assez fascinantes pour ce qui est d’apprendre à connaître la culture du groupe que l’on tente d’influencer, en vue de déterminer les déclencheurs à employer pour le faire pencher dans un sens ou dans l’autre. »
Le Dr Damian O’Keefe a un doctorat en psychologie du travail et des organisations et il étudie le comportement humain en milieu de travail. Tout comme le Dr MacIntyre, il compte 30 ans de service militaire et il travaille actuellement à titre de scientifique civil de la Défense à la Division recherche et analyse (personnel militaire) du ministère de la Défense nationale, où il dirige des recherches appliquées pour soutenir les politiques relatives au personnel des Forces armées canadiennes. Il s’empresse de souligner que les psychologues canadiens ne participent pas à la guerre psychologique.
« Nous avons presque tous obtenu nos diplômes au Canada, donc nous respectons tous le code d’éthique de la SCP. S’abstenir de faire du mal représente le principe fondamental qui nous guide. »
L’emploi le plus courant pour un psychologue en uniforme dans les forces militaires canadiennes est celui d’officier de sélection du personnel. La psychologie fait partie des forces militaires canadiennes depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand les psychologues ont aidé l’armée à mettre en place un mécanisme efficace de sélection des volontaires qui allaient occuper divers postes dans l’armée. Depuis, les psychologues sont engagés dans la sélection du personnel militaire. Vous pouvez en apprendre davantage sur les origines de la psychologie dans le contexte militaire et le travail qu’accomplissent actuellement les psychologues dans un chapitre de l’ouvrage Canadian Handbook for Careers in Psychological Science, corédigé par Damian O’Keefe, Samantha Urban et Wendy Darr.
La Dre Wendy Darr travaille aussi à la sélection et à l’évaluation, et elle a récemment remplacé le Dr O’Keefe à la tête de la Section de la psychologie du milieu militaire de la SCP. Elle est également scientifique civile de la Défense et elle dirige des recherches et des analyses relatives au personnel pour les forces militaires. Les recherches de la Dre Darr sont axées sur l’élaboration de nouveaux outils de sélection pour la sélection et le recrutement de personnes qui souhaitent devenir des soldats, des marins et des aviateurs. Elle décrit les critères qui permettent aux candidats d’être acceptés dans l’armée au Canada.
« Nous souhaitons surtout trouver ce que 100 ans de recherche ont déterminé comme le meilleur prédicteur de rendement au travail, c’est-à-dire la capacité cognitive générale. Les forces armées canadiennes forment tout le monde, et une grande part de cette formation est très dispendieuse. Alors, nous voulons nous assurer d’investir dans les personnes qui possèdent les aptitudes et la capacité de réussir, particulièrement dans les emplois plus techniques. Ainsi, à la base, nous cherchons à voir si vous êtes sain d’esprit et possédez la capacité d’apprendre. La seconde dimension concerne la personnalité. Êtes-vous compatible avec les exigences d’un environnement militaire? Nous sommes à la recherche de personnes qui adhèrent aux valeurs militaires. Le candidat a-t-il l’aptitude innée de réussir dans un milieu reposant sur des règles, d’être organisé et structuré, et d’agir comme un meneur lorsque nécessaire? Nous cherchons également des personnes qui ont ce qu’il faut pour offrir un bon rendement dans un contexte d’adversité. Êtes-vous stable sur le plan émotionnel? L’entraînement militaire peut être ardu, alors nous voulons nous assurer que les gens ont ce qu’il faut pour composer avec les pressions de l’entraînement. »
Les forces militaires comptent sur toutes les disciplines de la psychologie. Elles disposent de psychologues du travail et des organisations, de psychologues spécialisés en psychologie sociale et de psychologues cliniciens pour soutenir les militaires lorsqu’ils sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ces psychologues travaillent dans les cliniques militaires et dans certaines unités spécialisées. La vaste majorité des psychologues travaillent dans les 31 cliniques militaires situées partout au Canada, qui comprennent sept centres de soutien pour trauma et stress opérationnels (CSTSO) et prodiguent des soins de santé mentale très semblables à ce qui est offert dans les hôpitaux. (Aussi tiré du Canadian Handbook for Careers in Psychological Science.)
La Dre Susan Dowler est psychologie clinicienne en chef à la Direction de la santé mentale des Services de santé des Forces canadiennes. Elle est la responsable principale de la pratique en psychologie, ce qui signifie qu’elle participe à l’élaboration des lignes directrices relatives à la pratique et à la conformité, mène des enquêtes en cas de problèmes et met en place des formations éducatives. Au contraire des officiers de sélection du personnel, les psychologues cliniciens sont toujours des civils.
« Pour ce qui est des psychologues cliniciens, ils ne sont pas membres du personnel militaire, ils ne sont pas des personnes en uniforme. Ils sont soit des employés de la fonction publique ou des professionnels contractuels. Certains autres pays ont des psychologues cliniciens intégrés aux unités, par exemple les États-Unis, mais en général ce n’est pas le cas au Canada. »
En janvier 1994, Roméo Dallaire envoyait le désormais célèbre ‘fax sur le génocide’ au siège de l’ONU, alertant qu’un génocide était planifié au Rwanda. Quelques mois plus tard, le génocide s’amorçait : entre 500 000 et un million de Tutsis ont été tués sur une période de 100 jours. Dallaire, se sentant abandonné et ignoré par l’ONU et ayant témoigné de mois d’horreurs inimaginables, a beaucoup souffert d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) après le Rwanda. Il a milité en faveur de la création de services de santé mentale spécialisés pour traiter les blessures de stress opérationnel. Le Dr Dowler mentionne que le premier CSTSO a été créé en 1999.
Au fil du temps, les psychologues cliniciens sont de plus en plus engagés auprès de l’armée et ils jouent un rôle essentiel lorsque des problèmes surviennent. La stigmatisation associée à la recherche d’aide en santé mentale a toujours été omniprésente dans la société, mais plus particulièrement dans le milieu militaire où, comme le souligne le Dr MacIntyre, « on s’attend à ce que les gens soient forts ». Le Dr O’Keefe et lui-même se sont tous deux rendus en Australie, pour travailler avec l’armée australienne. Ils ont remarqué, il y a de nombreuses années, que tous les soldats qui avaient été déployés pour quelque raison que ce soit devaient consulter un psychologue à leur retour en Australie. Ce n’était qu’un dépistage, mais cette démarche éliminait une part de l’ostracisme entourant le fait d’avoir à parler à un professionnel, puisque tout le monde devait le faire. Le Dr Dowler indique qu’une pratique similaire est en place dans les forces militaires canadiennes.
« Nous faisons depuis longtemps du dépistage postdéploiement. Entre trois à six mois après le déploiement, les soldats remplissent des questionnaires et ont une entrevue avec un travailleur social. Si une information est jugée comme étant potentiellement problématique, le militaire est orienté vers les services de santé mentale. Pour voir un psychologue, il faut être aiguillé par le personnel médical. »
Le dépistage postdéploiement n’est qu’une partie du processus auquel sont soumis les soldats après avoir participé à des combats. Les psychologues ont ajouté une nouvelle étape pour rendre le retour au Canada et à la vie familiale un peu plus facile et plus réussi. Le Dr O’Keefe explique :
« Quand les soldats reviennent d’un déploiement outremer, ils passent par une “décompression dans un tiers lieu”. C’est-à-dire deux ou trois jours pendant lesquels ils sortent du théâtre des opérations qui étaient potentiellement très difficiles. Ils se rendent dans un endroit très calme et la plupart du temps au climat assez chaud, où ils reçoivent des breffages de la part de gens comme Susan (psychologues cliniciens) et d’autres professionnels qui leur disent “si vous ressentez ce symptôme, voici ce que vous devez faire”. On ne peut pas mettre des soldats dans un avion et les renvoyer chez eux directement d’Afghanistan. Ils ont besoin de temps pour décompresser et pour absorber ce qu’ils ont vécu. Et, évidemment, pour obtenir de l’aide professionnelle s’ils en ont besoin. »
Les psychologues font partie du processus militaire depuis le moment où un individu s’enrôle jusqu’aux années qui suivent sa dernière mission. Ils les aident à s’entraîner, à performer et à guérir pour qu’ils soient aussi sains, adaptés et émotionnellement stables que possible lorsqu’ils se rendront à leur soirée pizza.

Alejandra Botia

Emily Winters
Alejandra Botia et Emily Winters, section des étudiants
Les étudiants en psychologie, comme tous les étudiants, ont eu une adaptation difficile à faire ces deux dernières années. Alejandra Botia et Emily Winters nous ont parlé de ce qu’elles font pour aider leurs camarades étudiants à relever les nouveaux défis posés par la COVID.
Emily Winters est beaucoup moins verte, mesure environ un mètre et demi de plus que Yoda et parle de manière beaucoup moins énigmatique que lui. Elle est étudiante au doctorat en psychologie clinique à l’Université de Regina et elle est la première responsable de la JEDI de la Section des étudiants en psychologie de la SCP. C’est la première année que la Section des étudiants en psychologie dispose d’une personne responsable de la justice, de l’équité, de la diversité et de l’inclusion – eh oui, le nom a été choisi intentionnellement à partir des propositions d’autres membres étudiants.
« Je suis la première personne à occuper ce poste, et j’étais très heureuse lorsqu’on l’a créé. Nous avons déjà commencé à recruter des bénévoles pour former un comité JEDI, et cela devrait bientôt être terminé. Son rôle principal sera de compiler des listes de ressources qui seront mises à la disposition des membres de la section. Nous espérons également organiser un événement en vue du congrès de 2022, destiné aux étudiants et portant sur la justice, l’équité, la diversité et l’inclusion. »
Lorsque le Haut Conseil Jedi a été créé, ses membres ont été choisis très intentionnellement. Plo Koon était un Kel Dor originaire de Dorin – c’est lui qui devait porter des lunettes et un masque pour pouvoir respirer dans certaines atmosphères. Adi Gallia représentait le peuple tholothien, Ki-Adi-Mundi, avec son cerveau binaire, représentait Céréa. Et Mace Windu a été choisi pour satisfaire tous les admirateurs qui aiment vraiment voir Samuel L. Jackson en action. Le comité JEDI de la Section des étudiants en psychologie sera semblable – un comité chargé de la diversité et de l’inclusion doit également veiller à la représentativité.
« Comme il s’agit d’un rôle joué par la section pour les étudiants, c’est un objectif très important pour nous – rendre la population étudiante aussi diverse et équitable que possible. Il est également important de penser à long terme pour que les cliniciens, les chercheurs et les psychologues en général intègrent ces valeurs dans leur travail et leur pratique. J’essaie de garder à l’esprit qu’il ne suffit pas d’augmenter le nombre d’étudiants issus de groupes marginalisés pour obtenir des changements concrets. Cela ne peut être notre seule stratégie. Nous devons nous assurer que les psychologues pensent de cette façon : qui ils embauchent dans leurs laboratoires, à quoi ressemble la composition de leur cabinet. »
Cette idée, à savoir que le simple fait de recruter des étudiants d’origines diverses n’aboutira pas à une diversification à long terme, est également reprise au conseil d’administration de la SCP. Alejandra Botia est étudiante de troisième année en psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique et elle est la présidente de la Section des étudiants en psychologie. Son rôle de présidente consiste notamment à représenter la section au conseil d’administration.
« J’ai rejoint le conseil d’administration à l’été 2020, à une époque où nous discutions beaucoup de la justice sociale et des injustices raciales. Ce qui me plaît le plus dans le fait d’avoir rejoint la SCP à ce titre, c’est de rencontrer des gens comme Emily, et de siéger au conseil d’administration aux côtés de personnes qui travaillent très dur et qui tiennent véritablement à se réunir pour discuter de sujets intéressants et difficiles. Il faut beaucoup de courage et d’humilité pour être capable de se présenter dans ces contextes. Ce que je constate, c’est que le conseil se réunit pour faire cela. Et je suis aussi très inspirée par les étudiants que j’ai rencontrés. Souvent, il faut encore plus de courage pour se montrer dans ce contexte, car en tant qu’étudiants, nous avons souvent moins de pouvoir. Au conseil d’administration, j’essaie de faire en sorte que la parole des étudiants soit de plus en plus entendue. L’une des choses merveilleuses que nous avons faites l’année dernière a été d’élaborer un sondage auprès des membres étudiants pour savoir ce qu’ils attendaient du rôle actuel d’Emily. Qu’est-ce qui était important pour eux? Ce qu’ils voulaient que nous considérions, même le nom. C’est là que je peux vraiment faire le lien entre ce que fait la Section des étudiants et ce que fait le conseil d’administration. »
Les membres du comité exécutif de la Section des étudiants en psychologie ont dû faire leur travail dans une période d’agitation sans précédent, la pandémie ayant fait que les réunions virtuelles sont devenues la norme. Les membres du comité exécutif sont tous désormais comme Ki-Adi-Mundi, qui n’a jamais assisté en personne à une seule réunion du Haut Conseil Jedi et qui s’est toujours présenté sous forme d’hologramme. Cela a présenté des difficultés non seulement pour le comité exécutif, mais aussi pour les étudiants en général.
Selon Emily, « la transition vers l’université a été assez difficile pendant la pandémie, probablement plus difficile qu’elle ne l’aurait été autrement – surtout pour les étudiants de premier cycle. La transition vers l’apprentissage en ligne a été difficile, et beaucoup de gens n’aiment pas ça. Pour certains, cela fonctionne très bien, mais pour beaucoup, c’est un véritable défi. Le fait d’être isolé a également été très difficile pour les étudiants. Beaucoup d’étudiants de mon programme quittent leur province d’origine pour faire des études supérieures. Ils cessent donc de vivre chez leurs parents pour aller vivre complètement seuls dans l’hiver très froid de la Saskatchewan. Être étudiant est difficile, et le fait d’avoir l’impression d’être seul rend les choses encore plus difficiles. »
Alejandra dit qu’en plus de l’isolement, il y a eu de nombreuses difficultés pratiques.
« Par ailleurs, les étudiants nous disent souvent que cela a perturbé leurs recherches et leur travail clinique. L’impossibilité de se rendre sur le campus et de mener leurs recherches comme ils en avaient l’habitude les oblige à faire preuve d’une grande créativité ou à mettre leur travail en veilleuse. Certains stages ne prenaient plus d’étudiants parce qu’ils ne pouvaient pas le faire. Le fait de devoir attendre, et peut-être de reporter certaines exigences de leur programme à cause de la pandémie, a vraiment préoccupé beaucoup d’étudiants. Les problèmes financiers ont également été soulevés – les étudiants ne sont pas très payés, si tant est qu’ils le soient; en raison de la pandémie, ils ont été privés des emplois qu’ils occupaient auparavant et des débouchés auxquels ils avaient accès auparavant. »
Pendant cette période, les liens, de quelque nature que ce soit, sont devenus plus importants que jamais. Le mentorat est l’un des moyens par lesquels ces liens se sont établis dans la Section des étudiants en psychologie. Où serait Luke Skywalker sans le mentorat de Yoda? Ou Anakin sans Obi-Wan… oubliez le dernier exemple. L’année dernière, Alejandra était la responsable du programme de mentorat étudiant de la SCP, et bien que le mentorat se soit toujours effectué de manière virtuelle, les étudiants de premier cycle et leurs mentors de deuxième et troisième cycles se trouvant rarement dans la même ville, et encore moins dans la même école, elle affirme que cette façon de communiquer est devenue plus importante et utile que jamais pendant la COVID.
« Le programme de mentorat a été formidable, en partie parce qu’il a permis d’établir des liens entre mentoré et mentor, mais aussi pour trouver des idées. Plusieurs questions ont surgi : « Je ne peux pas faire de stage, que puis-je faire d’autre? », et ainsi de suite. C’était une situation si peu habituelle, surtout pour des étudiants de premier cycle, que le fait d’avoir quelqu’un qui les aide à la traverser a été un exutoire très agréable. »
La pandémie a mis en lumière de nombreuses divisions au sein de la société canadienne, et plus particulièrement les inégalités dont souffrent plus lourdement que les autres les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur. Les étudiants en psychologie d’aujourd’hui et les membres de la Section des étudiants en psychologie ne font pas exception. Selon Alejandra,
« Les événements que nous avons vécus et dont nous avons été témoins ces dernières années ont également fait des ravages. Je pense aux Noirs et aux Autochtones, aux injustices raciales et à l’oppression systémique que beaucoup de personnes ont subies et continuent de subir. Je pense aussi aux crimes haineux contre les Asiatiques; de nombreux étudiants ont eux-mêmes fait l’expérience de la haine à caractère raciste pendant cette période. Pour les étudiants de couleur, ce fut une période particulièrement difficile. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est si important de continuer à créer des lieux et des occasions permettant aux gens d’entrer en contact les uns avec les autres. »
Emily est maintenant chargée de créer l’une de ces possibilités de contact grâce à l’initiative JEDI. Le groupe vient juste de démarrer, mais elle et le reste du comité exécutif de la section ont une vision particulière de ce nouveau groupe.
« Il est encore tôt et je veux être sûre que le processus sera très collaboratif. Je veux m’assurer que le comité que nous allons créer est le plus diversifié possible du point de vue de la défense des intérêts. Je veux m’assurer qu’il y a, au comité, quelqu’un qui peut se concentrer sur la question des personnes handicapées, quelqu’un qui peut se charger des questions qui touchent les Noirs, etc. Nous voulons nous assurer d’avoir cette représentation dans la mesure du possible, sans attendre de ces personnes qu’elles parlent au nom de toute une communauté et qu’elles représentent un point de vue unique! Pour ma part, l’une des choses que je veux vraiment défendre, c’est la cause des peuples autochtones. Je suis de descendance inuite et européenne. La famille de mon père vient du Nunatsiavut, un territoire qui s’étend le long de la côte du Labrador; c’est donc une cause qui me tient personnellement à cœur. Je pense que c’est le cas pour beaucoup de gens, surtout avec la découverte des fosses dans les pensionnats; c’est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Comme responsable de la JEDI, une chose que j’aimerais faire, c’est de me plonger dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation et les appels à l’action. Pour voir ce que nous pouvons faire dans notre optique, et comme section. Et examiner où nous en sommes dans le domaine de la psychologie en général et où nous pouvons aller dorénavant et ce que nous pouvons mettre en œuvre. Je pense également qu’il est important de se pencher sur la COVID et sur la façon dont elle a touché particulièrement les communautés racisées, car il est évident que la pandémie a eu des répercussions disproportionnées sur les PANDC. »
Ce qu’Emily n’a pas dit – mais aurait peut-être pu dire – c’est « Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Fais-le ou ne le fais pas! Il n’y a pas d’essai. »

Dr Jim Cresswell

Dr Thomas Teo
Dr Jim Cresswell et Dr Thomas Teo, Histoire et philosophie de la psychologie
Le domaine de l’histoire et de la philosophie de la psychologie est un champ d’études très vaste. Il implique en grande partie un mode de pensée axé sur une « vue d’ensemble ». Nous avons échangé avec le Dr Jim Cresswell et le Dr Thomas Teo sur leur manière de percevoir cette vue d’ensemble.
Histoire et philosophie de la psychologie
« Pensez aux films et aux émissions de zombis : les zombis sont littéralement des sous-hommes. Vous pouvez tuer les zombis, les maltraiter sans vergogne, ils n’ont aucun droit. En réalité, vous avez le devoir de tuer les zombis parce qu’ils menacent d’anéantir votre mode de vie. »
Le Dr Thomas Teo est membre de la faculté des études historiques, théoriques et critiques du programme de psychologie de l’Université York. Pendant toute sa carrière professionnelle, il a activement contribué aux avancées en matière de psychologie théorique, critique et historique. Il a commencé par s’intéresser à l’histoire du racisme, a travaillé sur la relation entre la psychologie et le racisme et sur la mesure dans laquelle la psychologie scientifique peut être une forme de violence, que le Dr Teo désigne comme de la « violence épistémologique » (l’épistémologie est une branche de la philosophie s’attardant aux connaissances). Récemment, il a étudié la réémergence de la subjectivité fasciste, reposant sur le concept de sous-humains et le racisme, ainsi que la notion de suprématie culturelle que nous observons en Occident.
« Tandis que le racisme peut dans une certaine mesure reposer sur la science, notamment à l’aide de chiffres et de graphiques, la notion voulant que des gens soient sous-humains ne le peut pas. L’idée d’une classe de sous-humains, pensez aux zombis, constitue strictement une ontologie [la branche de la philosophie qui traite de l’être] visuelle. Vous ‘voyez’ et savez ce qu’est un zombi et vous n’avez pas besoin d’une explication scientifique pour le faire. Et il en est ainsi pour certains individus quand ils voient, disons, des migrants qui arrivent à la frontière. Ils courent, forment une caravane, ils marchent dans la neige, transportant des valises, jusqu’à la frontière, vers un endroit où ils ne peuvent obtenir d’accès “régularisé”. Ce comportement semble “anormal”, déviant de la façon dont les Américains et les Canadiens “ordinaires” se comportent. Cela montre visuellement qu’“ils” ne sont pas comme “nous”, qu’ils sont une classe de sous-hommes. Vous pouvez les maltraiter, les séparer de leurs familles, les mettre en cage. »
Le Dr Teo avance en fait que de les mettre en cage représente un moyen de les faire paraître encore plus sous-humains aux yeux du grand public. Cette situation prend sa source dans une longue tradition de déshumanisation des autres, en les dépeignant comme dégoûtants, parasitaires, hirsutes et désespérés. Ce qui correspond exactement à ce à quoi ressembleront les migrants retenus en cage à la frontière, sans douche ou savon ou nourriture décente, des semaines ou des mois durant.
« Je fonde cet argument sur deux sources, poursuit-il, dont l’une est une auteure américaine [Lothrop Stoddard] qui a écrit sur le “sous-homme”, une catégorie comprenant les “races inférieures”, les gens pauvres, les communistes et les bolchevistes. La seconde source est un manuel éducatif produit par les SS en Allemagne nazie, un livret ayant réellement pour titre “Sous-humain”. Il y avait très peu de texte; il y avait tout bonnement des images qui opposaient les humains aux sous-humains. Les soldats allemands face aux soldats soviétiques; les bonnes mamans allemandes face aux mères juives; l’art allemand face à l’art dégénéré. Tout est visuel, nous pouvons observer que le “sous-humain” ne présente pas les caractéristiques d’un être humain complet. Les personnages représentés semblent être en mauvais état, sales, désorganisés. Cela signifie aussi que n’importe qui peut devenir un sous-homme. Non seulement les Noirs ou les Juifs, mais quiconque est un ennemi de l’Allemagne, Churchill et Roosevelt en faisant partie. Le concept du sous-humain est très malléable. Il ne signifie pas seulement que vous êtes inférieur aux autres, mais aussi qu’il est impératif de faire quelque chose. Si vous êtes un parasite, une coquerelle, un rat, “Je” dois vous exterminer ou vous faire disparaître. »
Le Dr Teo évoque fréquemment la « subjectivité », soutenant que la discipline de la psychologie doit se concentrer davantage sur cette dimension afin de donner un sens à l’immense quantité d’informations que nous avons glanées des études empiriques depuis des décennies. Par exemple,
« Nous avons divisé la subjectivité en pensée, sentiment et volonté. Puis, nous avons divisé la pensée en attention, perception, cognition et mémoire. La mémoire peut être divisée en mémoire à long terme, à court terme et épisodique. Puis, vous examinez la manière dont un seul petit aspect de la subdivision d’une subdivision est lié à un autre petit aspect. Et il devient très difficile de relier le tout à un ensemble, à un point de vue à la première personne (subjectivité). »
Poser un regard sur l’ensemble de la situation est le mantra des personnes qui travaillent dans le domaine de l’histoire, de la théorie et de la philosophie de la psychologie. Le Dr Jim Cresswell est professeur à l’université Ambrose et président de la Section de l’histoire et de la philosophie de la psychologie de la SCP. En plus de son travail dans les sphères de l’histoire et de la théorie, ses champs d’expertise sont, entre autres, la psychologie sociale et culturelle, ainsi que l’immigration et l’adaptation dans le contexte de la recherche communautaire. Il insiste également sur la nécessité d’adopter une perspective plus large.
« En tant que discipline, la psychologie se voit contrainte de composer avec le postcolonialisme, ce qui implique la mise en lumière de biais systémiques, subtils mais omniprésents, à l’égard des gens marginalisés de tout acabit. En psychologie, nous n’avons pas vraiment le bilan le plus reluisant, et cela résulte en grande partie du fait que nous n’avons pas beaucoup de formation nous incitant à réfléchir à ce que signifient nos théories sur le plan des grands enjeux comme la discrimination systémique. Nous focalisons le plus souvent sur le soutien aux individus et sur le travail empirique au moment présent. Or, les psychologues se trouvent ainsi dans une sorte de milieu culturel où se concentrer “uniquement sur ce que la science ou les données indiquent” à propos de l’individu ne passe plus la rampe comme c’était le cas auparavant. Nous devons nous demander comment et pourquoi nos efforts empiriques ont très bien fonctionné pour certaines populations, mais assez mal pour d’autres. » »
Bien que ces entretiens aient été menés il y a quelques mois, plusieurs des propos tenus pas les Drs Cresswell et Teo à ce moment-là trouvent un écho puissant aujourd’hui, particulièrement pour les « autres » populations qui vivent des situations très difficiles à la suite de l’invasion aberrante de l’Ukraine dirigée par Vladimir Poutine, sans compter la propagande aux effluves fascistes et les campagnes de désinformation qui l’accompagnent. Le Dr Teo décrit ainsi la « subjectivité fasciste » :
« Vous pouvez avoir des politiques fascistes, de l’autoritarisme, de la désinformation, de la propagande, et ainsi de suite. La subjectivité fasciste est une dimension individuelle. Si je crois que la richesse ne devrait pas être partagée avec “l’autre”, et que j’étaye ma croyance d’arguments racistes ou sous-humains, alors j’entre dans la subjectivité fasciste. Elle repose sur la notion que la richesse devrait exclure “l’autre” ou que la richesse peut être extraite de “l’autre”. Selon la subjectivité fasciste classique, je peux me rendre dans d’autres pays et extraire la richesse de “ces gens” parce qu’ils sont inférieurs, ils sont des sous-humains, ils sont des parasites. Ils peuvent même être exterminés s’ils deviennent un trop lourd fardeau. »
La pandémie mondiale des deux dernières années est un autre exemple de l’attitude de la société à l’égard de la vie humaine. Le Dr Teo établit une distinction entre ceux qui sont déshumanisés au point où leur extermination n’a que peu d’importance, et ceux qui sont déshumanisés au point où leur mort n’a que peu d’importance, quoique ces deux situations illustrent clairement les deux faces d’une même médaille.
« Nous avons certaines idées sur l’habilité à tuer et l’habilité à mourir. En vertu du nazisme classique, les Juifs sont tuables, tout comme les gitans, les homosexuels, les ennemis, et ainsi de suite. Puisqu’ils sont de races inférieures ou sous-humains, ils n’ont pas le même statut que nous et il n’y a aucun problème à les tuer. L’habilité à mourir est une notion plus intéressante, parce qu’elle nous mène de la subjectivité fasciste plus classique vers sa réémergence à notre époque, où elle s’applique aussi aux démocraties libérales. Dans cette culture, nous tenons des débats, particulièrement en temps de pandémie, où les gens disent que les personnes âgées peuvent être habilitées à mourir, les gens présentant des problèmes médicaux préexistants pourraient être habilités à mourir, les personnes en prison et les travailleurs précaires sont habilités à mourir. Les gens ont fourni des arguments économiques sur l’habilité à mourir de plusieurs de leurs concitoyens : “Si vous voulez préserver votre mode de vie, et votre économie, alors nous devons accepter que certaines personnes meurent.”
Au Canada, nous en avons témoigné depuis longtemps. Les peuples autochtones ont été considérés comme étant tuables, et on pourrait également avancer que dans plusieurs régions des États-Unis, les populations noires sont encore considérées comme tuables, sans conséquence. Actuellement, dans les démocraties libérales, il est impératif que nous discutions de ce problème et de la réalité de l’habilité à mourir, la version plus douce de l’habilité à tuer sous la subjectivité fasciste. »
Cette subjectivité, reposant sur une philosophie impliquant la pensée axée sur une vue d’ensemble et sur les théories fondamentales qui tentent de relier diverses écoles de pensée les unes aux autres, n’est pas nouvelle. Le Dr Cresswell affirme qu’à ses débuts, la psychologie était clairement centrée sur la subjectivité, mais qu’au cours du siècle, elle s’est éloignée du mode de pensée globale. Ce n’est que tout récemment qu’un effort concerté a été investi pour réintégrer de façon signifiante cette philosophie à la psychologie.
« Les premiers psychologues, James, Hall et Piaget pour n’en nommer que quelques-uns, avaient environ 100 ans d’avance sur leur époque concernant la façon de réfléchir à des sujets comme la subjectivité, la recherche et le pluralisme. Le behaviourisme et le cognitivisme, venus plus tard, se sont éloignés de ce mode de pensée initial, qui était plus large et plus systématique. Quand vous regardez en arrière et consultez certains de ces premiers auteurs, vous retrouvez beaucoup d’information pertinente pour le contexte actuel de la discipline de la psychologie.
Les psychologues du 20e siècle se sont largement concentrés sur le travail empirique, tout en délaissant la théorie qui sous-tend ce travail empirique. Le virage culturel a débuté dans les années 1990, provoqué par le discours sur l’éventualité que notre travail puisse être ethnocentrique. Il en résulte un tournant récent, où nous commençons à prêter attention à la théorie qui guide notre recherche et à ce que nous estimons être la signification de nos observations. »
Quoiqu’ils ne soient pas philosophes au sens strict du terme, le Dr Teo et le Dr Cresswell tiennent tous deux des propos plus philosophiques que ne le font la plupart des psychologues. En tant qu’observateurs de l’histoire, ils étudient également l’évolution de la philosophie qui inspire aujourd’hui la discipline. À l’instar de la pensée globale, le Dr Cresswell indique que la pensée philosophique dans la sphère de la psychologie a vu le jour il y a plus d’un siècle.
« Il est probablement plus juste de s’attarder aux personnages comme Sigmund Freud ou William James, en tant que théoriciens ayant mis de l’avant des présuppositions sur la façon d’appréhender le monde. En revanche, pensez à la manière dont les manuels de première et deuxième année parlent d’eux en tant que chercheurs qui ont été “réfutés” par les progrès de la science. Nous disons aux étudiants qu’ils peuvent passer outre à ces figures, sans poser de question sur ce qui est considéré comme de la science et selon qui. Ce message est une posture quelque peu problématique à adopter. Si vous prenez la théorie cognitive et que vous examinez le behaviourisme ou la psychanalyse du point de vue de votre paradigme cognitif, le behaviourisme ou la psychanalyse seront toujours “réfutés”. Si vous examinez la théorie cognitive à travers la lentille du behaviourisme ou de la psychanalyse, la théorie cognitive échouera toujours. Ce que je veux dire c’est que nous devons enseigner aux étudiants à composer avec les paradigmes antérieurs qui ont instauré les conditions permettant le travail empirique. Alors, quand un manuel affirme que nous avons dépassé ceci ou cela, il ignore le fait que la psychologie n’a pas suivi un développement progressif précis à titre de discipline unifiée. En réalité, elle est faite de multiples disciplines et nous devons reconnaître l’existence de différents paradigmes, ce qui suppose de former les étudiants sur la façon de réfléchir à l’histoire et à la théorie. »
Récemment, on a vu l’intérêt croissant que suscite le retour à certaines des périodes où ces idées ont pris de l’importance, particulièrement au tournant du 20e siècle et dans les années 1960 et 1990. Je sais que pour certains, le fait de penser aux années 1990 sous un angle historique pourrait sembler un peu déconcertant. Par exemple, il n’y a que quelques mois qu’Alanis Morisette lançait Jagged Little Pill, n’est-ce pas? (En fait, il y a 26 ans aujourd’hui, elle gagnait un Grammy pour cet album. Elle a maintenant 47 ans.) Le Dr Cresswell affirme que désormais, les années 1990 font réellement partie de l’histoire.
« Prenez Wilhelm Wundt, à qui on attribue le structuralisme et la création du premier laboratoire de psychologie. La moitié de son travail portait sur la völkerpsychologie, qui est la “psychologie de la communauté et des peuples”. Il est utile de revoir une telle théorie culturelle. Un autre corpus littéraire que nous voyons actuellement en histoire et en philosophie concerne la critique et la philosophie continentales. Les gens comme Foucault et les phénoménologues ayant en partie favorisé la naissance de la pensée postcoloniale qui s’est largement répandue travaillaient surtout à l’extérieur de la discipline de la psychologie. Cependant, il est utile de comprendre une telle théorie dans un milieu où nous sommes confrontés à l’injustice systémique. »
Le domaine de la psychologie appelle à se souvenir, et à apprendre, de sa propre histoire. Un aspect auquel nous aussi, en tant que société, devrions nous attarder bien davantage. Je me souviens d’un autre moment historique de la culture pop des années 1990, 1994 pour être plus précis. Une chanson de protestation lancée à la mémoire de Johnathan Ball et Tim Parry, deux enfants tués lors des attentats à la bombe de Warrington perpétrés par l’IRA l’année précédente.
« But you see, it's not me
It's not my family
In your head, in your head, they are fighting
With their tanks, and their bombs
And their bombs, and their guns
In your head, in your head they are crying »
- The Cranberries, Zombie

Dr. Veronica Hutchings

Dr. Reagan Gale
Dre Veronica Hutchings, Charlene Bradford, et Dre Reagan Gale, Psychologie des communautés rurales et nordiques
Vivre dans une petite communauté, en particulier dans le Nord, présente des défis particuliers. Être psychologue dans ces régions comporte également des défis particuliers. Nous avons parlé à la Dre Veronica Hutchings, à Charlene Bradford et à Dre Reagan Gale, de leur travail au Yukon et à Terre-Neuve.
Psychologie des communautés rurales et nordiques
« Les flics ont probablement la vie facile dans une petite ville.
Flic : “Pouvez-vous me décrire votre agresseur?”
Victime : “Oui, il mesurait environ 5’ 10’’…”
Flic : “mmh mmh”
Victime : “Il portait un manteau brun…”
Flic : “mmh mmh”
Victime : “Et c’était… Jim”. »
Je paraphrase un sketch comique d’un humoriste canadien que j’ai entendu un jour à l’émission Juste pour rire. L’identité de l’humoriste et la date du spectacle se sont avérées impossibles à trouver sur Google! Je me souviens d’avoir pensé à l’époque, oui, mais ça doit être difficile aussi pour le flic. La victime connaît Jim, car il connaît tous les habitants de la ville, mais il doit en être de même pour le policier, qui connaît également Jim. La situation est la même pour les psychologues qui travaillent en milieu rural et nordique.
La Dre Veronica Hutchings est psychologue aux services de counseling et de psychologie du campus Grenfell de l’Université Memorial, sur la côte ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est également professeure agrégée aux facultés de médecine et de psychologie. La Dre Hutchings est l’actuelle présidente de la Section de la psychologie des communautés rurales et nordiques de la SCP.
« L’épuisement professionnel est un phénomène courant dans les régions rurales, si l’on considère les relations duelles et le défi que posent les frontières thérapeutiques, auquel on est confrontés dans les petites collectivités. Imaginez que votre liste d’attente s’allonge et que vous vous trouvez dans un petit endroit où les gens savent que vous êtes le seul psychologue ou l’un des rares psychologues de l’endroit. Vous vous retrouvez avec une forte pression : “puis-je prendre cette personne, elle va vraiment mal, puis-je en prendre une de plus?” Cela peut être très épuisant. Je travaille ici, sur le campus Grenfell, et dans la moitié des magasins où je vais, les employés sont des étudiants à qui j’enseigne. J’ai passé 10 ans à Halifax, et pendant cette période, je crois que je n’ai rencontré un client que deux fois! »
La fourniture de services dans les collectivités rurales et éloignées pose d’autres problèmes, parmi lesquels l’accès à Internet, surtout en cette période de pandémie. Mme Charlene Bradford est une psychologue agréée, enregistrée en Alberta, qui exerce en pratique privée au Yukon. Mme Bradford est la présidente de la Psychological Society of the Yukon.
« Au Yukon, nous avons incontestablement des problèmes d’Internet et tout le monde s’en plaint. L’Internet est très cher, et dans les collectivités situées plus au nord, l’accès est très inégal. Il vaut mieux ne pas faire trop de thérapie virtuelle, car il y a souvent un décalage, ou l’écran se fige et on perd contact avec la personne au mauvais moment. Lorsque la pandémie a frappé et que nous avons commencé à faire des choses de manière virtuelle, je suivais une formation sur la prestation de thérapies virtuelles et je me suis dit – bien sûr, cela va fonctionner ici à Whitehorse où les connexions Internet le permettent, mais il est impossible de se fier à la fiabilité de l’Internet dans les communautés rurales.
Au Yukon, nous avons la chance d’avoir une compagnie aérienne exceptionnelle qui dessert régulièrement plusieurs de nos communautés nordiques, ce qui donne lieu à de nombreux vols. Cela aide, mais il faut aussi avoir des cliniciens capables de se déplacer. »
La Dre Hutchings dit que certaines collectivités du Labrador ont les mêmes problèmes d’Internet. Tant à Terre-Neuve qu’au Yukon, certaines petites communautés ont entièrement fermé leurs portes ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas de services psychologiques accessibles par avion. Mme Bradford a vu de petites communautés être durement touchées par le virus, qu’elle qualifie de « dévastateur ». La pandémie avait déjà entraîné une demande massive et des temps d’attente très longs, et les communautés touchées de plein fouet par la COVID n’ont fait qu’accroître le besoin d’aide psychologique.
La pandémie et la petite taille des communautés où travaillent les psychologues dans les zones rurales et nordiques ne sont que deux éléments qui ont une incidence sur la façon de travailler des psychologues et qui font que leur façon de fonctionner soit bien différente en zone urbaine. La Dre Reagan Gale est directrice de la psychologie clinique pour le gouvernement du Yukon. Elle est autorisée à exercer en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et en Ontario, et elle est l’actuelle vice-présidente de la Psychological Society of the Yukon.
« J’ai grandi en Ontario, et ce que je peux dire depuis mon arrivée dans le Nord, c’est que je constate combien la nécessité de mettre l’accent sur la sécurité culturelle et les modes de connaissance et de compréhension autochtones devient encore plus cruciale lorsqu’on se déplace vers le Nord et lorsqu’on travaille dans certaines petites communautés des autres provinces où il y a une grande proportion de membres des Premières nations, d’Inuits et de Métis.
Je pense que les compétences nécessaires pour aider les personnes que nous recevons sont différentes et qu’il faut faire preuve de souplesse. Je reviens tout juste de l’Ontario où j’ai passé une semaine à faire des évaluations dans une communauté où la sécurité alimentaire est un problème majeur, où les enfants ont continuellement faim. Je suis sûre que c’est le cas pour de nombreuses personnes en milieu urbain, mais dans une petite communauté, nous parlons d’une norme culturelle de la faim. Ce n’est pas aberrant ou exceptionnel, c’est une norme dans la communauté : les enfants ont faim. Cela nous incite, en tant que cliniciens, à aborder la pratique différemment. »
Vous avez peut-être remarqué que Mme Bradford et la Dre Gale sont toutes deux « autorisées à exercer en Alberta », même si elles travaillent toutes deux au Yukon. Cela s’explique par le fait que le Yukon est la seule province ou le seul territoire du Canada où les psychologues ne sont pas encore soumis à une réglementation quelconque.
« Le Yukon est la dernière instance canadienne où tout est permis en matière de pratique professionnelle de la psychologie, en l’absence de réglementation, » explique-t-elle.
Si un psychologue du Yukon veut être agréé (et beaucoup le sont), il doit obtenir l’agrément auprès d’un organisme provincial en dehors de son territoire. Selon Mme Bradford, bien qu’il s’agisse d’une solution partielle, elle ne règle pas certains problèmes fondamentaux liés à l’absence de réglementation au Yukon.
« Il n’y a pas d’organisme de réglementation de quelque forme que ce soit au Yukon, de sorte que bon nombre d’entre nous qui exercent la profession de psychologue ont pris l’initiative de demander l’agrément dans une autre province ou un autre territoire. C’est bien, parce que nous passons par le processus de réglementation, mais c’est aussi problématique parce qu’il n’y a pas de réglementation au Yukon, ce qui signifie plusieurs choses. Premièrement, les ordres professionnels auprès desquels nous sommes agréés n’ont qu’une capacité limitée d’appliquer quoi que ce soit en dehors de leur compétence, ce qui est le cas du Yukon. L’autre problème est qu’il y a des gens qui exercent la psychologie et qui ne sont pas agréés au Canada, et ils peuvent le faire parce que ce n’est pas un titre
réservé ici. »
Beaucoup de choses peuvent arriver lorsque des personnes qui ne sont pas tenues d’adhérer à des normes de pratique particulières peuvent se faire appeler « psychologues ». Peut-être n’ont-ils pas satisfait aux critères d’accès à la profession dans un autre territoire. Un psychologue remplit des fonctions délicates et importantes, comme les évaluations diagnostiques. On imagine difficilement à quoi pourrait ressembler cette démarche pour les clients, dont beaucoup sont très vulnérables, lorsqu’elle est effectuée par une personne qui n’a pas les qualifications requises. La Dre Gale voit souvent cela dans son travail.
« En ma qualité de directrice de la psychologie clinique pour le gouvernement du Yukon, des gens me téléphonent pour me demander quelles sont les possibilités de pratique au Yukon. C’est souvent parce qu’ils n’ont pas satisfait aux exigences requises pour avoir l’autorisation d’exercer dans une autre province ou un autre territoire. Peut-être ont-ils passé l’EPPP (Examination for Professional Practice in Psychology) le nombre maximum de fois prévu et n’ont pas pu le réussir, de sorte qu’ils ne peuvent pas obtenir l’agrément dans la province ou le territoire dans lequel ils résident. Des cliniciens qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de leur organisme de réglementation et qui pourraient perdre leur droit d’exercer en tant que “psychologue” ont également pris contact avec moi. Le Yukon est le seul endroit où il n’y a aucune interdiction de ce type de pratique. »
Comment peut-on corriger la situation? Et pourquoi le Yukon est-il la dernière instance au Canada à adopter une réglementation? Mme Bradford affirme que les deux autres territoires du Canada ont un système qui pourrait être reproduit au Yukon.
« Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont conclu une entente avec le College of Alberta Psychologists, qui s’occupe de la réglementation. Nous aimerions avoir cela au Yukon, et les raisons en sont nombreuses. L’une des plus importantes est que nous sommes un petit territoire. La réglementation protège vraiment les gens. Si les choses ne se passent pas bien avec votre psychologue, ou si quelque chose vous semble bizarre, il existe une procédure de plainte. Dans une petite communauté, vous voulez être sûr lorsque vous déposez ces plaintes qu’elles ne seront pas adressées à votre ami, votre voisin, quelqu’un que vous croisez à l’épicerie [comme Jim]. Un grand organisme de réglementation offre cette protection aux habitants des petites provinces ou des petits territoires comme le nôtre. C’est le modèle que nous essayons d’adopter. »
La Psychological Society of Yukon est très petite, en ce sens qu’elle ne compte que 12 membres – des psychologues qui se sont regroupés pour collaborer et défendre les choses qui sont importantes pour eux.
« Notre association a pour objectif de promouvoir l’accès à des services psychologiques de haute qualité fondés sur des données probantes pour les Yukonais, dont beaucoup vivent dans des communautés nordiques éloignées. Bien sûr, Whitehorse est une ville nordique et rurale pour une grande partie du Canada, mais nous parlons de communautés beaucoup plus petites que Whitehorse. Elle a un autre objectif, à savoir défendre la réglementation de la psychologie. Je ne veux pas parler au nom des 12 membres de l’association, mais nous sommes ouverts à toute voie jugée la plus durable pour notre ministère des Services aux collectivités, qui est le ministère du gouvernement qui détient la compétence en cette matière. Personnellement, je pense que nous sommes un groupe trop petit pour nous autoréglementer. Pour ma part, je préférerais conclure un accord avec une instance du Sud. Mais si le gouvernement peut le faire, nous voulons nous associer à lui pour y parvenir. »
Mme Bradford se souvient d’un moment mémorable à l’Assemblée législative du Yukon – oui, il y a des débats à l’Assemblée législative du Yukon qui, bien que peu connus du reste du Canada, peuvent être mémorables!
« Le chef de l’opposition interrogeait la personne qui est censée encadrer la profession de psychologue. Il a dit : “Si je comprends bien, en l’absence de réglementation, je peux mettre ma propre plaque indiquant ‘Services psychologiques de Currie’, est-ce exact?” Le ministre responsable a dit “Oui, c’est ce que je comprends” ».
La question de la réglementation a deux volets. La réglementation de la psychologie instaure une norme de pratique qui garantit que les psychologues qui fournissent des services aux personnes dans les communautés rurales et nordiques le font à l’aide de méthodes fondées sur des données probantes; qu’ils seront guidés par des normes professionnelles qui, au minimum, tentent de ne pas nuire aux personnes avec lesquelles ils travaillent. Le deuxième avantage de la réglementation est de créer un mécanisme de plainte, de sorte que les personnes qui sont lésées par les services fournis disposent de recours et d’une procédure à suivre. La réglementation ne peut pas empêcher tous les préjudices, mais elle fournit un ensemble de règles qui réduisent au minimum les dommages potentiels. Selon Mme Bradford, le problème devrait être assez facile à résoudre.
« De notre point de vue, il n’y a pas beaucoup de raisons de ne pas aller de l’avant. Reagan a consulté des représentants juridiques pour savoir quelle est la façon la plus simple de faire avancer les choses, et cela pourrait être aussi simple qu’un protocole d’entente avec le College of Alberta Psychologists. Nous comprenons qu’il s’agit simplement d’un décret du gouvernement. »
Et pourtant, ce n’est pas encore fait. La Dre Gale nous en dit un peu plus.
« Les obstacles sont les obstacles normaux à l’élaboration des lois par le gouvernement. Notre gouvernement est petit et notre territoire est petit. Les membres de notre société sont reconnaissants pour les travaux de délivrance de permis que le gouvernement fait déjà. Il ne s’agit pas de critiquer les importants efforts en matière de réglementation qui sont déjà en cours – mais simplement que dans une région aussi petite, la capacité en ressources humaines pour ajouter une autre profession est une tâche difficile. Nous pensons que ce n’est pas beaucoup demander, mais dès qu’on élargit l’offre d’un gouvernement, il y a une décision politique qui se prend. Nos efforts de lobbying ont porté leurs fruits lors des élections territoriales du printemps 2021, et les trois partis se sont engagés à réglementer la psychologie, mais c’est le parti dont l’engagement était le plus vague qui a fini par former le gouvernement. Mais nous sommes chanceux que les deux autres partis soient intéressés et que le sujet de la réglementation soit abordé à l’Assemblée législative. »
L’un des avantages supplémentaires en aval de la réglementation est la stabilité. Mme Bradford est au Yukon depuis 19 ans (pas toutes en tant que psychologue agréée) et elle a vu un véritable changement dans le paysage de la santé mentale du territoire.
« Les gens qui travaillent comme psychologues au Yukon, et qui sont agréés, sont ici depuis un certain temps. Nous sommes investis dans la collectivité, nous assurons la continuité des services et nous établissons une relation de confiance qui a la possibilité de se développer au fil des ans, car les gens consultent la même personne. Dans le passé, il y avait un certain roulement, car les personnes qui occupaient certains postes en santé mentale n’avaient pas toutes forcément le même niveau de formation ou de connaissances pour être en mesure de gérer toutes les situations. Elles n’ont peut-être pas mis l’accent, comme la psychologie le fait, sur l’importance de prendre soin de soi et la prévention de l’épuisement. J’ai donc vraiment remarqué ce changement, car il y a maintenant plus de psychologues, et les gens restent, le roulement est réduit et les services sont plus efficaces. »
Ce type d’évolution vers les pratiques exemplaires, les traitements fondés sur des données probantes et la stabilité s’est également produit dans d’autres provinces et territoires. La Dre Hutchings est la première psychologue à travailler aux services de counseling et de psychologie du campus Grenfell.
« Il y a sept ans, lorsque je suis arrivée ici, on a fait pression pour que mon prédécesseur soit remplacé par un psychologue, car on reconnaissait l’importance de la psychologie. Il y a 10 ans, sur le même campus, il n’y avait pas de formulaires de demande ni de procédures pour obtenir le consentement. Les cliniciens qui y travaillaient n’étaient pas agréés par un organisme officiel. Désormais, il existe un processus, une procédure de consentement éclairé et un service plus structuré qui fonctionne dans un cadre réglementé. »
Les personnes vivant dans des communautés éloignées ont des besoins différents de ceux des petites communautés, bien qu’il y ait beaucoup de chevauchements. Par exemple, les communautés qui doivent être approvisionnées par avion peuvent avoir plus de difficultés à avoir accès à la nourriture, ce qui a des répercussions importantes sur la santé mentale. Cela signifie que pour les psychologues qui travaillent dans ces régions, il n’existe pas d’approche unique. Les statisticiens ont débattu pendant des années de ce qui constitue les communautés « rurales », et la Dre Hutchings tente de définir ce que « rural » signifie réellement pour les psychologues.
« Tout ce qui est au Nord est rural, mais tout ce qui est rural n’est pas au Nord. Et il existe des degrés de ruralité différents, bien sûr. Par exemple, Cornerbrook (population d’environ 20 000 habitants), où je me trouve, est une sorte de plaque tournante de la côte ouest de Terre-Neuve. Mais pour toute intervention médicale importante, il faut quand même faire huit heures de route pour aller à St. John’s. C’est un peu subjectif, mais je définis la ruralité principalement par la taille de la communauté, puis aussi par la distance qui la sépare d’un centre plus “urbain”. »
Ou, plus simplement, plus vous êtes en milieu rural, plus vous avez de chances de connaître Jim.

Dr Stryker Calvez

Dr David Danto
Dr Stryker Calvez et Dr David Danto, Psychologie des peuples autochtones
Aujourd’hui, la psychologie est confrontée à la nécessité de modifier ses pratiques pour accueillir les personnes autochtones et attirer des praticiens autochtones, et la Section de la psychologie des autochtones affirme que cela impliquera des discussions importantes et difficiles. Nous avons parlé de la question avec le Dr Stryker Calvez et le Dr David Danto.
Psychologie des peuples autochtones
« Le poisson est le dernier à découvrir l’eau. »
Le Dr Stryker Calvez est un Métis du territoire de la rivière Rouge, qui vit actuellement dans le territoire du Traité 6, à Saskatoon. Autrefois directeur des initiatives pédagogiques autochtones à l’Université de la Saskatchewan, il est aujourd’hui directeur principal, stratégie et habilitation en matière d’équité, de diversité et d’inclusion chez Nutrien. Le Dr Calvez est également le président de la Section de la psychologie des autochtones de la SCP et membre de longue date du Groupe de travail sur le partage des connaissances/comité permanent sur la réconciliation avec les peuples autochtones, aux côtés du Dr David Danto.
Le Dr David Danto est psychologue clinicien de formation, et le directeur du programme de psychologie de l’Université Guelph-Humber. Il a participé à un certain nombre d’efforts visant à autochtoniser et à décoloniser la psychologie, les établissements et les universités. Il est le président sortant de la Section de la psychologie des autochtones.
Eric Bollman est le spécialiste des communications de la Société canadienne de psychologie.
La conversation qui suit a eu lieu le 24 novembre 2021. Depuis, 93 tombes non identifiées ont été découvertes dans un ancien pensionnat de Williams Lake, en Colombie-Britannique. Douze ont été trouvées à Kamsack, en Saskatchewan, et 42, à Fort Perry, en Saskatchewan.
Eric : Je crois savoir qu’il est question de changer le nom de la Section de la psychologie des peuples autochtones pour mieux rendre compte de la nature collaborative du travail – pour se concentrer davantage sur le travail avec les peuples autochtones plutôt que d’en faire une section exclusivement consacrée aux peuples autochtones. Qu’est-ce qui a déclenché cette discussion?
Dr Calvez : Lorsque le nouveau comité de direction a été mis en place il y a environ un an, nous avons réalisé que nous étions majoritairement des non-Autochtones. En tant que communauté de personnes désireuses de soutenir les peuples autochtones du Canada, nous devrons peut-être changer notre façon de fonctionner. Nous devions donc vraiment réfléchir aux mécanismes de la section. La section a été conçue à l’origine pour soutenir les psychologues autochtones du Canada, pour leur donner un espace sûr et une plateforme pour s’exprimer. Bien que ce soit toujours notre mandat, nous voulions aussi reconnaître qu’il y avait un groupe croissant de personnes qui voulaient être utiles et apporter leur soutien. C’est pourquoi nous avons pensé que le nom devait en être le reflet. Plutôt que d’être une section constituée d’Autochtones, ce que nous devions faire, c’était travailler avec les Autochtones et réunir autant de personnes que possible pour créer un environnement sûr, où se trouve tout ce dont ils ont besoin et où discuter courageusement de ce qui leur est arrivé et de la façon de dépasser ce qu’ils ont vécu. Le changement de nom est censé traduire le développement d’une communauté qui veut travailler avec et pour les peuples autochtones. Et je pense que nous le faisons de la bonne façon. Nous avons beaucoup d’alliés, comme David.
Dr Danto : Il y a quelques années, j’ai travaillé avec Stryker à l’élaboration d’une réponse au rapport de la Commission de vérité et réconciliation au nom de la Société canadienne de psychologie et d’Esprits Sains Enfants Sains (connu à l’époque sous le nom de Fondation canadienne de psychologie). Ce qui est ressorti clairement des personnes présentes et des participants à ce processus, c’est que la psychologie n’a pas été une grande amie des peuples autochtones dans le passé, et même encore aujourd’hui, dans de nombreux cas. Cela est dû en grande partie à l’introduction dans les communautés autochtones d’une perspective et d’une approche occidentales externes de la psychopathologie, de la santé, du concept de la famille ou de la personnalité, etc. Et c’est dangereux. C’est ainsi que la psychologie a fait du mal aux gens. Cela s’est produit dans le contexte de l’éducation, de la recherche et de la pratique appliquée. Pour essayer d’appliquer nos principes éthiques sur un pied d’égalité avec tous les habitants de notre pays, nous avons la responsabilité de modifier ces pratiques néfastes et d’utiliser des approches adaptées. Nous devons poser les questions suivantes : « Comment la psychologie peut-elle être une bonne amie des peuples autochtones du Canada? » « Comment pouvons-nous être d’un bon soutien? » Dans bien des cas, je pense que la réponse à cette question est que nous pouvons respecter et reconnaître le fait qu’il existe déjà des méthodes de guérison, une sagesse et des connaissances qui sont utiles, qui favorisent la résilience, la force et le bien-être au sein des communautés. Comme je m’efforce d’apporter mon soutien de cette manière, je me demande ce que je peux faire au sein de ma profession pour encourager celle-ci à respecter davantage les modes de connaissance et de guérison autochtones et à faire preuve d’une plus grande humilité à leur égard. Ce n’est pas que la psychologie ne peut pas ou ne doit pas s’impliquer, mais nous devons décentraliser les approches que nous utilisons, et laisser la communauté locale guider et diriger ce qui a besoin d’être fait.
Dr Calvez : Il y a 1,7 million d’Autochtones au Canada et 38 millions de Canadiens. La (ré)conciliation ne concerne pas nécessairement que les Autochtones. Bien que les conséquences de la colonisation aient été principalement ressenties par les Autochtones, Murray Sinclair affirme que cette dernière a également porté préjudice aux non-Autochtones. Si l’on considère le mouvement actuel en psychologie, qui vise à répondre aux besoins des communautés autochtones du Canada, on constate qu’il n’y a pas assez de psychologues autochtones et pas assez de personnes formées adéquatement pour les soutenir. Nous devons donc réellement travailler avec des alliés, c’est-à-dire des personnes qui sont prêtes à investir du temps pour se familiariser avec les besoins des communautés autochtones et les comprendre, afin de fonctionner en tenant compte de leurs attentes.
Eric : David, vous avez parlé d’« humilité ». Est-ce la chose la plus importante qu’un allié doit posséder lorsqu’il entre dans cet espace?
Dr Danto : Tout ce que nous apprenons en psychologie concerne les façons de penser. Nous parlons de preuves « empiriques », et le mot « empirique » tire sa racine dans le mot « empeirikós », qui signifie « guidé par l’expérience ». Mais une grande partie de la méthodologie utilisée en psychologie a évolué pour se concentrer sur ce qui est objectif et ce qui est quantifiable objectivement. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais lorsque nous parlons de l’expérience humaine, cela représente une abstraction de l’expérience. Le terme « empirique » a pris le sens de « quantitatif », mais ce n’est pas la même chose. « Empirique » signifie en réalité « conforme à l’expérience », et lorsque nous quantifions les choses, nous nous éloignons vraiment de cette description de l’expérience. C’est une façon de faire très occidentale. Nous respectons certains types de recherche en psychologie qui ne sont pas forcément adaptés aux conceptions et aux expériences culturelles de l’histoire. Parfois, ces approches occidentales de la connaissance nous enferment dans une ornière, je crois, qui nous fait penser que ce sont les seuls moyens de savoir qui soient valables, testables, vérifiables et concluants. Et cela signifie que nous manquons d’humilité face à d’autres modes de connaissance qui nous semblent inférieurs. Cela nous incite à ne vouloir mener que certains types de recherche dans des contextes qui ne s’y prêtent pas vraiment. Lorsque nous allons dans les communautés et utilisons des méthodes qui ne sont pas très adaptées, nous perdons le lien avec les participants à cette recherche. Ensuite, nous prenons les informations obtenues et nous les utilisons à notre manière, comme tout chercheur universitaire, et cela ne revient jamais à la communauté, la communauté n’a jamais l’occasion de donner son avis parce que les choses ne se font pas dans sa langue. Ce n’est pas une démarche participative ou collaborative, c’est plutôt une approche descendante. Et on se retrouve exactement dans la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous nous retrouvons avec des communautés qui ne font pas confiance aux universitaires et aux chercheurs, parce que, en faisant de la recherche en son sein, ils prennent une chose de plus de la communauté. On a pris la terre, on a pris les droits, et maintenant on prend le savoir, et au profit de qui? Au bénéfice de l’université et du chercheur, et non pour le bien-être de la communauté. Je pense que l’humilité est essentielle pour admettre qu’il y a de nombreuses façons de considérer les choses, et si vous pouvez prendre du recul et reconnaître que votre formation limite vraiment les possibilités qui peuvent être envisagées, plutôt que de les révéler – ce que ces méthodes sont censées faire!
Dr Calvez : Une autre facette de l’humilité culturelle est que l’éducation et le savoir occidentaux proviennent d’une position dominante. Toute la structure hiérarchique du monde occidental est construite de telle sorte que les uns dominent les autres en fonction de leur niveau d’éducation ou de leur groupe culturel. Et cela est intégré dans notre façon de voir le monde. L’humilité culturelle est un processus par lequel nous reconnaissons ce fait et le combattons. Nous devons décortiquer tout cela dans le contexte de la décolonisation, et l’humilité culturelle nous donne les outils nécessaires pour le faire.
Ce qui pourrait être plus important que l’humilité, c’est l’engagement. Le processus de (ré)conciliation va demander un effort énorme et va créer des tensions. Si l’on ne s’engage pas à aller jusqu’au bout de ce que nous tentons de faire, à savoir apporter la guérison aux peuples autochtones et non autochtones et au domaine de la psychologie, nous ne pourrons pas y arriver si les gens ne s’engagent pas à concrétiser leurs intentions.
Eric : Essayez-vous parfois de recruter davantage de personnes pour participer à cette (ré)conciliation, pour en faire des alliés, ou vous concentrez-vous davantage sur la création d’un espace où ces alliés peuvent apprendre et grandir aux côtés des Autochtones?
Dr Calvez : Un aspect important de la (ré)conciliation est que les gens doivent la trouver en eux-mêmes. Le point de départ est non pas de reconnaître les problèmes et de trouver des façons de les résoudre, mais de se connaître soi-même. Et se connaître en relation avec les peuples autochtones et avec une histoire plus que millénaire. Les gens doivent le découvrir par eux-mêmes. Plutôt que de la promotion [aller vers les gens pour les recruter afin qu’ils deviennent des alliés], il faudrait plutôt parler d’attrait [créer un espace où les gens veulent devenir des alliés et aller vers vous]. Nous voulons montrer aux gens que ce que nous faisons n’est pas nécessairement un droit absolu, quelque chose qui doit être fait – même si je pense que c’est vrai. Nous voulons leur montrer que cela profitera à tout le monde, y compris à notre profession. Il y a une bonne façon de procéder : nous en tirons tous des leçons, nous en profitons tous. Je pense que cela se fait non pas en disant aux gens qu’ils doivent le faire, mais en leur montrant les raisons pour lesquelles ils pourraient vouloir le faire. Les personnes qui se joignent à nous sur la base de leurs propres choix sont beaucoup plus à même de faire preuve de l’engagement dont j’ai parlé précédemment et de l’humilité culturelle.
Dr Danto : Dans le contexte postsecondaire, je pense que nous devons nous concentrer sur la création de lieux d’enseignement postsecondaire accueillants et culturellement sûrs, qui favorisent une pédagogie appropriée, réfléchie et critique pour les étudiants autochtones et non autochtones, plutôt que de recruter des étudiants autochtones. Si vous vous efforcez de poser les bonnes questions, de faire preuve d’autocritique à l’égard des processus mis en place et de créer un environnement sûr et culturellement accueillant, les gens seront plus nombreux à vouloir participer à ce que vous faites. Les Autochtones ont eu des expériences vraiment négatives en classe dans le cadre des cours de psychologie. Il y a des mythes sur les prédispositions génétiques, des hypothèses et des préjugés et des partis pris du fait de la longue histoire de la colonisation. J’utilise toujours l’expression « Le poisson est le dernier à découvrir l’eau ». Nous sommes tellement ancrés dans le contexte de la colonisation, qu’il s’agisse de la psychologie, des soins de santé ou de l’éducation, que même avec de bonnes intentions, il nous est très difficile de nous en rendre compte. Nous devons examiner attentivement les espaces dans lesquels nous invitons les Autochtones, car il se pourrait bien qu’ils soient exposés à de nouvelles expériences traumatisantes s’ils sont confrontés à des commentaires erronés, dépassés ou injustifiés. Nous avons le devoir d’être protecteurs.
Dr Calvez : Lorsque vous vous efforcez de recruter des gens uniquement parce que vous voulez plus d’Autochtones dans votre programme, c’est égoïste. Ce qui compte pour vous, ce ne sont pas les Autochtones, leurs besoins ou leurs désirs. Si c’est l’approche que vous adoptez pour soutenir les populations autochtones, vous échouerez à chaque fois. Nous devons modifier l’environnement pour que les autochtones y voient un lieu attrayant et intéressant où se poser. Que les choses soient claires : les collectivités autochtones ont tout autant besoin de professionnels de la santé mentale que le reste de la société. Nous devons nous y mettre maintenant, sans savoir avec certitude si nous allons attirer ces personnes, mais simplement parce que nous devons le faire comme communauté et comme profession. Je pense que nous allons dans cette direction. Beaucoup de changements ont été observés ces dernières années. Il va falloir que cela continue et s’accélère afin d’accroître l’intérêt des gens vis-à-vis de ce travail. Une fois qu’ils seront intéressés, ils se rendront compte que nous n’entravons rien de ce qui existe déjà dans la profession – au contraire, nous élargissons les possibilités et créons un espace plus vaste et plus ouvert pour que davantage de personnes trouvent ce qu’elles recherchent dans la profession.
Eric : Au cours des deux dernières années, on a découvert d’horribles fosses communes sur les sites des anciens pensionnats. Je pense que les Canadiens blancs ont été beaucoup plus choqués que les communautés autochtones, qui nous parlent depuis des années de l’existence de ces fosses communes. Est-ce vrai, et est-ce que cela a changé votre façon de travailler pour la (ré)conciliation?
Dr Calvez : Je pense qu’il est vraiment important de reconnaître que lorsque ces événements se produisent, ils traumatisent à nouveau les peuples autochtones. Nous sommes très affectés, car cela confirme ce que nous défendons depuis longtemps. Que la société canadienne ne nous a pas bien traités, et qu’elle est allée jusqu’à blesser et tuer des enfants pour en attester. Pour une personne issue de ces communautés, c’est l’expérience la plus horrible que l’on puisse vivre, de voir que même ses enfants ne sont pas en sécurité. J’ai des amis qui sont des survivants, et quand cela arrive, ça vous coupe le souffle, et il faut beaucoup de temps pour retrouver la conviction que tout va bien aller. C’est arrivé plusieurs fois cet été seulement. Nous savions que c’était grave, mais je ne pense pas que nous en connaissions l’ampleur. Je me réjouis que des personnes non autochtones réagissent à une situation qu’elles ne connaissaient pas. Réagir ainsi est tout à fait justifié – et il faut le faire. Mais imposer cette réaction aux Autochtones pour les aider à y faire face n’est pas forcément la meilleure chose à faire. Nous avons besoin que d’autres personnes se lèvent et s’expriment afin que nous n’ayons pas nécessairement à être sur le devant de la scène pendant que nous essayons de guérir. Voilà où nous allons en tant que profession. Nous devrions être en mesure de prendre la parole tout en reconnaissant qu’il est tout à fait inadéquat d’aller voir les personnes qui ont été blessées pour valider notre réaction. C’est un processus émergent, et tout cela est nouveau pour nous. Voilà ce qu’est la (ré)conciliation, c’est une idée nouvelle, que nous n’avons jamais vue ou eue auparavant. Nous allons devoir la découvrir et la construire à partir de nos expériences et de notre compréhension. Je pense que l’indignation que nous avons observée dans les communautés autochtones et non autochtones nous montre que nous allons dans la bonne direction parce que désormais, nous savons comment agir lorsque les gens sont extrêmement perturbés. Nous avançons dans la bonne direction en ce sens que nous essayons à présent de nous soutenir mutuellement dans ces processus. Je pense que c’est un moment fort pour nous en tant que communauté et en tant que société. Nous allons devoir faire face à de nombreuses tensions à mesure que de nouvelles révélations seront faites et que nous vivrons de plus en plus cette situation. Le plus important, ce sont les discussions que nous aurons sur ces questions et sur d’autres sujets – et ces discussions risquent d’être difficiles. Nous devons être prêts à discuter de ces questions, à la fois en tant que profession et en tant qu’individu.
Dr Danto : Je pense personnellement qu’un génocide a été commis à l’encontre des populations autochtones de notre pays. Il ne s’agit pas d’un « génocide culturel ». Mais d’un véritable génocide. Nous trouvons des corps sur les sites des pensionnats, et il ne fait aucun doute que nous en trouverons beaucoup d’autres, et que peu importe combien de corps seront retrouvés, beaucoup d’autres ne le seront pas. Je ne suis pas un Autochtone, mais je reconnais que cela s’est produit dans notre pays – qu’ici, dans notre pays, de nombreux Autochtones ont été tués en raison de leur identité. Si nous ne voulons pas l’admettre, nous devons nous demander pourquoi nous refusons de le faire. Pour moi, il est évident que c’est ce qui s’est passé. Pour avancer, cela fait partie de la vérité. Quand on nomme quelque chose, on a la responsabilité d’agir en conséquence.
Eric : Pourquoi les gens utilisent-ils le terme « génocide culturel » même s’il semble évident que ce qui s’est passé est un véritable génocide? Est-ce une façon de minimiser les dommages causés, ou d’utiliser un terme qui n’exige pas autant d’introspection de leur part, ou est-ce autre chose?
Dr Danto : Le système des pensionnats pour Autochtones au Canada a toujours eu pour but de « sauver » l’enfant tout en détruisant son côté autochtone. La rupture des liens culturels avec leur communauté et leur famille. Bien que cela ait pu être l’objectif déclaré du système des pensionnats et des adoptions forcées, les choses sont allées beaucoup plus loin. De nombreuses personnes ont perdu la vie dans ce système, et dans ces établissements financés par le gouvernement fédéral (et dans de nombreux cas, gérés par l’Église), de nombreux enfants ont perdu la vie. Il n’y a pas de doute sur qui en est responsable. Utiliser l’expression « génocide culturel » revient à choisir de définir les préjudices subis en fonction de leur intention, plutôt que de leur résultat. Nous ne ferions pas ça dans une cour de justice. Si votre intention était de harceler, mais pas de tuer, et que vous finissiez par le faire, vous ne seriez pas simplement accusé de harcèlement.
Dr Calvez : Nous devons reconnaître que le Canada, en tant que société, commence à peine à accepter ce qu’il a fait. Comme tremplin, ils ont procédé à un « génocide culturel ». Ils étaient encore persuadés que les pensionnats pouvaient être bénéfiques pour les enfants autochtones. Je pense que puisque nous voyons maintenant à quel point c’était faux, les gens vont accepter le fait que c’était plus qu’un génocide « culturel », que c’était purement génocidaire. Cela dit, je n’écarte pas la malveillance du génocide culturel lui-même. Je suis qui je suis grâce à mes ancêtres, mes croyances, mon identité, parce que tout ce que je suis est lié à la terre. Donc, m’enlever ma conception du monde, mes croyances et tout le reste, revient à me laisser avec rien. Bien que je puisse être là physiquement, je serais un étranger dans mon propre corps. L’utilisation du terme « génocide culturel » a constitué une avancée significative, mais nous sommes désormais plus précis. Nous avons compris les vérités qui l’entourent, et nous pouvons le désigner pour ce qu’il était vraiment, c’est-à-dire un génocide.
Eric : Vous avez dit que des progrès ont été réalisés et que nous allons dans la bonne direction. Pouvez-vous m’en donner un exemple concret?
Dr Calvez : Un grand groupe, auquel participaient David et moi, a élaboré la réponse de la psychologie au rapport de la Commission de vérité et réconciliation. Depuis lors, notre travail n’a pas été mis sur les tablettes. Nous observons l’émergence d’un dialogue stimulant à différents endroits dans le domaine de la psychologie. On assiste à un changement dans les normes d’éthique. Les normes vont changer, nous les renforçons et les améliorons, et nous y intégrons des méthodes qui soutiendront l’autochtonisation de la psychologie et la promotion de la (ré)conciliation. Le CSPP (Conseil des sociétés professionnelles de psychologues) et l’ACPRO (Association des organisations canadiennes de réglementation en psychologie) se mobilisent et redéfinissent la façon dont ils souhaitent voir les organismes de réglementation commencer à aborder ces questions. Et David donnera un atelier pour le CCPPP (Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle) avec Ed Sackaney intitulé « Allyship, Reconciliation and the Profession of Psychology ». Donc, même au sein de notre profession, nous commençons à observer d’énormes changements. Cela ne fait que commencer et les répercussions sur la profession commencent à se faire sentir.
Profils du Mois de la psychologie : Dre Lindsay McCunn et Dr John Zelenski, Environmental Psychology

Dre Lindsay McCunn

Dr. John Zelenski
Dre Lindsay McCunn et Dr John Zelenski, Environmental Psychology
La psychologie de l’environnement compte deux branches principales. Nous avons parlé à la Dre Lindsay McCunn de la branche de la psychologie de l’architecture (la conception de bâtiments et de pièces pour le bien-être des occupants) et au Dr John Zelenski, de la psychologie écologique (qui s’intéresse aux comportements écologiquement durables par l’intermédiaire de la connexion des gens à la nature).
Psychologie de l’environnement
« Quand je dis que je ne vous juge pas, je pense que je veux vraiment dire “pas plus que les autres.” ».
Je suis un peu nerveux à l’idée que, pendant notre réunion Zoom, la Dre Lindsay McCunn et le Dr John Zelenski puissent juger mon arrière-plan, décidément très encombré. Tous mes appareils électroménagers sont placés sur une tablette derrière moi, ce qui donne l’impression (exacte, il se trouve) que mon bureau à domicile est un coin exigu près de la cuisine. La Dre McCunn et le Dr Zelenski sont des psychologues de l’environnement, c’est-à-dire des spécialistes des espaces que nous occupons et de la manière dont nous interagissons avec eux. Le Dr Zelenski est plutôt gentil et honnête – en tant qu’êtres humains, nous percevons des indices subtils, à partir des espaces de chacun, mais cela n’est probablement pas propre aux psychologues de l’environnement. Nous jugeons tous les arrière-plans Zoom, ne serait-ce qu’un peu.
La Dre Lindsay McCunn est professeure de psychologie à l’Université Vancouver Island. Elle est la présidente de la Section de psychologie de l’environnement de la SCP et la rédactrice en chef adjointe du Journal of Environmental Psychology. Selon elle, les arrière-plans Zoom des gens ou la façon dont ils aménagent leurs jardins ou leurs espaces de vie sont sources de curiosité pour chacun d’entre nous.
« La façon dont les gens s’expriment, organisent leur domicile et placent des objets importants est vraiment intéressante. Sam Gosling a écrit un livre intitulé Snoopologie; il s’agit d’une étude portant sur la façon dont on peut déduire la personnalité et la façon de penser des gens en fonction de la manière dont ils rangent leurs bibelots et leurs affaires dans leur maison et leur bureau. »
La Dre McCunn se spécialise en psychologie de l’environnement et décrit ainsi sa spécialité.
« La psychologie de l’environnement, c’est l’étude des transactions entre les personnes et les lieux. Et j’entends par là beaucoup de types d’endroits – un café, un bureau, une école, un parc, un océan, une montagne. Nous étudions les différentes façons dont les gens interagissent avec leur environnement. De la même manière qu’un psychologue social étudie et analyse les relations et les interactions entre les individus et les autres, les psychologues de l’environnement étudient et analysent les relations entre les personnes et les lieux. Dans mes recherches, je m’intéresse à la façon dont les gens interagissent dans les collectivités et les milieux de travail, en particulier dans les hôpitaux, les écoles et les bureaux. À ce titre, je me penche sur le personnel, principalement, et sur les personnes qui utilisent les environnements d’une manière différente de celle à laquelle on pourrait s’attendre, comme les étudiants et les patients, les enseignants, etc. ».
Le Dr John Zelenski est professeur au département de psychologie de l’Université Carleton. Il est également un psychologue de l’environnement, mais il se spécialise dans un domaine bien différent de celui de la Dre McCunn. On pourrait dire que l’un et l’autre représentent les deux principales branches de la psychologie de l’environnement – la psychologie de l’architecture (Dre McCunn) et la psychologie de l’écologie (Dr Zelenski).
« En plus d’être un psychologue de l’environnement, je me considère aussi comme un psychologue de la personnalité qui se réclame de la psychologie positive. Je me suis beaucoup intéressé à ce que nous appelons le rapport à la nature, ou ce que d’autres appellent “la connexion avec la nature”. Je parle ici des impressions subjectives des gens : font-ils partie de la nature ou la nature est-elle distincte d’eux et n’a pas grand-chose à voir avec leur perception d’eux-mêmes? Je me suis aussi beaucoup intéressé de façon générale par ce que j’appelle un “chemin heureux vers la durabilité”. C’est l’idée que nous savons que la nature est capable de rendre les gens de bonne humeur. La nature est associée au bonheur, tant sur de longues périodes que sur le moment. Nous savons que les gens qui passent beaucoup de temps dans la nature et qui se sentent très liés à la nature adoptent des comportements proenvironnement et écologiquement durables. Au cours des dernières années, nous avons commencé à penser que l’inverse est peut-être vrai aussi. Si l’on peut amener les gens à faire quelques petits gestes pour la nature, en adoptant des comportements écologiquement durables, il serait possible de se servir de cela pour qu’ils se sentent plus proches de la nature et plus heureux de pratiquer ces activités. Nous pensons que les actions en faveur de l’environnement ne doivent pas nécessairement être onéreuses et que nous pouvons les associer à des émotions positives. »
Ce que « consacrer du temps dans la nature » signifie pour chaque personne est subjectif. Il s’agit peut-être de prendre un week-end pour faire de la randonnée dans les collines, de passer une journée à pêcher sur la glace ou simplement d’aller dans son jardin et s’occuper de son potager de radis. Pour la Dre McCunn, cela a entraîné de grands changements depuis le début de la pandémie de COVID-19. Elle nous parle par Zoom dans ce qui semble être un chalet dans les bois. Depuis quelques années, elle et sa famille vivaient dans le centre-ville de Nanaimo, en Colombie-Britannique, en face du service d’ambulance, du service de police et de la caserne de pompiers. Les sirènes ont augmenté considérablement lorsque la pandémie a commencé, leurs habitudes de sommeil ont commencé à en être affectées et ils ont décidé de louer un endroit à la campagne.
« Ce fut en quelque sorte une bonne étude de cas en psychologie de l’environnement, dans la mesure où nous pouvions réaliser ce qui nous stimulait dans notre environnement familial, puis décider comment le modifier pour notre santé mentale. Nous avons donc pensé à déménager dans un cadre naturel plus vaste où nous pourrions avoir un peu plus de contrôle sur les choses qui nous stimulent. Nous avons été très chanceux de pouvoir louer quelque chose à la campagne. C’était intéressant, parce que j’étais très attachée à la maison que nous possédions. L’une des choses que nous étudions, comme psychologues de l’environnement, est le “sentiment d’appartenance” ou un sentiment d’appartenance à un lieu, un sentiment identitaire ou un sentiment de dépendance. Au début de la pandémie, j’ai entendu beaucoup de questions sur la façon dont les gens faisaient face au sentiment de perte qu’ils ressentaient depuis qu’ils travaillaient à domicile. Pas seulement un sentiment de perte en rapport avec des éléments sociaux, mais aussi une perte des moyens habituels par lesquels ils se rendaient à leur lieu de travail. Peut-être prenaient-ils le même autobus tous les jours ou arrêtaient-ils au même café lorsqu’ils se rendaient à l’école ou au travail. Même le caractère physique de l’environnement de bureau ou de la salle de classe elle-même – cet environnement leur manquait. Je me suis donc demandé comment je réagirais lorsque je m’éloignerais de mon environnement familier auquel je m’étais vraiment attaché. Je ne voulais pas me mettre dans une position où je perdrais mon lien avec mon cadre habituel, mais je me suis rapidement attachée à cet endroit et aux caractéristiques naturelles qui l’entourent. Ce fut une belle aventure d’explorer la psychologie de l’environnement de l’intérieur et dans ce contexte. »
Se sentir proche de la nature, ce peut être aussi simple que de pouvoir sortir et toucher à un arbre, ou regarder par la fenêtre une montagne ou une variété d’espèces d’oiseaux. Alors, comment cela peut-il se traduire par des comportements plus respectueux de l’environnement, au moment où le changement climatique est devenu le problème le plus urgent de notre époque? Le Dr Zelenski donne l’exemple que voici.
« Nous avons beaucoup de bonnes preuves circonstancielles et d’études de laboratoire, et nous essayons de les assembler. Quelques programmes ont été prometteurs! Mon ancienne étudiante, amie et collaboratrice, Lisa Nisbet, a collaboré avec la Fondation David Suzuki pour relever le Défi nature 30×30. Ce défi consiste à consacrer 30 minutes dans la nature chaque jour pendant 30 jours. Les personnes qui s’inscrivent à ce défi ont tendance à être plutôt écologistes et déjà très proches de la nature. Mais au cours de ce mois, cette connexion semble se développer. Ce n’est pas un essai contrôlé randomisé, mais il semble que le fait de passer du temps dans la nature donne à ces personnes le sentiment d’être plus proches, ce qui les incite à adopter des comportements écologiquement durables. »
L’écologie est une division de la psychologie de l’environnement (relativement) nouvelle, et elle a sans aucun doute pris beaucoup d’ampleur au cours des 20 dernières années, les changements climatiques étant rapidement devenus un sujet de premier plan pour beaucoup d’entre nous. Le Dr Zelenski n’est pas le seul à avoir évolué dans cette direction.
« L’attention et l’importance accordées à l’aspect écologique de la psychologie de l’environnement semblent s’être accrues au cours des 10 ou 15 dernières années. Je suis venu à la psychologie écologique après mon doctorat, par simple intérêt personnel, et j’ai l’impression d’être l’un des millions de personnes qui ont suivi le mouvement, et ce, pour plusieurs raisons. Les gens semblent de plus en plus manifester des symptômes de dépression, d’anxiété, etc., et la nature semble offrir un répit agréable. De plus, la prise de conscience relative aux changements climatiques ne cesse de croître, car nous en voyons de plus en plus les effets. Et les décideurs politiques souhaitent savoir ce que les sciences sociales peuvent apporter pour résoudre ces problèmes. »
La dimension écologique de la discipline a émané naturellement de la branche traditionnelle de la psychologie de l’architecture, qui existe depuis les années 1960. Selon la Dre McCunn, il existe quelques programmes d’études supérieures officiels en « psychologie de l’environnement » au Canada, mais il y en a plus en Angleterre et aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Amérique du Sud. Donc, lorsqu’elle dit aux gens qu’elle est une « psychologue de l’environnement », ceux-ci savent souvent ce qu’elle veut dire.
« Certaines personnes, à juste titre, divisent la dimension de la psychologie de l’architecture et la dimension de la psychologie de l’écologie. Je le fais aussi si je veux expliquer aux gens ce que j’étudie, parce que je suis plutôt du côté de l’architecture. Je travaille avec des ingénieurs, des gestionnaires d’installations et des urbanistes, mais j’ai aussi des collègues, comme John, qui s’intéressent au lien avec la nature et travaillent avec des personnes qui étudient les attitudes et les comportements proenvironnement. L’idée de conservation de la nature est devenue très populaire dans le domaine de la psychologie de l’environnement, sans pour autant prendre le pas sur la dimension architecturale, qui s’intéresse à l’infrastructure des immeubles, etc. En fait, la psychologie de l’environnement a débuté dans le contexte de l’architecture, mais elle s’est largement étendue à son autre volet, qui consiste à poser aux gens des questions sur leur conscience écologique et leur rapport à la nature. »
Les deux branches vont de pair. Pensez à la tendance à construire des bâtiments « verts », avec du chauffage à faible consommation d’énergie, des panneaux solaires, voire un jardin sur le toit.
Selon la Dre McCunn, « Quand un ingénieur me demande : “devrions-nous concevoir ce bâtiment en tenant compte de la durabilité”, il veut en réalité savoir – “les gens vont-ils le remarquer? S’en soucient-ils? Vont-ils apporter des changements à leurs comportements à l’intérieur (et à l’extérieur) de l’immeuble pour cette raison?” Je peux les aider à étudier la manière dont les gens se comportent, travaillent et fonctionnent dans des bâtiments plus (ou moins) durables. J’ai fait une étude dans une école d’études supérieures qui a montré que le fait qu’un immeuble de bureaux soit “vert” ou durable ne signifie pas nécessairement que cela permettra de prédire une forte productivité ou une forte satisfaction. Il est important de garder un œil critique sur ce que l’on attend d’une conception durable et sur ce que l’on n’attend pas. »
Pensez à des espaces dans lesquels vous vous êtes sentis immédiatement à l’aise avec les personnes qui vous entouraient – et d’autres où ce n’était pas le cas. Il est possible que ce ne soit pas les personnes présentes qui en soient la cause, mais la conception de l’espace qui a rendu les interactions plus embarrassantes, ou qui a rendu cette pièce, ce bâtiment ou ce wagon plus confortable. La Dre McClunn précise.
« Si l’on veut qu’un certain espace soit accueillant et confortable, on peut le concevoir pour qu’un certain nombre de personnes puissent s’y asseoir à une certaine distance. Je pense à la conception d’un café, ou un restaurant ou même une salle de classe où l’on veut que les gens s’assoient d’une certaine façon et cohabitent d’une certaine manière.
Je pense qu’il est important d’utiliser différentes méthodes, tout comme les autres psychologues le font. Nous sommes capables d’intégrer une variété de méthodes combinées dans notre travail. Nous utilisons l’observation naturaliste pour observer et voir comment les gens se déplacent et se comportent dans un espace afin de prendre des décisions de conception à partir de nos observations. Nous effectuons beaucoup de sondages et d’entrevues et, à partir de ceux-ci, nous pouvons aider les architectes et les concepteurs à rendre les bâtiments les plus humains possible. Si l’objet du travail clinique et d’autres types d’intervention psychologique est d’aider les gens à se sentir bien, alors la psychologie de l’environnement est tout à fait en phase avec cela. Nous voulons que les bâtiments soient conçus de manière à aider les gens à se sentir aussi bien, motivés, enthousiastes et en forme que possible. »
Le Dr Zelenski jette également un pont entre les deux côtés de la psychologie de l’environnement, et ce, de différentes manières. La collaboration avec des groupes qui font déjà un travail environnemental lui permet de recueillir plus facilement des données, et l’analyse de ces données permet à ces groupes de fonctionner de manière plus efficace et efficiente.
« J’ai collaboré avec un architecte, faisant ainsi le pont entre ces deux composantes de la psychologie de l’environnement. Il était très intéressé par la construction de bâtiments qui donneraient envie aux gens de se comporter de manière écologique. De même, il ne s’agit peut-être pas seulement de l’intérieur du bâtiment, mais aussi des espaces naturels proches du bâtiment qui pourraient encourager ces comportements. Il s’agit de poser une question plus nuancée sur les types de milieux naturels à proximité qui pourraient aider les gens à se sentir mieux, à être plus heureux et plus productifs.
Il y a un petit organisme sans but lucratif qui fournit des trousses d’analyse de l’eau. Il les distribue aux gens, qui les utilisent pour tester la qualité de l’eau à proximité; les gens téléchargent ensuite leurs données dans un genre de base de données participative qui permet de voir si le lac ou la rivière près de chez eux est en bon ou en mauvais état, et comment cela évolue au fil du temps. Il serait difficile pour moi de monter une expérience dans laquelle je distribuerais des tas de trousses d’analyse de l’eau, mais je peux essayer de suivre les personnes qui le font déjà pour voir si cela change leur sentiment de connexion avec la nature, si cela les rend heureux et si cela leur donne envie de faire d’autres choses bonnes pour l’environnement que de simplement tester l’eau. »
Depuis la mise en place de mesures de confinement en raison de la pandémie, nous entendons beaucoup de personnes dire qu’elles apprécient davantage la nature. C’est un moyen sûr de sortir de chez soi. Si on ne peut pas aller dans un centre commercial bondé ou à un concert, on peut toujours aller dans un parc et se promener. Les gens voient la nature comme une source de bien-être et un bon moyen de s’adapter, et certaines études indiquent que la nature est l’une des choses les plus positives que les gens ont ressenties au cours des deux dernières années, où la distanciation physique était imposée. Mais ce lien avec la nature, ainsi que la prise de conscience de la grave menace que représente le changement climatique, crée à certains égards de nouveaux problèmes.
Selon le Dr Zelenski, « Beaucoup de gens parlent d’écoanxiété et le fait que les gens soient de plus en plus conscients des changements climatiques pourrait être une arme à double tranchant. Cela peut donc être motivant – ce qui est un résultat positif, les gens voulant se comporter d’une manière plus écologique – mais certaines personnes pourraient être bouleversées ou inquiètes à tel point que cela créera de nouvelles formes de stress et d’inquiétude qui, chez elles, peuvent être inadaptées. »
L’un des moyens de lutter contre l’écoanxiété, un nouveau mot à la mode dans le domaine de la préservation de l’environnement, consiste à faire connaître les psychologues de l’environnement et à solliciter leurs conseils. Cette sensibilisation accrue se ressent également dans la dimension architecturale, car les contributions des experts de ce domaine sont maintenant perçues par beaucoup comme étant inestimables. La Dre McCunn dit qu’elle a vu ce changement directement.
« Lorsque je rencontre des ingénieurs, des architectes et des urbanistes, je constate qu’ils sont davantage sensibiliés à la psychologie de l’environnement et qu’ils sont tout à fait disposés à travailler avec nous. Lorsque je faisais ma maîtrise, j’ai remarqué que très peu de personnes occupant ces postes voulaient travailler avec un spécialiste en sciences sociales. Plusieurs d’entre eux disaient qu’ils faisaient ce genre de recherche accessoirement, et qu’ils “savaient déjà comment étudier les gens”. Aujourd’hui, ils font appel à moi car ils veulent intégrer cette dimension professionnelle à leur activité ou à leurs processus.
La cognition spatiale, par exemple, est un sujet très habituel en psychologie de l’environnement. Je pense qu’il est important de le mentionner car la population vieillit. Les psychologues de l’environnement consultent souvent les concepteurs pour savoir comment aider les personnes atteintes de démence à s’orienter dans une maison de soins, par exemple. Nous pouvons les observer et les aider avec des pancartes et des symboles, et des moyens d’intégrer leur psychologie dans la conception pour leur faciliter la vie. »
Êtes-vous déjà allé dans un magasin où il y a, sur le sol, un motif très simple qui se transforme un peu à l’approche des toilettes, et un peu plus près de la caisse? Peut-être y a-t-il des rampes d’escalier de couleur vive le long des murs, et le siège des toilettes est-il d’une couleur nettement différente du reste des toilettes. Le magasin est bien éclairé, mais pas trop, car il y a peu de surfaces réfléchissantes et pas de miroirs. Un magasin qui ressemble à ça a probablement été conçu pour être accessible aux personnes atteintes de démence, avec l’aide de psychologues de l’environnement.
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de différents types de démence sont généralement suivies par une équipe de soins, notamment par un neuroscientifique (voir le portrait de la neuropsychologie clinique présenté plus tôt ce mois-ci). De plus en plus, les psychologues de l’environnement travaillent au sein d’équipes interdisciplinaires plus larges, et les neurosciences elles-mêmes prennent une place plus importante dans la discipline. La Dre McCunn dit qu’elle le constate grâce aux articles proposés au Journal of Environmental Psychology.
« Il y a beaucoup d’articles qui fusionnent les neurosciences et la psychologie de l’environnement. Je fais aussi cela dans mon propre travail – j’ai presque terminé une deuxième maîtrise en neurosciences appliquées, simplement pour approfondir mes recherches dans le domaine des neurosciences environnementales. J’aime chercher à comprendre des concepts tels que “que se passe-t-il dans le cerveau lorsque nous ressentons un attachement à un lieu? Est-ce différent de l’attachement que l’on ressent face à une personne? Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque nous rencontrons différents contextes?” Ce sont des questions importantes qui, je pense, sont de plus en plus populaires. »
La psychologie de l’environnement devenant une discipline de plus en plus demandée, l’expertise des personnes travaillant dans ce domaine est appliquée à une variété de sujets sans cesse croissante. La Dre McCunn espère que cette tendance se poursuivra, afin que l’ensemble des compétences de ses collègues puisse être utilisé pour aider à résoudre des problèmes importants.
« Je souhaite que la psychologie de l’environnement fasse partie d’un grand nombre d’équipes très diverses. Bien sûr, les architectes et les urbanistes, mais aussi les cliniciens, les médecins, les neuroscientifiques, etc. Je crois que nous sommes de bons partenaires et nous pouvons ajouter des facettes aux questions de recherche qui peuvent enrichir une réponse et la rendre plus complète. Il est très difficile de tirer des conclusions à partir de quelques variables seulement. La mobilisation des données et de la modélisation dans le domaine de la psychologie de l’environnement peut nous aider à aider les autres à obtenir des réponses plus fiables à de vastes questions de société sur ce qui pousse les gens à agir et à penser de telle ou telle manière. J’aimerais voir la psychologie de l’environnement mettre à contribution son expertise dans toutes sortes de contextes et dans toutes sortes d’équipes. »
Mais soyez rassuré – si un psychologue de l’environnement se retrouve chez vous, il ne jugera pas la disposition de votre argenterie ni l’endroit où vous avez placé votre saucière, à côté du pot de Nutella. Du moins, pas plus que n’importe qui d’autre.

Dre Maria Rogers

Dre Maria Kokai
Dre Maria Rogers et Dre Maria Kokai, Psychologie éducationnelle et scolaire
Bien que les termes « psychopédagogie » et « psychologie scolaire » soient parfois utilisés de manière interchangeable, ils peuvent également faire référence aux deux composantes de la psychologie tel qu’elle se pratique dans le système d’éducation : d’une part, les chercheurs qui élaborent les meilleures pratiques fondées sur des données probantes, et d’autre part, les psychologues scolaires qui mettent en œuvre les résultats de leurs recherches. La Dre Maria Rogers et la Dre Maria Kokai se sont jointes à nous pour nous donner plus d’explications.
Psychologie éducationnelle et scolaire
« C’est comme apprendre aux enfants à nager bien avant qu’ils n’aient la chance de plonger dans la partie profonde de la piscine. »
La Dre Maria Kokai est une psychologue scolaire qui a passé 30 ans au Toronto Catholic District School Board, dont les 14 dernières années comme chef du service de psychologie du conseil. Maintenant à la retraite, elle est la présidente désignée de la Section de la psychologie éducationnelle et scolaire de la SCP. Au cours de sa carrière, elle a constaté un changement dans le domaine de la psychologie scolaire, qui est passée d’une approche axée sur les évaluations et l’intervention auprès des enfants en difficulté à un modèle plus axé sur la prévention, mais cette évolution est trop lente.
« La COVID a vraiment attiré l’attention sur l’importance de la santé mentale et de son traitement sur une base régulière et cohérente. Elle a également mis en lumière les inégalités qui ont résulté des nombreuses fermetures d’écoles et des autres conséquences de la pandémie. Selon moi, une leçon à tirer, pour nous et pour les écoles, est de s’assurer que la santé mentale est abordée de manière préventive, sur une base régulière et intentionnelle – comme nous l’avons fait avec la lutte contre l’intimidation – afin que les enfants apprennent à faire face aux difficultés, à établir des relations et à résoudre les problèmes. Ils peuvent ensuite appliquer ces compétences dans des situations difficiles (ce qu’a été la COVID) afin de s’adapter plus facilement et avec moins de stress.
La psychologie scolaire au Canada est très différente selon les endroits. À certains endroits, les psychologues scolaires offrent toute la gamme de services qu’ils sont en mesure de fournir, tandis que dans d’autres, ils se concentrent sur les évaluations et les problèmes. Ce que nous aimerions voir dans la profession, ce serait de pouvoir fournir des services équitables et accessibles à tous les étudiants, quel que soit leur lieu de résidence, quelle que soit la province, la ville ou la région rurale. Dorénavant, tout le monde devrait avoir accès à des services de façon équitable. Nous ne sommes pas encore là. »
L’accent mis sur la prévention est un élément que les psychologues scolaires souhaitent voir dans tous les conseils scolaires du Canada. Des progrès importants ont été réalisés dans ce sens au cours des 10 dernières années environ, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Maria Rogers est professeure à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa. Elle est la présidente de la Section de la psychologie éducationnelle et scolaire de la SCP.
« Cela met en évidence des problèmes systémiques plus vastes dans ce domaine, dit-elle. Il n’y a pas assez de psychologues scolaires, et il n’y en a pas assez qui sortent des programmes d’études supérieures au Canada. Il n’y a pas assez de ressources affectées à la santé mentale dans les écoles. Nous voulons vraiment adopter une approche préventive en matière de santé mentale qui favorise la réussite scolaire. Certains conseils et districts sont plus en mesure que d’autres (avec de meilleures ressources) d’adopter une approche préventive. Cependant, de nombreux districts scolaires de plus grande taille travaillent selon une approche attentiste, où l’on ne réagit que lorsque l’élève est en échec scolaire, ce qui est vraiment regrettable. Il existe des parallèles avec notre système de soins de santé, où nous attendons souvent que quelqu’un soit vraiment malade pour la prise en charge au lieu de prendre des mesures préventives en amont. »
Certains des retards observés dans la mise en œuvre de programmes de prévention proviennent d’un malentendu fondamental dans le public sur ce que font les psychologues scolaires. Dans l’esprit de beaucoup de gens, la psychologie scolaire se résume aux tests et aux évaluations psychopédagogiques. Il s’agit là d’une description plutôt étroite et inexacte de la psychologie scolaire et de ce à quoi les psychologues scolaires sont formés pour contribuer au système d’éducation. Cette idée trouve son origine dans un modèle beaucoup plus ancien du travail de la psychologie scolaire, qui a vu le jour vers le milieu du XXe siècle. À l’époque, de nombreuses écoles classaient les élèves en fonction de leurs capacités et de leurs déficiences, et elles demandaient aux psychologues scolaires de participer à cette classification en évaluant les élèves pour déterminer leur admissibilité à divers programmes. Toutefois, les psychologues scolaires possèdent un éventail beaucoup plus large de compétences et d’expertise. Et une mauvaise compréhension ou une sous-utilisation de cette expertise peut priver les étudiants d’un large éventail de services qu’ils pourraient autrement recevoir. La Dre Kokai précise.
« Une grande partie du public pense encore que les psychologues scolaires s’occupent principalement des élèves en difficulté. C’est l’une des raisons pour lesquelles les gens parlent beaucoup des listes d’attente pour obtenir une évaluation, qui sont interminables et constituent un problème récurrent. Si les psychologues scolaires avaient la possibilité de se concentrer sur des mesures préventives – prévention et promotion de la santé mentale, et dépistage et intervention précoces des problèmes potentiels d’apprentissage et de santé mentale –, ces problèmes graves pourraient souvent être évités et il serait moins nécessaire de les évaluer. Nous préconisons une gamme complète de services de psychologie scolaire et c’est justement pour cette raison – en passant des problèmes proprement dits à une approche plus préventive, nous n’attendons pas que ces problèmes s’aggravent. »
Certaines régions ont adopté plus rapidement que d’autres une approche axée sur le bien-être des élèves, et la Dre Kokai cite un endroit où cela fonctionne.
« Un organisme appelé Santé mentale en milieu scolaire Ontario, qui joue un rôle consultatif auprès du ministère de l’Éducation et sert de ressource aux conseils scolaires, en est un bon exemple. Il y a environ 10 ans, le ministère de l’Éducation de l’Ontario a ajouté le bien-être des élèves à ses objectifs, en plus de la réussite scolaire. Cela signifie que les écoles sont désormais tenues de se concentrer sur le bien-être et la santé mentale des élèves et de s’occuper des problèmes liés à la santé mentale. Au cours de cette décennie, beaucoup de progrès ont été réalisés en général, et certains progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’utilisation des compétences des psychologues scolaires pour soutenir les domaines de la prévention et de l’intervention précoce. »
Le plus grand changement en psychologie scolaire qui s’est opéré au cours des 30 dernières années est la réduction de l’écart entre la recherche et la pratique. Nous avons assisté à un effort systématique accru pour transférer les connaissances des chercheurs aux praticiens, afin de garantir que les psychologues et les autres professionnels de l’éducation qui travaillent avec des enfants puissent accéder aux résultats de la recherche et appliquer ces connaissances dans le cadre de pratiques fondées sur des données probantes destinées aux enfants dans les écoles. La Dre Rogers porte les deux chapeaux, étant à la fois chercheuse et praticienne.
« Je fais de la recherche en psychologie éducationnelle et je suis aussi praticienne. Je pense que, dans l’ensemble, la recherche nous a permis de mieux comprendre les liens entre la santé mentale des enfants et leur apprentissage. À une certaine époque, les deux concepts auraient été considérés comme des éléments distincts. La recherche a réuni ces disciplines pour comprendre comment ces éléments sont indissociables dans la vie d’un enfant. Je constate également que les chercheurs du monde entier sont de plus en plus nombreux à travailler ensemble et à apprendre les uns des autres. Nous mettons en commun les données et les ressources de plusieurs régions du monde afin de favoriser des études à plus grande échelle et dans une perspective plus large. »
La différence entre « psychopédagogues » et « psychologues scolaires » n’est pas aussi simple et ne tient pas à l’idée que le terme « pédagogie » désigne les chercheurs et le terme « scolaire », les praticiens. Dans certaines régions du Canada et ailleurs dans le monde, les termes sont interchangeables. Toutefois, pour la Section de la psychologie éducationnelle et scolaire de la SCP, les termes « pédagogie – recherche » et « scolaire – pratique » sont devenus des raccourcis utiles et sont bien compris par les personnes qui travaillent dans ce domaine. Les chercheurs produisent le savoir, les praticiens appliquent celui-ci. La Dre Kokai explique.
« La psychologie scolaire applique les connaissances scientifiques de la psychologie au milieu scolaire. Les psychologues scolaires appliquent leurs connaissances et leur expertise dans les domaines de l’apprentissage, de la santé mentale, du comportement et du développement de l’enfant pour aider tous les élèves à s’épanouir et à se développer le mieux possible. Ils établissent également des liens avec les personnes les plus importantes dans la vie des enfants – parents, enseignants, collectivités – et les soutiennent. Il s’agit d’un travail très collaboratif qui s’effectue dans l’intérêt de nos enfants et de nos jeunes. »
Cette collaboration a porté ses fruits au cours des dernières décennies, dans la mesure où les pratiques évoluent et où les priorités changent dans le but d’aider au mieux les élèves à maintenir leur bien-être et à s’épanouir dans un cadre scolaire. La Dre Rogers en donne un exemple.
« Au début des années 2000, les chercheurs ont commencé à s’intéresser vraiment au concept d’autorégulation ou de régulation des émotions. Certains chercheurs ont commencé à l’examiner dans le contexte éducatif et à étudier les effets de l’autorégulation sur l’apprentissage. Certains chercheurs, et des personnes orientées davantage vers la pratique, comme Stuart Shanker, ont élaboré des programmes et des outils pour les enseignants sur le thème de l’autorégulation et de son incidence sur le comportement. Cela a permis aux éducateurs de mieux comprendre le concept. »
Les psychologues et les chercheurs ont également collaboré à l’élaboration de nouvelles méthodes d’apprentissage de la lecture pour les enfants. Le SickKids de Toronto est l’un des endroits où une grande partie de ce travail a été effectué. Lorsque la Dre Kokai était la chef du service de psychologie du Toronto Catholic District School Board, celui-ci était l’un des sites expérimentaux du SickKids. Il s’agissait d’un lien direct entre les praticiens de l’éducation et les chercheurs. La Dre Rogers faisait son internat au SickKids il y a une quinzaine d’années, lorsque ce nouveau programme a été lancé.
« Ces dernières années, on a beaucoup parlé de la manière dont nous devrions apprendre à lire aux enfants. De nombreux chercheurs au Canada, principalement au SickKids, ont consacré des années de recherche au traitement phonologique et à la compréhension de la lecture. Ils ont élaboré un programme appelé « Empower », un programme de remédiation pour les élèves ayant des difficultés de lecture, qui est extrêmement rigoureux et fondé sur des preuves. Lorsque je faisais mon internat au SickKids, il y a environ 15 ans, Empower commençait tout juste à être mis en œuvre dans les écoles de Toronto, et il est désormais utilisé dans les écoles de l’ensemble du pays et les enseignants reçoivent une formation sur le programme. »
L’influence des connaissances scientifiques sur la psychologie scolaire n’est qu’une partie de ce vaste système de collaboration. Les psychologues de toutes disciplines collaborent et apprennent les uns des autres. Les compétences transmises par un psychologue scolaire peuvent être utiles à d’autres personnes que l’élève. La Dre Kokai se souvient de l’aide qu’apportait aux familles l’aide donnée à un enfant.
« Si vous êtes un parent, vous utiliserez les mêmes méthodes de communication et de gestion du comportement que celles que nous recommandons aux enseignants. Comment communiquer, comment établir des relations positives avec les enfants, pour les aider à devenir plus indépendants et à composer avec la pression des pairs ou les intimidateurs. Beaucoup de ces compétences s’appliquent également aux adultes. Les relations que vous entretenez dans votre milieu de travail, votre collectivité, et ainsi de suite. »
La Dre Rogers, qui travaille comme psychologue clinicienne en plus de ses fonctions à l’Université d’Ottawa, constate l’influence qu’un tel esprit de collaboration a eue sur tous les aspects de la discipline.
« Une des choses que la psychologie clinique a pu apprendre de la psychologie scolaire est la vision holistique de l’enfant dans ce système. Lorsque nous travaillons avec un enfant dans le cadre de la psychologie scolaire, nous travaillons avec lui dans le contexte de l’environnement scolaire, ou de sa famille, ou du système d’éducation dans son ensemble – souvent les trois. Généralement, la psychologie clinique a tendance à être plus axée sur l’individu, et de grands enseignements sont venus des écoles. »
Vous avez probablement lu et vu en ligne des parents qui se plaignent des « mathématiques modernes ». La manière dont les mathématiques sont enseignées dans de nombreuses écoles est en train de changer et de nombreux parents, en particulier les parents de la génération Y, la trouvent difficile à comprendre – que voulez-vous dire par « on ne retient plus 1 »? C’est ainsi que j’ai appris à calculer et qu’on m’a forcé à le faire, ça a marché pour moi! (Nous faisons bien sûr référence aux membres de la génération Y qui parlent comme des prospecteurs du XIXe siècle.) Il n’y a vraiment pas de « mathématiques modernes ». Les maths ne changent pas. 2 + 2 = 4. n! est égal à n x (n-1)… 1. Ce qui a changé, c’est la méthode d’enseignement, qui met davantage l’accent sur la compréhension des concepts que sur l’obtention de la bonne réponse. Mais le processus qui en résulte est si différent que les parents et les enfants ne se comprennent pas bien lorsqu’ils essaient de travailler ensemble sur les devoirs de mathématiques. La Dre Kokai affirme que, bien que les chercheurs étudient cette question depuis un certain temps, à sa connaissance, les psychologues n’ont été que peu ou pas du tout impliqués dans la mise en œuvre de ces nouveaux programmes.
« Cela semble être un exemple de “cloisonnement”, dont nous parlons parfois en éducation. Les psychologues n’ont pas collaboré à l’élaboration de cette nouvelle méthode d’apprentissage des mathématiques, qui s’est faite de façon cloisonnée. Ce que les psychologues scolaires essaient de faire, c’est de soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage pour les aider à acquérir des compétences en mathématiques. Mais je sais qu’il y a des chercheurs, ici en Ontario et probablement ailleurs, qui s’intéressent aujourd’hui aux mathématiques et aux compétences de base en mathématiques. Nous devrons écouter ces scientifiques et ces chercheurs et élaborer un programme de mathématiques qui tient compte des résultats de leurs recherches. »
Il existe beaucoup de bonnes raisons de faire intervenir les psychologues – dans tous les domaines de l’éducation, bien sûr, mais plus particulièrement en mathématiques. La Dre Rogers dit que « contrairement à la plupart des autres matières, les mathématiques comportent un aspect cognitif et psychologique qui fait que l’on a l’impression d’être bon en maths ou de ne pas l’être. Et cette perception de soi semble commencer très jeune. » Aider les enfants à franchir cette étape dès leur plus jeune âge est au cœur même de l’argument de la prévention : plus tôt on peut intervenir, meilleur est le résultat pour l’élève, tant sur le plan émotionnel que scolaire. Et plus il y a de chances qu’il soit capable de nager lorsqu’il arrivera dans la partie profonde de la piscine.

Dr. Elizabeth Hartney

Dr. Mari Swingle
Dre Elizabeth Hartney et Dre Mari Swingle , Électrophysiologie quantitative
Aujourd’hui, le Mois de la psychologie met en vedette l’électrophysiologie quantitative, c’est-à-dire l’étude de l’activité électrique du cerveau. Nous avons parlé avec la Dre Elizabeth Hartney et la Dre Mari Swingle de la valeur réelle des détecteurs de mensonges et des bienfaits de l’ennui.
Électrophysiologie quantitative
Aucun mensonge détecté
Il y a une scène dans un épisode de Seinfeld où Jerry est interrogé à l’aide d’un détecteur de mensonges par un sergent de police qui ne le croit pas lorsqu’il lui dit qu’il n’a jamais regardé un épisode de Place Melrose. Grâce aux conseils de George (« ce n’est pas un mensonge si tu crois que c’est vrai! »), il s’en sort plutôt bien jusqu’à ce que l’anxiété prenne le dessus et qu’il craque sous la pression, admettant être vraiment accro à Place Melrose. Pour en savoir plus sur la « féminophobie » présente dans cette scène, voir l’article sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre présenté plus tôt dans le cadre du Mois de la psychologie!
Nous avons tous déjà vu des scènes semblables à la télévision et dans les films, où les gens ont des électrodes attachées à leurs doigts et à leurs mains, et où la machine quantifie les réponses données aux questions posées. Je pense que la plupart d’entre nous savent aujourd’hui que la machine ne mesure pas vraiment l’honnêteté mais plutôt l’anxiété. Et bien qu’elle ne soit pas très utile dans son but présumé – la détection des mensonges –, cette technologie est en fait très utile pour détecter l’anxiété! C’est le domaine de l’électrophysiologie quantitative.
La Dre Mari Swingle est psychologue clinicienne, chercheuse, auteure et conférencière. Elle a un doctorat en psychologie et une maîtrise en éducation, et elle a un certificat en neuroélectrophysiologie. Elle est la trésorière de la Section d’électrophysiologie quantitative de la SCP. Elle décrit la discipline de la façon suivante :
« Nous lisons l’activité électrique du cerveau, ce qui nous révèle beaucoup de choses. Nous pouvons lire à partir des niveaux supérieurs du cortex et obtenir beaucoup d’information, et nous pouvons aussi aller très profondément dans les structures et les circuits du cerveau. Il faut de l’équipement extrêmement perfectionné pour faire cela, et il faut des cliniciens extrêmement perfectionnés pour lire tout cela. »
La Dre Elizabeth Hartney, la présidente de la Section d’électrophysiologie quantitative, figure parmi ces cliniciens extrêmement perfectionnés. La Dre Hartney est psychologue agréée en Colombie-Britannique et elle possède une certification en neurofeedback et en biofeedback (deux formes courantes d’électrophysiologie quantitative).
« Nous sommes agréées par la BCIA, qui signifie Biofeedback Certification International Alliance. L’organisme offre la certification en biofeedback dans le monde entier. Le biofeedback englobe quelques sous-disciplines. Celle dans laquelle Mari et moi travaillons le plus étroitement est le neurofeedback EEG (électro-encéphalogramme) – mais nous pratiquons aussi le biofeedback avec capteurs périphériques, qui recueille d’autres informations biologiques pertinentes (p. ex., la réponse ectodermique – un mot compliqué pour désigner la sueur ou les cycles respiratoires) ailleurs dans le corps. Nous pourrions donc poser des électrodes sur le bout de vos doigts, sur la paume de votre main, pour lire la variabilité de la fréquence cardiaque ou la conduction cutanée. Il s’agit en fait de tout ce que l’on voit dans les détecteurs de mensonges à la télévision – qui ne sont pas vraiment efficaces pour détecter les mensonges, mais qui le sont pour détecter l’anxiété. L’anxiété est l’une des choses avec laquelle nous travaillons beaucoup. »
Le biofeedback est une thérapie qui permet de prendre conscience des fonctions de son propre corps et de mieux les contrôler. Il peut être utilisé pour aider les personnes présentant divers symptômes, allant du syndrome du côlon irritable aux effets secondaires de la chimiothérapie. La Dre Harney poursuit :
« Nous travaillons avec les gens pour obtenir des informations sur leur respiration, leur rythme cardiaque, leur tension artérielle, toutes sortes de phénomènes qui peuvent être psychosomatiques et impliquer à la fois l’esprit et le corps. Il y a des thérapeutes qui se spécialisent dans d’autres domaines, comme l’incontinence urinaire. Dans ce cas, l’approche utilisée vise à apprendre à l’individu à prendre le contrôle de son corps et de son cerveau – et dans certains cas, de sa vessie! »
Comme si les mots « électrophysiologie quantitative », « neurofeedback » et « biofeedback » n’étaient pas si rébarbatifs, les cliniciens spécialisés dans cette discipline ont tendance à en ajouter quelques-uns. Comme la physiologie, qui décrit aussi leur travail! Il y a la neurophysiologie, qui s’intéresse aux signaux du cerveau. Il y a aussi la physiologie générale, qui s’intéresse au corps en entier, y compris au cerveau. Selon les circonstances, les cliniciens spécialisés en électrophysiologie quantitative parleront uniquement du corps, uniquement du cerveau, ou des deux en même temps. La Dre Swingle parle des dimensions différentes que cela peut avoir.
« Beaucoup de recherches se sont faites sur ce que nous appelons la “cartographie cérébrale”. Alors, comment lire l’électricité et que nous dit-elle? Nous travaillons à partir de bases de données cliniques ou normatives. Les données normatives sont des mesures prises à partir du cerveau de personnes qui n’ont pas de symptômes ou de diagnostics déclarés. Elles ne souffrent pas de TDAH, de dépression, de psychose, etc. Nous regardons à quoi ressemble le cerveau dans ce cas, et nous pouvons ensuite traiter les personnes atteintes de TDAH, de dépression ou de psychose, et les aider à retrouver leur état normal (ou typique). Ce qu’Elizabeth et moi faisons principalement relève de l’autre volet, à savoir travailler à partir de bases de données cliniques. Cela signifie que nous mesurons l’activité électrique du cerveau des personnes qui souffrent réellement d’anxiété, d’insomnie, de difficultés scolaires, et ainsi de suite. Nous entraînons ensuite le cerveau à s’éloigner de cette mesure. »
Cela consiste principalement à exploiter les processus en cours dans certaines zones du cerveau et à en augmenter ou en diminuer la force. Cela peut être efficace pour traiter la dépression, l’anxiété, le TDAH et d’autres pathologies. Dans les situations où le cerveau lui-même a subi des dommages, le traitement est très différent.
Comme l’explique la Dre Swingle, « lorsque nous avons affaire à des AVC très graves ou des différences structurelles du cerveau, nous cherchons alors des connexions différentes [ce qui est souvent appelé neuroplasticité – la capacité du cerveau à compenser les parties endommagées en apprenant à utiliser d’autres parties pour accomplir les mêmes fonctions]. La majorité du travail que nous faisons vise à améliorer l’efficacité des connexions existantes. Certaines ne sont pas assez puissantes et d’autres, trop puissantes. Les travaux précurseurs de Davidson en sont un bon exemple. Il a étudié l’équilibre entre les lobes frontaux, le lobe gauche et le lobe droit. Il a découvert que si les activités électriques corticales étaient supérieures de plus de 15 % sur un lobe par rapport à l’autre, cela indiquait presque toujours une dérégulation émotionnelle. »
Montrer plus facilement le cerveau
Le domaine de l’électrophysiologie quantitative a beaucoup changé au cours des vingt dernières années, notamment en raison de l’avènement de l’ordinateur personnel et d’une plus grande puissance technologique. Pour une discipline qui dépend énormément de la technologie, cela a été une aubaine, mais a également rendu les pathologies, et leur traitement, beaucoup plus complexes. La Dre Harney réfléchit à cette évolution.
« En fait, les choses sont devenues plus faciles – mais aussi beaucoup plus compliquées – avec l’expansion des ordinateurs personnels. Ils ont rendu beaucoup plus divertissant le processus de réception et de renvoi de la rétroaction à partir du cerveau et vers le cerveau. Mais il y a là un problème. Avant d’avoir des ordinateurs, des psychologues comme nous utilisaient des lumières qui s’allumaient ou des sons qui résonnaient lorsque le cerveau accomplissait ce pour quoi nous l’entraînions. C’est la partie “rétroaction ou feedback” des termes “neurofeedback” ou “biolofeedback”. Et cela fonctionnait très bien! Aujourd’hui, nous avons des jeux d’ordinateur sophistiqués, des casse-tête et des vidéos qui s’allument et s’éteignent selon ce que fait le cerveau et nous disposons de tableaux impressionnants, qui nous permettent d’observer la fréquence des ondes cérébrales des gens à plusieurs endroits différents à la fois ».
La Dre Swingle donne un exemple précis du genre de travail qu’elle et la Dre Hartney pourraient réaliser pour un client. « Nous pourrions vouloir augmenter une onde cérébrale à un endroit particulier du cerveau dans un but bien précis. Par exemple, nous voulons augmenter les ondes thêta [un type d’ondes cérébrales] à l’arrière du cerveau parce que lorsque le niveau d’ondes thêta à l’arrière du cerveau est plus élevé, la tolérance au stress est plus grande. Nous pouvons utiliser cela pour aider à combattre l’insomnie, l’anxiété, les dépendances, tous des types de troubles qui pourraient bénéficier du calme du cerveau. Nous attachons une électrode à un endroit très précis et demandons à l’individu d’interagir avec un ordinateur. Une façon très simple de procéder est de faire sauter un criquet à l’écran lorsque les ondes thêta se déplacent par petits mouvements. Disons que nous avons affaire à une jeune personne qui souffre d’anxiété extrême et qui a besoin d’aide pour se calmer. Tout ce que nous faisons, c’est lui demander de faire sauter le criquet. Les petits enfants ne demandent pas comment on fait ça, pourquoi on fait ça. Ils disent simplement “OK”. Il est donc très facile de travailler avec les enfants! Dans les coulisses, nous observons les formes d’onde pures, les amplitudes et les rapports afin de voir la fréquence thêta monter, et nous manipulons les seuils pour faciliter ou compliquer le saut du criquet. Ce que nous faisons, c’est donner à cet enfant le contrôle pour augmenter les ondes thêta par lui-même. Quand on montre au cerveau un moyen plus facile de faire quelque chose, il le fait. »
Cultiver l’ennui
Pendant que je rédige le présent portrait, il y a derrière moi un téléviseur en sourdine. À l’écran, Équipe Canada est en train de jouer pour la médaille d’or contre les États-Unis aux Jeux olympiques. Mon téléphone est à côté de moi et émet constamment des notifications – Jonathan Stea vient tout juste de partager mon gazouillis, CTV Ottawa a lancé sur Instagram une vidéo en direct des manifestations au centre-ville d’Ottawa. Je n’ai pas joué à Words With Friends avec mes amis depuis trois semaines, et ils veulent que je sache que je leur manque. À tout moment, je dois arrêter de taper, car les notifications par courriel bloquent l’écran, et j’en ai reçu 14 depuis que j’ai commencé à écrire. La Dre Swingle a écrit un livre intitulé i-Minds: How Cell Phones, Computers, Gaming, and Social Media are Changing our Brains, our Behavior, and the Evolution of our Species qui traite justement de ce genre de choses.
« Un problème qui se pose dans notre discipline est que les choses sont devenues si sophistiquées qu’elles ne sont plus aussi efficaces, explique-t-elle. Un criquet qui saute pendant cinq minutes, c’est amusant. Un criquet qui saute pendant quarante minutes, c’est ennuyant! Et les enfants retournent à leurs jeux vidéo incroyablement évolués et spectaculaires. Nous obtenons donc de très bonnes données pendant la séance, mais le cerveau ne change pas de façon permanente. Lorsqu’on travaille avec des enfants, surtout ceux qui ont des difficultés d’attention, les écrans doivent être un peu ennuyants pour que le traitement fonctionne. C’est devenu une sorte de conflit intérieur dans notre discipline. »
Comment les choses ont-elles changé au cours des dernières décennies? Les enfants trouvent-ils le criquet ennuyant aujourd’hui parce qu’ils sont habitués à passer beaucoup de temps devant un écran interactif et à être davantage stimulés? S’ils avaient été exposés à cet exercice en 1988, auraient-ils trouvé le criquet divertissant plus longtemps? La Dre Swingle répond « oui » et « non ».
« Il y a 20 ans, on pouvait maintenir l’attention plus longtemps avec des stimuli moindres, mais c’était tout aussi ennuyant! Le problème est plus important maintenant parce que les nombreuses interactions avec la technologie influencent le développement du cerveau des enfants. Beaucoup d’enfants ne savent pas comment “supporter la monotonie” parce que tout se passe à un rythme effréné dans leur vie. Si l’enfant fait une heure de neurothérapie par semaine, mais consacre 20 heures aux jeux vidéo par semaine, le jeu l’emportera probablement. Et cela fait exactement le contraire de la neurothérapie; le cerveau s’entraîne à ne répondre qu’à l’excitation. »
Si vous vous entraînez sur un tapis roulant ou un rameur pendant 30 minutes par jour, c’est sûrement très bon pour vous, mais si vous passez le reste de la journée à ne manger que de la poutine et des coupes au beurre d’arachide, les effets du rameur seront probablement très diminués, et il est peu probable que vous obteniez les résultats que vous recherchez.
En même temps, si vous allez au centre de conditionnement physique tous les jours pendant trois mois et travaillez avec un entraîneur personnel pour trouver le programme d’entraînement qui vous convient, vous serez peut-être capable de maintenir le niveau de forme physique que vous désirez par la suite en n’y allant qu’une fois par semaine. C’est l’objectif de l’électrophysiologie – que les changements opérés dans votre cerveau fassent partie de vous-mêmes et se maintiennent après le processus.
Selon la Dre Hartney, « l’objectif ultime, c’est que votre client apprenne à changer d’état sans l’aide de la rétroaction. Or, nous constatons que les jeunes voient la thérapie par biofeedback comme une forme de divertissement et ne comprennent pas nécessairement qu’il s’agit d’un processus éducatif. Nous essayons de leur apprendre à changer d’état, mais parce qu’ils sont inondés de gadgets et d’animations, il est beaucoup plus difficile pour eux de généraliser ce qu’ils ont appris pendant une séance hors de l’environnement thérapeutique. »
Sur la valeur de l’ennui
Chaque vendredi soir, ma famille et moi faisons une soirée de jeux sur Zoom. Nous jouons à un jeu sur nos téléphones et nous partageons tous un même écran. Les progrès rapides de la technologie réalisés au cours des dernières années ont rendu possibles des choses extraordinaires, et c’est formidable de pouvoir nous retrouver de cette manière, en particulier pendant une pandémie où d’autres méthodes de communication ne sont pas nécessairement disponibles. Mais je remarque que les enfants abordent cela un peu différemment des adultes. Pendant que nous attendons le chargement du jeu, ils jouent à un autre jeu sur leur téléphone. Ou, bien que ce ne soit pas leur tour, ils distribuent les cartes sur la table de jeu ici, à la maison; ils peuvent donc jouer à un autre jeu pendant les 90 secondes d’interruption du jeu. La Dre Hartney explique pourquoi cela est de plus en plus courant.
« Nous sommes d’un âge où le fait de s’ennuyer était normal lorsque nous étions enfants. Si nous allions voir nos parents pour nous plaindre de nous ennuyer, ils nous donnaient une corvée ou nous disaient de nous occuper par nous-mêmes. Nous avons grandi avec l’idée que les choses étaient un peu ennuyantes et que nous devions chercher nous-mêmes comment nous amuser. La génération actuelle n’a tout simplement pas le même genre de référence. »
Comme la Dre Hartney, la Dre Swingle adore l’ennui!
« Toute la créativité et toutes les innovations émanent de l’ennui. Si vous ne vous ennuyez pas, vous n’avez pas l’occasion de développer votre curiosité, vous n’avez pas le temps de remarquer les choses par vous-même, de les assimiler, de voir les modèles, etc. Veuillez noter que la curiosité personnelle (interne) (générée par l’ennui) et l’exploration qui suit sont très différentes de la curiosité générée par un divertissement (externe) (générée par une excitation externe ou un divertissement externe plutôt que par l’éveil interne). Nous allons bien au-delà de nos travaux en électrophysiologie quantitative, mais ces éléments sont intrinsèquement liés. »
Avant d’aller trop loin au-delà de l’électrophysiologie quantitative, nous allons en rester là.
Alors, ennuyez-vous, les amis!
Profils du Mois de la psychologie : Dre Jen Theule et Dre Cathy Costigan , Psychologie de la famille

Dr. Jen Theule

Dr. Cathy Costigan
Dre Jen Theule et Dre Cathy Costigan , Psychologie de la famille
Le domaine de la psychologie familiale est aussi dynamique et complexe que les familles elles-mêmes. Nous avons parlé avec Jen Theule et Cathy Costigan des familles, des définitions et des vastes « systèmes » qui les englobent tous.
« Aucune personne saine n’est totalement indépendante. »
À la fin du troisième film de la saga du Parrain, Michael Corleone (Al Pacino) meurt seul dans une cour, ayant, semble-t-il, coupé tous les liens avec sa famille et l’entreprise familiale. Cependant, en y regardant de plus près, il ne peut pas avoir complètement coupé les liens avec sa famille – c’est elle qui a fait de lui ce qu’il est et qui a façonné la trajectoire de sa vie entière. En fait, même la cour où il est assis lorsqu’il s’effondre et meurt se situe dans la villa appartenant à Don Tommasino, un ami de la famille Corleone.
Dans notre culture, nous avons tendance, la plupart du temps, à considérer les gens comme des individus. De cette façon, nous considérons un individu sain séparément de sa famille et nous pensons rarement à lui dans ce contexte élargi. Les psychologues de la famille, quant à eux, pensent constamment à ce contexte. La Dre Jen Thele est professeure agrégée à l’Université du Manitoba et enseigne aux programmes de psychologie scolaire et de psychologie clinique; elle est également la présidente de la Section de psychologie de la famille de la SCP. Selon elle, beaucoup de choses que nous vivons dans notre vie quotidienne sont le résultat de la psychologie de la famille.
« Permettre aux parents de garder leur bébé avec eux dans la chambre d’hôpital après sa naissance au lieu de le garder à la pouponnière, comme cela se faisait autrefois, c’est un sujet qui intéresse la psychologie de la famille. Inviter les membres de la famille aux consultations médicales et aux discussions avec le médecin. Les réunions parents-enseignants. Tout ce qui permet d’impliquer la famille et d’impliquer plus de personnes aux discussions, c’est le genre de choses que les psychologues de la famille encouragent. »
Quand Amerigo Bonasera vient rendre visite à Don Corleone le jour du mariage de sa fille pour lui demander un service, il n’y a pas que lui et le parrain dans la chambre. Il y a d’autres personnes, dont le consigliere de la famille, Tom Hagen (Robert Duvall). Les décisions ne sont pas prises par le parrain seul. Il accorde de l’importance à la parole des personnes les plus proches de lui.
D’une part, il y a les découvertes apportées par la science et l’étude des familles, et d’autre part, il y a les applications de ces découvertes dans la gestion de la dynamique familiale, souvent, mais pas toujours dans le cadre d’une thérapie.
« Pour moi, la psychologie de la famille a deux volets, dit la Dre Theule. Premièrement, il s’agit de l’étude de “la famille” – les relations parents-enfants, les relations amoureuses, les familles multigénérationnelles, les groupes d’amis proches, ainsi de suite. Comprendre le fonctionnement des familles, autant les grandes unités familiales que les sous-systèmes qui les composent. Et deuxièmement, c’est l’application des connaissances ainsi acquises aux interventions. La thérapie familiale, le counseling matrimonial, par exemple. »
La Dre Cathy Costigan est professeure au département de psychologie de l’Université de Victoria.
« J’enseigne ce que nous appelons la “psychopathologie du développement”, ou les problèmes de santé mentale des enfants et des jeunes. J’enseigne cela à partir d’une optique familiale forte, qui consiste à comprendre le développement normal et anormal des enfants. J’enseigne également la thérapie familiale aux étudiants diplômés, laquelle implique des moyens d’intervention au “niveau des systèmes”. Nous ne voyons pas les problèmes comme “il y a quelque chose de défectueux chez l’enfant que nous devons réparer”; nous examinons plutôt les relations entre les différents membres de la famille et leurs modes de communication. Ce sont ces problèmes “systémiques” plus larges qui sont susceptibles de générer du stress dans une famille ou de le perpétuer. Il se peut que ce soit l’enfant qui exprime le stress vécu dans la famille, par exemple, en se comportant mal à l’école ou en faisant des crises à la maison, mais pour aider l’enfant, on doit aider toute la famille. »
La Dre Theule et la Dre Costigan parlent beaucoup de « systèmes ». C’est une façon d’être un peu plus général et inclusif lorsqu’on parle de la famille. Il ne s’agit pas seulement de la famille nucléaire composée de deux mères et de deux enfants – le terme peut également désigner la famille élargie formée par les grands-parents et les cousins, ou un groupe d’amis très soudé, ou encore une grande commune hippie de Californie, qui existe depuis les années 1970.
Comme l’explique la Dre Thele, « Tout le monde est touché par divers systèmes. Que ce soit les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes lié, ou votre groupe d’amis. Toutes ces entités fonctionnent de façon similaire aux familles. La plupart des gens considèrent une famille d’accueil comme une unité familiale, mais le reste du monde aura probablement du mal à répondre à des questions du genre : “est-ce que mon colocataire est un membre de ma famille?” Dans l’ensemble, la société considère toujours la “famille” comme une famille nucléaire – une mère et un père et de un à quatre enfants. Mais dans certaines communautés, les familles sont définies de manière plus large et sont plus nombreuses. Ainsi, lorsque j’utilise le terme “système”, les gens acceptent davantage l’idée que la famille peut comprendre matante et grand-maman – ou même les colocataires. »
Quelle est la taille exacte de la « famille » Corleone, dans la saga du Parrain? Se limite-t-elle aux membres de la famille immédiate – Vito, Michael, Fredo, Sonny et Connie? Inclut-elle les époux et les épouses? Les enfants? Tom Hagen, adopté officieusement par les Corleone à un jeune âge, est-il vraiment un membre de la famille? Qu’en est-il de tous les « membres » de la mafia? Sont-ils officiellement admis dans l’organisation ou dans la famille elle-même? En fait, où finit la « famille » et où commence l’« entreprise criminelle »?
Chaque communauté et chaque culture définissent la « famille » de manière un peu différente. Ce sont ces définitions de la famille, et les différences culturelles de ce qui constitue une famille saine, qui intéressent la Dre Costigan.
« Ces temps-ci, mes travaux de recherche portent surtout sur les familles d’immigrants et de réfugiés. J’étudie les moyens par lesquels les familles exploitent les ressources et les forces qui sont en elles lorsqu’elles passent d’un pays à l’autre, ainsi que les divers traumatismes qui ont pu accompagner leur périple vers le Canada. Comment font-elles pour maintenir des liens familiaux solides dans un contexte où les différences culturelles sont nombreuses et où chaque membre de la famille peut être amené à s’adapter à la culture canadienne par des moyens différents et à des rythmes différents, ce qui peut créer des tensions au sein de la famille? »
Ces tensions se manifestent notamment dans le cas des parents qui sont ici au Canada, mais dont les parents et la famille élargie vivent encore dans leur pays d’origine. Avec la technologie mondialisée d’aujourd’hui, ils sont plus connectés que jamais aux membres éloignés de leur famille. Parfois, cette connexion met les parents dans une situation difficile. Dès lors, il se peut que les attentes de leurs propres parents quant à la façon d’élever les enfants contrastent beaucoup avec celles de leurs propres enfants qui grandissent au Canada. C’est ce genre de tension que la Dre Costigan constate souvent dans les familles avec lesquelles elle travaille.
La psychologie de la famille, en tant que discipline, évolue dans cette direction depuis un certain temps. Elle met un accent accru sur les variations culturelles dans les familles. On s’éloigne de la prémisse implicite selon laquelle le contexte canadien (la famille blanche aux valeurs occidentales) constitue le modèle d’une famille qui fonctionne bien. Au lieu de cela, on met l’accent sur ce à quoi ressemble une éducation parentale efficace ou une bonne communication au sein de la famille. Bien sûr, cela varie beaucoup selon la culture. Le fonctionnement sain d’une famille n’est pas le même pour tout le monde, et le fait de le reconnaître a constitué un grand pas en avant pour la psychologie de la famille au cours des dernières décennies. La Dre Costigan en donne un exemple :
« Dans la culture occidentale blanche, la relation maritale entre conjoints, qu’ils soient de même sexe ou de sexe opposé, est au premier plan. Les conjoints sont les chefs de la famille et il devrait y avoir des limites claires autour de la prise de décision dans la famille, et les enfants n’en font pas vraiment partie. Nous pourrions considérer comme un problème le fait que les enfants soient trop au courant des problèmes des adultes ou trop impliqués dans les décisions des adultes. Dans certaines cultures, cependant, la relation qui prime est la relation parent-enfant. On peut souhaiter que les enfants contribuent à la famille à un degré beaucoup plus élevé que celui auquel on s’attend dans la culture canadienne dominante. Remplir ces obligations familiales est vraiment une force, et cela fait partie d’une adaptation saine de l’enfant dans cette optique culturelle. »
Le travail des psychologues spécialisés dans le domaine de la famille peut porter sur chaque moment de la vie, de l’arrivée d’un nouveau-né dans la famille jusqu’à la planification des soins de fin de vie d’un parent ou d’un grand-parent. Selon la Dre Costigan, dans toutes ces situations, bien que l’approche puisse être très différente, les principes fondamentaux demeurent les mêmes.
« Les principes fondamentaux des systèmes de fonctionnement familial entourant la communication et la résolution de problèmes présentent un intérêt à chaque phase de la vie. Comment aider les familles à exprimer ce qu’elles pensent de manière respectueuse et utile, comment les aider à résoudre des problèmes de façon à ce que tout le monde se sente entendu? Souvent, dans notre culture, les enfants majeurs vivent leur vie de façon assez indépendante. Ensuite, lorsque leurs parents vieillissent, ils doivent interagir les uns avec les autres et échanger beaucoup plus, dans un contexte très chargé émotionnellement. Certaines vieilles blessures résultant des interactions familiales peuvent resurgir et perturber vraiment ce processus. C’est un exemple de moment privilégié, survenant plus tard dans la vie, où les psychologues pourraient vouloir s’impliquer pour aider une famille à traverser cette phase difficile de la vie. »
Ou, peut-être, les psychologues pourraient vouloir s’impliquer immédiatement après le décès d’un patriarche de la famille. Cela pourrait éviter des désaccords et des trahisons futurs, et faire en sorte que Fredo ne scelle pas son sort en prenant parti contre la famille. Je crois que peut-être. Le Parrain présentait une dynamique familiale plutôt difficile, et peu de psychologues.
Au cours des deux dernières années, un nouveau défi a été posé aux familles et, par extension, aux psychologues de la famille qui les aident. Non seulement la pandémie a fait augmenter les problèmes de santé mentale, mais elle a également rendu plus difficile l’accès au soutien qui aurait pu alléger certains de ces problèmes.
Comme l’évoque la Dre Theule, « Les deux dernières années ont imposé une forte pression sur les familles qui vivent sous le même toit. La pandémie a fait disparaître une grande partie du système familial et du soutien qui vient avec, comme les grands-parents. Nous disposons de beaucoup d’innovations technologiques, mais ces innovations ne viendront pas prendre soin de vos enfants lorsqu’ils sont malades ou changer les couches à votre place. Elles ne répondent pas aux besoins du quotidien. Selon moi, de nombreuses recherches menées au cours des deux dernières années ont révélé beaucoup de choses à l’extérieur du domaine de la psychologie de la famille. Les psychologues s’y attendaient tous, mais de voir le stress que subissent les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées – les personnes qui comptent un peu plus sur le système familial – l’impact sur ces personnes du stress des aidants. Ainsi, les gens se sont rendu compte que, en se concentrant sur les adultes qui aident les personnes qui ont besoin de soins supplémentaires, on aide les personnes qui ont besoin de soins supplémentaires. Pour toute personne qui dépend des autres, un aidant est vraiment important et je pense que cela peut être un changement dans l’ensemble de la communauté. »
Encore une fois, la Dre Thele parle de systèmes. L’avenir de la psychologie de la famille réside dans l’intégration des connaissances actuelles des experts dans un système beaucoup plus vaste et complexe que nous pouvons désigner sous le nom de “famille” ».
« La psychologie de la famille ne fait qu’effleurer la surface de l’ensemble du système. Nous savons très bien comment examiner les parties du système – ce qui se passe dans un couple, la dynamique entre un parent et un enfant, et ainsi de suite – mais une famille n’est pas seulement un ensemble de petites parties, elle est plus grande que la somme de ses parties. Alors, comment faire pour examiner et mesurer quelque chose d’aussi complexe qu’un système familial? Chaque famille est différente par sa taille, sa culture et sa dynamique. C’est là que nous tentons d’aller – regarder les grands systèmes. Des recherches sont actuellement menées sur la dynamique des triades, comme un parent et deux enfants ou deux parents et un enfant. Mais la complexité qu’ajoute le passage de deux à trois personnes est telle qu’il s’agit déjà d’un énorme changement. »
Imaginez un diagramme que vous avez dessiné sur une feuille de papier. S’il y a deux personnes (deux points sur le diagramme), une seule ligne peut être tracée entre elles. Ajoutez une troisième personne (troisième point) et trois lignes peuvent maintenant être tracées entre les individus. Une personne de plus – trois fois plus complexe. Ajoutez un quatrième point, et cinq lignes peuvent être tracées. Et ainsi de suite. Vous pouvez donc imaginer à quel point cela doit être difficile de travailler avec un système familial entier, dans lequel neuf, dix, voire trente personnes sont impliquées. Comprendre ces systèmes pourrait être la tâche colossale à laquelle la psychologie de la famille devra s’attaquer dans les prochaines années.
La Dre Theule et la Dre Costigan seront de la partie – comprendre l’incroyable complexité des systèmes familiaux et mettre au point des interventions et des traitements plus efficaces. Toutefois, il reste peut-être une question à laquelle elles ne pourront répondre. Qu’est-ce qui a, au juste, convaincu Francis Ford Coppola et Al Pacino que faire le troisième film du Parrain était une bonne idée?

Dr. Brigitte Sabourin

Dr. Nicholas Carleton
Dre Brigitte Sabourin et Dr Nicholas Carleton, Psychologie clinique
La psychologie clinique est la branche de la psychologie à laquelle pensent la majorité des gens quand ils entendent le mot psychologue. Mais nous avons largement dépassé le cliché patient-allongé-sur-un-divan, et la pratique clinique est entrée dans le monde virtuel en ligne. Nous avons échangé avec la Dre Brigitte Sabourin et le Dr Nicholas Carleton sur la situation actuelle de la psychologie clinique.
Au début de sa carrière, Sigmund Freud se spécialise en hypnose. Il hypnotise ses patients pour les amener à s’ouvrir sur leurs symptômes, diminuant supposément leur gravité. Il est novice en la matière, a peu d’habiletés, ses patients doivent donc être le plus détendus possible : il leur demande de s’allonger sur un divan, pendant qu’il fume son cigare en leur disant qu’ils ont très envie de dormir.
Éventuellement, il découvre qu’il peut être encore plus efficace que les patients parlent simplement de leurs symptômes dans une atmosphère détendue. Il abandonne l’hypnose, mais conserve le divan (et le cigare). D’autres psychanalystes qui ont suivi les traces de Freud ont également adopté le divan, à tel point que dans les années 1940, l’Imperial Leather Furniture Company de New York devint une entreprise richissime grâce aux « divans de psychanalyse ». Il y a plus de 70 ans, le psychanalyste au cigare et au divan austère devient en quelque sorte un « mème », un « mème » qui persiste à ce jour.
Que seraient les dessins humoristiques du New Yorker sans le divan du psychologue? Bob Mankoff, lui-même ancien psychologue expérimental, est le responsable des dessins humoristiques du New Yorker. Il affirme que le divan du psychiatre dans les caricatures est un raccourci utile, qui traduit immédiatement une dynamique de pouvoir. Dans Les Soprano, lorsque Tony voit sa thérapeute, il s’assoit dans un fauteuil commun et confortable, mais le divan est là en arrière-plan, au cas où nous oublierions de quel type de bureau il s’agit.
Évidemment, le domaine de la psychanalyse a beaucoup évolué depuis les beaux jours de l’Imperial Leather Furniture Company. Et s’asseoir derrière la tête d’un patient alors qu’il est sur votre divan à vous parler est chose du passé. Toutefois, des images fortes, ancrées dans la culture populaire, peuvent encore exercer une certaine emprise bien longtemps après leur date de péremption. Pendant que l’image cigare-divan-psychologue s’estompe, il en va de même pour l’ostracisme que subissent les personnes qui cherchent de l’aide pour traiter un problème de santé mentale.
Le Dr Nicholas Carleton est professeur de psychologie à l’Université de Regina, psychologue clinicien agréé en Saskatchewan et actuel directeur scientifique de l’Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique. Il se réjouit des progrès que fait la discipline en démystifiant et en démantelant l’ostracisme qui frappe les gens qui cherchent du soutien psychologique.
« Je crois que nous assistons au déclin de la stigmatisation, et je pense que c’est largement dû au fait que les psychologues sont de plus en plus présents dans la collectivité. L’idée que vous vous retrouverez comme dans un épisode de Mad Men quand vous entrerez dans le bureau d’un psychologue, avec un grand canapé en cuir et quelqu’un qui fume un cigare, tout cela peut sembler très inquiétant – j’imagine que c’est en grande partie disparu de la réalité. Je pense également que cette idée aujourd’hui mythique au sujet de ce qui se produit lors d’une visite chez un thérapeute disparaît peu à peu. »
La Dre Brigitte Sabourin est professeure adjointe à l’Université du Manitoba, au département de psychologie clinique de la santé, et praticienne en psychologie clinique à Winnipeg. Elle est la présidente de la Section de psychologie clinique de la SCP, et dit que le domaine a beaucoup progressé, mais que ses objectifs fondamentaux demeurent les mêmes.
« Nous pouvons nous définir comme un champ d’activité où nous avons affaire au fonctionnement humain. La psychologie clinique va de la détermination des problèmes humains et de leurs solutions, à la promotion globale du bien-être physique, social et mental. Cela implique l’évaluation, le traitement, la consultation, l’élaboration de programmes, la recherche, le mentorat, l’enseignement… »
La Dre Sabourin se spécialise en psychologie clinique de la santé, au carrefour de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique. Elle évolue dans une clinique de soins tertiaires auprès de personnes atteintes de douleurs chroniques. Son travail englobe l’examen des aspects biopsychosociaux chez les gens qui vivent avec un problème de santé chronique, et la mise en application des compétences en psychologie clinique et des principes relatifs aux comportements liés à la santé pour tenter de les soutenir. La plupart des psychologues cliniciens ont une spécialisation de ce type, que ce soit en milieu hospitalier ou dans le traitement de troubles de l’humeur particuliers. Ce n’est pas le seul changement qui s’est opéré dans ce champ d’activité depuis les dernières décennies.
Comme le souligne la Dre Sabourin, « je crois que d’une part, le domaine est devenu plus diversifié. Traditionnellement, il était dominé par des hommes blancs, et ça continue de changer. Notre engagement envers la pratique fondée sur des données probantes poursuit son évolution, réunissant l’ensemble de nos connaissances sur ce que nous savons de tout ce qui touche les troubles mentaux jusqu’à l’épanouissement humain. Nous utilisons désormais ce savoir pour améliorer nos services et rendre des comptes aux personnes que nous aidons. Je pense également que les milieux où nous pratiquons ont changé. On trouve des psychologues cliniciens partout, que ce soit dans les soins primaires jusqu’aux soins hyperspécialisés, avec pour résultat que les populations et les milieux auprès desquels nous intervenons sont beaucoup plus diversifiés qu’ils ne l’étaient auparavant. De plus, je crois que la reconnaissance de l’aide que peut apporter l’accès aux services a progressé. Il ne s’agit pas de savoir si quelque chose ne va pas chez vous ou si vous êtes fou : la stigmatisation a commencé à s’atténuer et les gens réalisent que nous pouvons aider n’importe qui, de l’athlète d’élite à la personne qui éprouve de réelles difficultés à accomplir les tâches essentielles du quotidien. »
Le fait de rassembler ces connaissances et de les utiliser en pratique clinique est une question que connaissent bien la Dre Sabourin et le Dr Carleton. Ils sont tous deux chercheurs, en plus d’être cliniciens. Le Dr Carleton reçoit, et traite, plusieurs intervenants de première ligne à Regina – particulièrement à la GRC, puisque l’École est située dans la ville. Il réalise également plusieurs recherches auprès de la GRC et d’autres membres du personnel de la sécurité publique (PSP). Récemment, lui et son équipe ont créé un outil en ligne anonyme où les membres du PSP peuvent évaluer leur propre santé mentale, pour ensuite chercher le soutien dont ils ont besoin.
« Je crois que nous observons une meilleure intégration de la science et de la pratique, poursuit-il. Nous améliorons nos façons de nous connecter les uns aux autres, et nous entretenons des relations fondées sur la pratique réflexive entre les psychologues qui font de la recherche et les psychologues praticiens. Nous constatons combien la science oriente la pratique et vice versa, de manière beaucoup plus dynamique. Par exemple, on a assisté à des changements considérables pour ce qui est du SSPT. Grâce aux interactions étroites entre la pratique clinique et la science, il existe désormais quatre groupes de symptômes plutôt que trois. Les diagnostics de SSPT peuvent dès lors être posés sans qu’il y ait un événement unique, mais en considérant l’ensemble des événements accumulés. Il ne fait aucun doute que, pour nos intervenants de première ligne et les autres membres de la sécurité publique, il s’agissait de deux immenses pas en avant. Les membres du personnel de la sécurité publique avaient de la difficulté à préciser quel incident leur causait le plus de problèmes parce qu’ils en avaient vécu des centaines, voire des milliers, au cours d’une seule année. Auparavant, ils se rendaient chez un psychologue en disant “J’ai des problèmes”, ce à quoi le psychologue aurait pu répondre “J’en ai aussi car je ne peux établir de diagnostic à moins que vous ne choisissiez un seul événement”. Nous avons corrigé ces choses, et nous réalisons des améliorations progressives et d’importantes avancées. »
Une autre évolution avec laquelle nous sommes tous familiers aujourd’hui est de nature technologique. Je mène la présente entrevue avec la Dre Sabourin et le Dr Carleton via Zoom, et il existe des dizaines d’autres plateformes virtuelles disponibles pour tenir des rencontres, et même des séances de thérapie.
La Dre Sabourin précise : « Je crois qu’un autre élément qui a pris de l’ampleur, particulièrement depuis la pandémie, est le rôle de la technologie et de l’innovation sur le plan de l’accès aux services psychologiques. L’idée de devoir se rendre dans un cabinet de psychologue même pour une séance de 15 minutes, quelque part dans un édifice menaçant, ce n’est plus ainsi que nous envisageons la psychologie clinique. Aujourd’hui, nous avons recours aux plateformes de visioconférences, aux applications sur nos téléphones, et ainsi de suite. Par exemple, nous faisons beaucoup de programmes de groupe où les participants peuvent demeurer dans le confort de leur domicile, sans avoir à se rendre en voiture à l’hôpital et payer le stationnement, et tenter de trouver le chemin, et ainsi de suite. Le fait de diminuer les obstacles aux soins et d’augmenter la souplesse dans notre façon de faire représente un progrès enthousiasmant. Ce mouvement existait déjà depuis un moment, mais depuis deux ans, depuis le début de la pandémie, il a pris de l’essor. »
Il y a deux ans, avant le début de la pandémie, la thérapie virtuelle était plutôt marginale. Cependant, bien des choses ont changé depuis. Les psychologues qui étaient réticents à l’idée d’organiser des séances de thérapie sur les plateformes virtuelles ont appris à le faire efficacement, et la prévalence de ce type de technologie a éliminé certains des obstacles aux soins, accru l’aide psychologique disponible et largement contribué à atténuer la stigmatisation persistante entourant la recherche d’aide en santé mentale. Le Dr Carleton souligne que cela a aussi aidé d’autres façons.
« Au risque de dire une hérésie, j’estime vraiment que le fait d’être obligé de travailler à distance, quoique cela ait pu faire obstacle à certains congrès, a réellement rehaussé la collaboration, et ce, sous plusieurs angles. Je peux rencontrer quelqu’un de l’Australie à la fin de ma journée et au début de la sienne : nous pouvons échanger des notes pendant une demi-heure. Nous ne sommes pas préoccupés parce que l’un de nous deux devra bientôt prendre un vol de 16 heures. »
La Dre Sabourin acquiesce. Non seulement les collaborations sont plus faciles, mais il est également plus facile de fournir des soins psychologiques à un plus grand nombre de personnes.
« Nous examinons comment augmenter les ressources et notre portée. Une part de ce travail consiste à adapter le modèle de soins par paliers qui se déploie dans tout le pays. Au premier palier, on offre du soutien à beaucoup de personnes, et puis, quand les besoins augmentent et se complexifient, on offre aux personnes des services psychologiques plus soutenus et intensifs. Nous lisions un article paru dans une revue scientifique à propos de ce modèle à Ottawa, et le directeur de ma clinique disait “J’aimerais que nous puissions prendre un vol vers Ottawa, nous asseoir et discuter avec cette personne! » Et j’ai répondu “Je vais organiser une rencontre Zoom ce mardi”. Ça peut s’organiser si rapidement et nous sommes si habitués à ces plateformes que nous avons l’impression de nous rencontrer en personne lorsque nous échangeons de cette manière. »
Je commande souvent de la nourriture à des fermes locales de ma région, qui me livrent des aliments à domicile. La nourriture est livrée par Miles [nom fictif], un homme très costaud, qui porte une barbe qui lui descend jusqu’à la boucle de ceinture et qui conduit un énorme camion réfrigéré. Il y a peu de temps, nous discutions de mon nouvel emploi à la Société canadienne de psychologie, et Miles m’a parlé d’un de ses collègues dont il s’inquiétait parce qu’il devenait de plus en plus replié sur lui-même. Il s’inquiétait de la santé mentale de son ami. Est-ce que je devrais lui parler? Est-ce que je devrais le laisser seul? En tant que non-psychologue, je ne pouvais lui donner de bons conseils sur ce qu’il fallait faire au juste, mais je pensais que lui offrir gentiment son aide ne pouvait faire de mal. Les autres fois où j’ai vu Miles, il me donnait des nouvelles de son ami. Un jour, l’été dernier, alors que je travaillais dans mon garage, Miles et son collègue étaient tous les deux dans le camion et sont venus s’asseoir quelques minutes. Depuis, à chaque fois qu’ils font une livraison chez moi, nous nous assoyons pendant une quinzaine de minutes et nous parlons un peu de notre propre santé mentale. Comment nous tenons le coup avec la pandémie, quels genres de problèmes nous et nos familles avons affrontés. Le Dr Carleton indique que ce genre de situation se produit de plus en plus.
« Nous avons observé d’extraordinaires améliorations dans le discours entourant la santé mentale. Plutôt que de taire le sujet, les gens en parlent avec franchise. Le fait que nous en soyons à une étape où nous essayons de mobiliser les connaissances sur la santé mentale pour faciliter la transition vers des changements réels – c’est un virage phénoménal même au cours des deux dernières décennies. Nous ne savons peut-être pas exactement où nous irons ensuite, mais au moins, nous ne nions plus que nous pouvons offrir beaucoup d’aide et de formes d’aide aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Je crois qu’une large part de ce changement est le résultat des activités de représentation des intérêts menées par les psychologues cliniciens et d’autres professionnels de la santé mentale. »
Nous n’avons pas encore terminé : un certain ostracisme demeure et persiste, comme l’image du divan et du cigare. Mais les professionnels de la santé mentale poursuivent leurs efforts pour l’éradiquer, et les psychologues cliniciens n’y font pas exception. La Dre Sabourin résume très bien le message.
« C’est normal d’avoir des problèmes, vous êtes humain. Ce n’est pas facile pour un être humain d’habiter notre planète! Nous essayons tous de vivre nos vies, mais nous n’avons pas choisi nos parents, nous n’avons pas choisi nos gènes, nous n’avons pas choisi le fait que nos cerveaux sont probablement encore programmés pour nous aider à survivre comme il y a 20 000 ans, et notre environnement s’est considérablement transformé depuis. Il s’agit de normaliser le fait que ce n’est pas grave si certains moments de votre vie sont plus difficiles que d’autres. Nous voyons des êtres humains exceptionnels qui se sont épanouis, comme Clara Hughes, l’athlète olympique qui a reconnu avoir des problèmes. Il y a des acteurs renommés et des politiciens qui s’ouvrent sur leurs difficultés et affirment que l’on peut faire quelque chose à ce sujet. En tant que société, nous reconnaissons qu’il n’est pas possible d’être soit en bonne santé, soit malade. Vous pouvez trouver des trucs. Vous pouvez trouver des moyens de vous faciliter la tâche, d’être mieux dans votre peau, d’être plus présent auprès de vos enfants. Nous sommes plusieurs à éprouver des difficultés, et le fait de voir un psychologue ne signifie pas que quelque chose cloche chez vous : simplement, nous sommes tous des êtres humains qui tentent de faire de leur mieux dans un monde difficile. »

Dr. Keira Stockdale

Dr. Sandy Jung
Dre Keira Stockdale and Dre Sandy Jung, Criminal Justice Psychology
La discipline de la justice pénale est vaste et les psychologues sont impliqués dans presque toutes ses facettes, de la prévention jusqu’à la libération conditionnelle. Nous nous sommes entretenus avec la Dre Keira Stockdale et la Dre Sandy Jung à propos de leur travail dans ce domaine, et avons discuté de l’avenir de la profession.
« Je faisais partie des personnes qui regardaient des émissions comme CSI : Les experts quand elles ont commencé à être diffusées à la télé… »
La Dre Sandy Jung lève les yeux au ciel. « Oh non! Non, Keira, ne dis pas ça! Noooooon! »
La Dre Keira Stockdale est psychologue au service de police de Saskatoon et professeure auxiliaire au département de psychologie de l’Université de la Saskatchewan. Elle est l’actuelle présidente de la Section de la justice pénale de la SCP. Elle explique ce qui l’a intéressée à la psychologie, et en particulier, à la psychologie dans le contexte de la justice pénale.
La Dre Sandy Jung est professeure à l’Université MacEwan, à Edmonton. Ses recherches portent sur la psychologie médicolégale, et elle tente de garder son calme quand elle entend les mots qu’elle redoute le plus. Les émissions de télévision qui représentent la science pénale de manière inexacte et trompeuse l’agacent au plus haut point depuis longtemps, semble-t-il!
« Je grimace parce que j’entends cela constamment de mes étudiants. Ils s’intéressent aux sciences criminelles parce qu’ils regardent ces émissions de télé et que c’est attrayant, captivant. Honnêtement, je ne regarde jamais d’émissions policières et je les déteste encore à ce jour! Alors, quand les étudiants me recommandent une émission comme Dexter, je ne peux pas. Je ne la regarderai pas. »
Tout étudiant qui pense entrer dans le monde de CSI à la fin de leurs études est rapidement déçu. Aucun crime ne se résout en une heure par l’analyse de l’ADN ou par l’identification d’eucalyptus sur la semelle d’un soulier. Il est très rare que des enquêtes progressent en enlevant, puis en remettant ses verres fumés, avec pour musique de fond le riff grandiose de Won’t Get Fooled Again. C’est aussi vrai, bien sûr, pour la Dre Stockdale.
« Je suis allée à l’Université de Toronto pour obtenir un diplôme en sciences médicolégales, poursuit-elle. Et pendant que je faisais des comparaisons d’ADN pour vérifier s’il y avait correspondance avec une scène de crime, j’ai réalisé que les cours qui portaient sur les personnes qui commettaient ces crimes étaient beaucoup plus intéressants. Puis, j’ai eu la chance de faire un stage à la PPO, dans son unité d’analyse du comportement. Après cela, j’ai simplement continué à me concentrer de plus en plus sur les gens, ce qui m’a menée vers la psychologie clinique médicolégale! »
Oui, l’unité d’analyse du comportement existe vraiment. Plusieurs d’entre nous connaissent même toutes les abréviations – UAC! Unsub (unknown subject – suspect inconnu)! CODIS (Combined DNA index system)! Merci beaucoup Esprits criminels! Vous ne serez probablement pas étonné de savoir qu’aucune unité d’analyse du comportement réelle ne dispose d’avions privés, de produits dérivés comme des jeux vidéo, pas plus que vous y verrez de grands acteurs comme Jason Alexander.
Comme l’atteste la Dre Stockdale, « lorsque vous entrez dans les locaux, il n’y a pas de photos d’individus sur les murs ou de téléphones qui sonnent sans arrêt, et ainsi de suite; c’est un bureau silencieux où les gens font de l’excellent travail d’enquête. Ils conçoivent aussi des outils d’évaluation du risque et d’autres méthodes que nous pouvons utiliser pour combattre la criminalité, comme la violence familiale ou l’exploitation sexuelle par Internet. »
Alors concrètement, que font les psychologues spécialisés en justice pénale? Est-ce que cela ressemble à ce que fait le personnage de B.D. Wong dans La loi et l’ordre, ou est-ce que cela ressemble davantage au personnage de John Francis Daley dans Bones? « Non ». La Dre Jung indique qu’il y a deux types principaux de psychologues dans le domaine de la justice pénale, mais que la discipline est très vaste et comporte des centaines de spécialisations.
« Le clinicien est probablement le prototype de ce à quoi nous pensons quand nous parlons d’un psychologue en justice pénale, mais ce n’est qu’une partie de la réalité. L’autre partie englobe les volets de la recherche et de la psychologie expérimentale. Non seulement de la recherche dans des contextes concrets, comme les établissements correctionnels ou les centres de traitement, mais également de la recherche sur le croisement entre le système de justice et la psychologie. Toutes les décisions que nous prenons ont une dimension psychologique : il s’agit de décider comment interroger un témoin ou un suspect. Comment collecter les données et comment les interpréter. Et dans le contexte des tribunaux, il y a une multitude de décisions qui sont examinées par les psychologues, comme la détermination de la peine et les décisions concernant la composition des jurys. »
Vous voulez dire influencer les jurys, comme dans Bull? La Dre Stockdale mentionne que la plupart des psychologues qui travaillent dans ce domaine sont en quelque sorte des touche-à-tout qui maîtrisent plus particulièrement un ou deux aspects de leur travail.
« Pour être psychologue dans le domaine médicolégal, de la justice pénale ou auprès des services de police, il faut être un excellent généraliste. Nous apportons beaucoup de nos connaissances générales en psychologie et de notre compréhension clinique à ce champ de pratique. Actuellement, auprès des services de police, je fais partie d’une équipe interdisciplinaire qui tente d’évaluer les risques et d’intervenir auprès des délinquants violents dangereux. L’équipe est composée de procureurs, de policiers, d’agents de probation, de représentants des établissements correctionnels, de travailleurs en santé mentale et de résidents en psychologie. En tant que psychologues, nous avons conçu des outils d’évaluation des risques qu’utilisent nos partenaires du maintien de l’ordre et des libérations conditionnelles. Ainsi, une partie de notre travail consiste à informer cette équipe sur la façon de collaborer pour aider réellement les individus ayant des démêlés avec la justice et des antécédents de violence. Plusieurs d’entre eux ont des besoins en santé mentale, et nous voulons les aiguiller vers les services dont ils ont besoin tout en préservant la sécurité communautaire. Présentement, nous examinons les possibilités de développer plus de services virtuels et nous réalisons d’excellents progrès en ce qui concerne les mégadonnées, les analyses prédictives et la modélisation, en vue d’améliorer les technologies d’évaluation du risque. Comment évaluer les besoins de nos clients, comment déterminer s’ils présentent un risque de récidive, et pourquoi. Nous appliquons également cette même technologie aux cas de personnes disparues. »
L’un des cas de disparition les plus connus de la dernière décennie au Canada s’est produit dans le Village, à Toronto. Entre 2010 et 2017, huit hommes de la communauté gaie sont disparus. On a éventuellement déterminé qu’ils avaient été assassinés par un tueur en série, qui fut arrêté en 2018. La façon dont les services de police de Toronto ont effectué l’enquête préliminaire sur ces personnes disparues a fait l’objet de sévères critiques, menant à plusieurs enquêtes et examens. L’examen externe indépendant a été mené par la juge Gloria Epstein. On a conclu que les services de police avaient échoué et que la communauté gaie de Toronto en avait souffert. Mais la Dre Stockdale a bon espoir qu’un changement significatif en résultera.
« Je suis optimiste et je pense que nous verrons de plus en plus, dans l’avenir, de partenariats universitaires avec tous les domaines de la justice pénale. Nous avons fait un travail sur les personnes disparues, à la suite des disparitions signalées dans le Village à Toronto. Dans son rapport, la juge Epstein recommande que les services de police (dans ce cas, ceux de Toronto) travaillent avec des établissements universitaires et des chercheurs, car, ainsi, ils disposent de personnes qui peuvent les aider à évaluer leurs programmes et leurs initiatives. Les gens ne peuvent y arriver seuls; c’est une question de ressources, mais c’est aussi une question de réflexion et d’attitudes cognitives. Plus nous travaillerons en équipes interdisciplinaires dans le domaine de la justice pénale, plus nous éviterons les préjugés, et nous pourrons peut-être vérifier certaines de nos hypothèses ou interventions. Et nous pourrons les adapter à l’avenir. »
La psychologie dans le domaine de la justice pénale évolue constamment, est en perpétuel changement et s’améliore sans cesse (quoique lentement). Selon la Dre Jung, la clé de voûte est la mobilisation des connaissances, à savoir le processus par lequel la recherche génère des données et des réponses, puis traduit ce travail en changements concrets et en meilleures pratiques.
« Nous avons besoin de beaucoup plus de mobilisation des connaissances pour progresser. Une tonne de recherche doit encore être réalisée, mais nous devons faire mieux pour mettre en œuvre les choses que nous savons déjà. Nous pouvons aider à répondre à certaines questions pratiques très pointues. Nous savons que les groupes à risque élevé devraient bénéficier de plus de supervision, mais où se situe la limite? Combien d’heures devrions-nous investir dans l’administration de traitements? Nous disséminons cette information, mais nous ne l’utilisons pas concrètement comme nous le pourrions. En fait, il faut environ 17 ans avant que toute donnée probante ne soit mise en œuvre. Je me souviens, lorsque j’ai entendu cette citation, m’être dit : “c’est déprimant”! »
Dix-sept ans, c’est en effet une statistique déprimante, et le changement peut certes sembler lent. Mais la Dre Stockdale affirme pourtant qu’elle voit ce changement dans plusieurs facettes de la justice pénale, y compris dans le travail qu’elle a elle-même accompli.
« Je regarde certains des rapports d’évaluation psychologique que j’ai rédigés il y a longtemps pour des individus ayant des démêlés avec la justice, et je réalise à quel point la pratique a changé. Au Canada, nous sommes reconnus sur la scène internationale pour notre conception d’outils et de technologies d’évaluation des risques. Il y a des années, l’évaluation était une question de jugement : est-ce que cette personne récidivera? Peut-être? Aujourd’hui, cette décision est beaucoup plus structurée et fondée sur des données probantes. Maintenant, nous examinons toute une série de facteurs et déterminons où nous pouvons intervenir ou offrir du soutien afin de diminuer le risque qu’une personne soit violente, commette des agressions sexuelles ou verse dans la criminalité en général. Nos programmes de traitement sont beaucoup plus pointus qu’ils ne l’étaient il y a des décennies, car nous nous concentrons sur ces dynamiques ou facteurs changeants.
Nous nous éloignons des étiquettes négatives et stigmatisantes, pour tendre vers un langage plus positif. Par exemple “individus ayant des démêlés avec la justice” plutôt que “délinquants” ou “détenus”. Nous nous éloignons également d’une vision centrée sur le négatif dans le traitement des personnes, et je crois que c’est particulièrement important pour les jeunes dans le système de justice pénale, où nous mettons l’accent sur les aspects positifs, comme la force et la résilience. »
L’un des autres aspects où l’on observe des changements en justice pénale concerne la justice sociale. Ici encore, c’est un processus très lent, le système judiciaire étant constitué de composantes si énormes qu’il devient un énorme navire à diriger. La Dre Jung dit que, longtemps, le travail des chercheurs était cloisonné, mais que cette situation évolue maintenant, les médias sociaux et les données numériques rendant la collaboration et le travail interdisciplinaire plus faciles et plus accessibles. Elle mentionne aussi qu’il reste un très très long chemin à parcourir avant que le système judiciaire canadien et ceux du monde entier n’atteignent l’équité à laquelle ils aspirent tous.
« Il y a quelques affaires judiciaires qui ont vraiment attiré l’attention sur quelque chose dont tout le monde connaissait déjà l’existence, mais que nous n’avions pas examiné autant que nous l’aurions dû. Il nous faut ce genre d’affaires pour nous rappeler qu’il s’agit d’une question d’une extrême importance. En matière d’équité, de diversité et d’inclusion, certains sous-groupes ont été étudiés, mais pas tous : nous avons investi bien peu d’efforts en ce qui concerne le genre, notamment. Je dirais que nous ne faisons qu’effleurer la surface du problème. »
La Dre Stockdale souligne que lorsqu’elle pense aux questions entourant les mouvements comme Moi aussi, Black Lives Matter et l’oppression des Autochtones, elle réfléchit au peu de formation qu’elle a reçue sur ces problématiques lorsqu’elle faisait ses études de doctorat en psychologie. En plus d’éduquer les équipes, on doit continuer à discuter de ces enjeux plus largement. Nous entrons dans une ère de prisons intelligentes et d’applis d’évaluations du risque. Ainsi, elle estime que nous pouvons peut-être utiliser la technologie de façon positive pour nous orienter sur cette route. Elle milite également en faveur d’un virage général de plus grande ampleur en matière de philosophie.
« Je pense qu’il faut favoriser la participation des groupes et des organisations communautaires, des groupes d’intérêts particuliers qui travaillent auprès de certaines de ces populations et de ces personnes. En tant que psychologues en justice pénale, nous aimons appliquer les connaissances scientifiques, mais nous reconnaissons aussi que ce n’est qu’un moyen de savoir. Et dans le système juridique, nous devons être ouverts et respectueux à l’égard des autres modes de savoir. Ce sera le défi de l’avenir et je crois que nous devons vraiment nous concentrer sur cet aspect. »
Même les séries policières qui suscitent l’intérêt envers la justice pénale commencent à s’orienter vers des thèmes liés à la justice sociale – du moins, elles s’y essaient. C’est souvent embarrassant, et parfois maladroit, mais la plupart de ces émissions sont déjà embarrassantes et maladroites. Nous savons maintenant que ce ne sont pas les émissions criminelles télévisées qui ont conduit la Dre Jung vers la psychologie. Alors qu’est-ce qui l’a motivée?
« J’avais choisi au départ la psychiatrie. J’ai suivi un cours pendant ma troisième année d’études de premier cycle à l’Université de la Colombie-Britannique avec John Yuille et Robert Hare. Le Dr Hare est le concepteur de la Hare’s Psychopathy Checklist, l’échelle d’évaluation de la psychopathie de Hare, et j’ai trouvé ça tellement intéressant et attirant que tout à coup, je me suis intéressée à un tout autre domaine. À partir de ce moment, j’ai commencé à faire du bénévolat dans des laboratoires et à m’intéresser à la fois aux témoignages des témoins oculaires et à la psychopathie. Je savais à cette époque que j’étais là pour de bon. Ce fut toute une aventure. Je n’aurais jamais cru passer des services de santé mentale médicolégaux à aujourd’hui, où je travaille avec des enquêteurs de police sur leur façon de gérer les délinquants dans la collectivité. »
Très bien, voici une autre référence à la culture pop. Le Dr Robert Hare a participé au documentaire canadien primé et réalisé en 2003, The Corporation, dans lequel il semblait conclure que si une entreprise était une personne, elle cocherait presque toutes les cases de l’échelle d’évaluation de la psychopathie de Hare. Toutefois, dans la parution ultérieure de son ouvrage Snakes in Suits : When Psychopaths Go to Work, Hare indique que ses commentaires ont été pris hors contexte par le réalisateur, et que dans les faits, une entreprise ne répondrait pas vraiment aux critères permettant de la désigner comme « psychopathe ».
Alors que le vaste thème de la justice pénale grandit et prend de la maturité, et qu’il en va de même pour la psychologie qui l’accompagne, la Dre Jung et la Dre Stockdale souhaitent toutes deux nous dire que les choses s’améliorent vraiment. Que même si quelque chose semble mauvais aujourd’hui, le fait de se souvenir de ce que cela aurait pu être il y a vingt ou trente ans montre que nous faisons des progrès.
Comme l’affirme la Dre Stockdale, « Nous sommes plus en sécurité que nous ne l’étions, à simplement marcher dans la rue. Dans les années 1980, on menait toutes sortes de campagnes visant à inciter les gens à se méfier des étrangers, des inconnus, etc. On imaginait être plus en danger face à un inconnu qui se cache quelque part, au coin de la rue. Évidemment, aujourd’hui, nous savons que nous sommes plus en danger face aux personnes que nous connaissons, et désormais, nous sommes tous conscients de cela. On peut ne pas aimer les balados de documentaires criminels ou grimacer devant des émissions de télévision du genre Les experts, mais je crois qu’on peut y voir une sorte de fonction de protection, car certaines des données probantes que nous avons apprises en justice pénale, dont il est question sur ces plateformes, ont en réalité amélioré notre sécurité. »
La Dre Jung grimace.

Dre Zarina Giannone
Dre Zarina Giannone, Psychologie du sport et de l’exercice
Tandis que les exploits des athlètes olympiques captent notre attention, nous mettons aujourd’hui l’accent, dans le cadre du Mois de la psychologie, sur les psychologues qui les aident à atteindre ces performances exceptionnelles. Toutefois, la psychologie du sport ne s’intéresse pas qu’aux athlètes de haut niveau. Nous avons parlé de ce domaine passionnant avec la Dre Zarina Giannone.
Psychologie du sport et de l’exercice
Brooke d’Hondt n’a que seize ans, et elle a déjà une équipe d’entraîneurs et d’experts qui l’aident à exceller en snowboard demi-lune. Brooke a terminé à la dixième place à l’épreuve de demi-lune en planche à neige pour le Canada aux Jeux olympiques de Beijing, et lorsque les Jeux seront terminés, elle retournera à l’école. Imaginez être dans son cours de gymnastique!
La psychologie du sport a en quelque sorte émergé des cours de gymnastique; l’éducation physique est née dans le monde de l’éducation et a évolué au fil du temps vers la psychologie du sport que nous connaissons aujourd’hui. Habituellement, les programmes d’études supérieures en psychologie du sport sont dispensés dans les écoles de kinésiologie des universités. Ils offrent des diplômes qui produisent des scientifiques spécialistes de la psychologie du sport.
Aujourd’hui, deux voies principales s’offrent aux personnes qui souhaitent exercer la psychologie du sport et deux types de titres de compétences existent en Amérique du Nord. L’un d’eux est le psychologue agréé, dont le champ d’activité est le plus vaste lorsqu’il a acquis la formation et l’expérience nécessaires pour se dire spécialisé en psychologie du sport et de l’exercice ou en psychologie de la performance. L’autre est un professionnel appelé « conseiller en performance mentale » (CPM). Les personnes qui détiennent ce titre sont titulaires de diplômes scientifiques et ont suivi une formation appliquée, mais leur champ d’activité est limité à l’application des connaissances psychologiques dans le contexte de la performance ou du sport.
La Dre Zarina Giannone a emprunté ces deux voies. Psychologue agréée spécialisée en psychologie du sport et de la performance, la Dre Giannone a fait sa formation de deuxième cycle en psychologie du counseling, mais a suivi une formation appliquée en psychologie du sport (le CPM).
« La psychologie du sport est l’un des domaines de la science du sport au sens large, explique-t-elle. Même mon propre travail en tant que psychologue du sport n’est qu’une petite part d’un plus grand gâteau, dans la mesure où il couvre l’application de la psychologie de la performance. Il consiste à prendre des données scientifiques et théoriques et à les appliquer à des situations réelles. »
La question de la santé mentale des athlètes n’a jamais été autant sous les projecteurs qu’aujourd’hui. Des athlètes de haut niveau parlent de leur santé mentale, se retirent de leur sport pour prendre soin de leur santé mentale et rendent publiques leurs difficultés. Naomi Osaka, Simone Biles, Calvin Ridley, Clara Hughes, Andy Robertson. La liste des athlètes qui ont commencé à parler publiquement de la santé mentale s’allonge de jour en jour. C’est une tendance qui enthousiasme la Dre Giannone.
« Même pendant mes sept années d’études supérieures, j’ai remarqué certains changements très intéressants. Au début des années 2000, le domaine se concentrait davantage sur les aptitudes mentales traditionnelles enseignées aux équipes, aux athlètes et aux entraîneurs. Imagerie mentale, régulation de l’éveil, contrôle de l’attention, ce genre de choses. Ce sont des compétences importantes qui, si elles sont bien maîtrisées par les athlètes, peuvent améliorer leurs performances. Il s’agit également de compétences transférables qui peuvent améliorer le bien-être général et le fonctionnement quotidien. Ces derniers temps, les psychologues et les CPM personnels sont de plus en plus recherchés. Cela s’explique, entre autres, par le fait que les athlètes se sentent plus à l’aise pour divulguer leurs problèmes de santé mentale. La stigmatisation associée à ces problèmes a diminué. Cela signifie que le rôle des psychologues dans les clubs et les organismes sportifs est plus prisé qu’avant. »
Les Colts d’Indianapolis, par exemple, ont lancé une initiative appelée Kicking The Stigma et le porte-parole de la campagne est le défenseur vedette Darius Leonard, qui parle ouvertement de ses crises d’angoisse et de sa dépression. Mais pour chaque équipe qui s’attaque aux problèmes de santé mentale et tente de lutter contre la stigmatisation qui leur est associée, il semble y avoir un autre groupe qui tarde à faire de même. La Ligue canadienne de hockey a récemment publié un rapport dévastateur sur l’existence d’un « code du silence » qui a permis à l’inconduite à l’extérieur de la patinoire de devenir une « norme culturelle ».
« Je connais certaines organisations et certaines équipes qui prennent la santé mentale très au sérieux, et il y a des psychologues du sport qui sont impliqués dans la résolution de problèmes dans une perspective de justice sociale, poursuit la Dre Giannone. Par exemple, ceux qui travaillent avec des cas d’abus ou d’inconduite sexuels. Ces psychologues ont contribué à la création de changements systémiques dans certaines organisations. On observe de plus en plus de politiques de santé mentale, ou de politiques de diversité et d’inclusion être mises en œuvre dans les organisations. J’espère que les gens en ressentiront les effets, et que ce ne sera qu’une question de temps avant que toutes les grandes organisations sportives emboîtent le pas. »
Pour la première fois depuis longtemps, les joueurs de la LNH ne sont pas présents aux Jeux olympiques. Cela signifie que les équipes de hockey qui s’affrontent se répartissent en deux catégories : soit un groupe de joueurs qui jouent ensemble dans un contexte ou un autre depuis longtemps, soit une équipe composée des meilleurs joueurs disponibles qui ont peu d’expérience de jeu entre eux. Comment créer une dynamique de groupe et développer la confiance de l’équipe? Selon la Dre Giannone, ces questions sont de plus en plus du ressort des psychologues du sport et des CPM.
« Les psychologues du sport ne se contentent plus d’offrir des formations classiques sur les aptitudes mentales et de simples évaluations des compétences mentales. Aujourd’hui, mon travail se concentre sur l’optimisation des performances, mais il concerne également d’autres difficultés propres au sport, notamment la dynamique de groupe entre les membres de l’équipe, le leadership des entraîneurs et la gestion de divers problèmes de santé mentale rencontrés par les athlètes, comme l’épuisement professionnel, la dépression, l’anxiété ou les troubles de l’alimentation. À bien des égards, le rôle du psychologue du sport a été réinventé et consiste désormais à répondre à la fois aux besoins psychologiques et aux exigences de la performance inhérentes au sport. »
La Dre Giannone travaille principalement en pratique privée au Vancouver Psychology Centre, où elle reçoit des clients en psychologie générale et d’autres personnes qu’elle aide en sa qualité de psychologue spécialisée en psychologie du sport et de la performance. Dans cet espace, elle voit un large éventail d’athlètes et d’artistes – des jeunes jusqu’aux professionnels. À l’occasion, elle accepte un contrat avec une équipe, pour laquelle elle met en œuvre un programme de développement des aptitudes mentales ou fournit d’autres services de groupe. Elle travaille également avec le Canadian Centre for Mental Health in Sport (CCMHS), où elle offre des services de santé mentale aux athlètes et aux artistes.
« Depuis 2013, le financement fédéral de ces services a vraiment augmenté, et ce, assez rapidement. Il existe aujourd’hui quelques services financés par le gouvernement fédéral destinés aux sportifs de niveau national. Par exemple, il y a le programme Plan de match, qui offre une vaste gamme de services aux athlètes brevetés de haut niveau au Canada. Mon rôle au CCMHS s’adresse à tous les sportifs, entraîneurs et administrateurs, quel que soit leur niveau, et permet à certaines personnes d’accéder à du financement à cet effet. Les autres pays sont un peu en retard dans ce domaine, ce qui fait du Canada un chef de file dans la sphère de la santé mentale des sportifs. »
Comme c’est le cas de tous les événements majeurs des deux dernières années, la COVID est une question centrale des Jeux olympiques de 2022. Elle a perturbé l’entraînement, entravé la consolidation des équipes et fait perdre à de nombreux athlètes la chance de concourir sur la scène mondiale. La COVID a même coûté à certains athlètes la chance de concourir après leur arrivée aux Jeux, lorsqu’un test positif a mis fin prématurément à leur parcours olympique. La Dre Giannone a vu tous les hauts et les bas créés par la pandémie chez les athlètes de tous les niveaux.
« Au début, les sports étaient sur pause. Les tournois importants ont été reportés. À ce moment-là, il fallait vraiment modifier et faire évoluer les services psychologiques vers un mode de prestation en ligne. Nous avons fait des choses en équipe avec plus de 25 personnes sur Zoom! Au cours de la dernière année, de nombreux athlètes ont repris le sport, et il se présente des défis nouveaux auxquels nous n’avons jamais été confrontés auparavant. Le contenu du travail a changé – imaginez un jeune athlète qui n’a participé à aucune compétition au secondaire depuis deux ans. Il était en secondaire 2, et il est maintenant en secondaire 4. Ce que cela représente pour ces jeunes sur le plan du développement et du perfectionnement des compétences propres au sport est intéressant.
Mes recherches portent principalement sur le développement de l’identité dans le sport. Ce qui arrive lorsqu’une personne se blesse ou prend sa retraite, et la perte d’identité qui en découle. La COVID est à l’origine d’un grand nombre de menaces pour l’identité, qu’il s’agisse d’enfants ou d’athlètes olympiques. Ces personnes qui tirent du sport une telle estime de soi et une telle valeur sont involontairement contraintes de le mettre de côté pendant un certain temps. Cela peut être très déstabilisant pour les gens.
Je dirais, à l’inverse, que la COVID a offert aux athlètes une occasion inédite de pratiquer leur sport d’une manière nouvelle et différente. Prenons l’exemple d’un sportif qui n’avait jamais le temps de regarder des vidéos de lui-même. Désormais, il est capable d’apprendre des choses différentes sur lui-même. Il est peut-être capable de faire un peu plus de musculation. J’ai été frappée par la résilience et la créativité dont ont fait preuve les gens durant cette période.
Ce qui m’a vraiment frappée au début de la pandémie, c’est le passage de l’entraînement aux compétences physiques et mentales à la création de nouvelles conceptions de la culture d’équipe. Je me souviens d’être intervenue dans des équipes et d’avoir aidé à faciliter la réalisation des objectifs, et à cultiver les valeurs de l’équipe et les relations entre ses membres. Cela ne veut pas dire que je ne le ferais pas pendant une saison régulière, mais la pandémie a vraiment mis cela en évidence car il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire quand la situation était si incertaine. »
La santé mentale des athlètes est un domaine en expansion rapide. Le rôle des psychologues dans la résolution de certains problèmes sociaux et systémiques tels que les comportements inappropriés des athlètes, la violence dans le sport, les abus et le harcèlement, l’inclusion et la diversité culturelle, devient de plus en plus important. Les psychologues participent à la création de mesures de soutien, mais aussi à la promotion de changements systémiques au sein des systèmes et des organisations, et tout cela se répercute sur les athlètes. Mais leur influence et leur implication ne se limitent plus aux vestiaires.
Comme l’évoque la Dre Giannone, « les professionnels de la psychologie du sport sont désormais sortis du cadre traditionnel du sport et de l’exercice. Ils s’occupent des problèmes liés à la performance dans d’autres domaines. Il n’est pas rare de voir des psychologues du sport travailler avec des militaires, des artistes de la scène, des premiers intervenants ou des dirigeants d’entreprise de haut niveau. Presque tout le monde se retrouvant dans des situations très stressantes. Je m’attends à voir davantage de psychologues possédant ces compétences spécialisées se frayer un chemin dans divers milieux. »
Les Jeux olympiques, qui se déroulent en ce moment même, présentent une gamme de situations stressantes pour les athlètes, sous le regard du public, tous les jours, toute la journée. Nous pouvons nous réjouir de la performance improbable de l’équipe canadienne en poursuite par équipes de patinage de vitesse, mais aussi compatir à la douleur de l’équipe japonaise, dont la chute de l’une de ses membres a donné la médaille d’or au Canada. Nos yeux, les yeux du monde, ajoutent une pression inédite pour ces sportifs. Cette situation peut être difficile, et un psychologue peut aider l’athlète à y faire face. Que vous soyez Jennifer Jones, qui participe à ses deuxièmes Jeux olympiques à l’âge de 47 ans ou une planchiste de 16 ans, qui s’apprête à retourner à ses cours de géographie.

Dr Amir Sepehry

Dre Diana Velikonja
Dr Amir Sepehry and Dre Diana Velikonja, Psychopharmacologie
Au carrefour de la psychologie et de la médecine se situent la psychopharmacologie. Les psychopharmacologues sont des psychologues qui peuvent prescrire des médicaments comme le font les psychiatres, mais qui possèdent une formation de psychologue sur les interventions basées sur le comportement et la thérapie. Le Dr Amir Sepehry et la Dre Diana Velikonja nous en parlent davantage.
Au Canada, il faut habituellement environ 10 ans pour devenir psychologue. Il s’agit de l’un des domaines d’études les plus longs et les plus intensifs puisqu’on exige généralement un doctorat en psychologie professionnelle ou un doctorat en psychologie clinique. Or, ces programmes sont assez limités, et il faut plus de temps pour terminer un programme de doctorat en psychologie que la plupart des autres programmes. Imaginez franchir toutes ces étapes, puis décider que finalement, vous voulez poursuivre vos études plus longtemps. D’où vient votre extrême passion, qui vous donnera envie de POURSUIVRE vos études lorsque vous avez enfin terminé?
Pourtant, c’est la décision qu’ont prise les gens qui ont emprunté la voie de la psychopharmacologie. La Dre Diana Velikonja a une formation en neuropsychologie. Elle est psychologue clinicienne et détient une maîtrise en psychopharmacologie clinique qui lui permet d’offrir des consultations impliquant des médicaments psychotropes. Elle a travaillé auprès de personnes ayant subi des traumatismes crâniens, a été présidente de l’Ontario Psychological Association, et elle a mené des initiatives militant en faveur de l’élargissement de la portée de la pratique des psychologues ontariens pour y inclure la prescription de médicaments psychotropes. Elle décrit la psychopharmacologie de la manière suivante :
« Pour traiter plusieurs problèmes émotionnels et cognitifs, on utilise certains types de médicaments qui sont appelés « médicaments psychotropes ». Ils sont principalement utilisés pour traiter des troubles tels que l’anxiété, la dépression, les hallucinations. Par ailleurs, ils aident à gérer les symptômes des troubles de santé mentale ou de dépendance. La psychopharmacologie consiste en fait à prescrire des médicaments, parallèlement à d’autres traitements fondés sur des données probantes. La raison pour laquelle les psychologues sont impliqués dans ce domaine est qu’ils sont formés aux interventions basées sur le comportement et la thérapie, et ceux d’entre eux qui ont demandé une certification supplémentaire en matière de prescription de médicaments psychotropes sont capables d’intégrer les deux – le comportement et les médicaments – afin d’orienter les patients vers les meilleures stratégies pour gérer les symptômes qu’ils éprouvent. »
La prescription de médicaments pour traiter la maladie mentale est depuis longtemps, du moins au Canada, l’apanage de la psychiatrie. Les psychopharmacologues représentent les quelques rares psychologues qui possèdent le savoir requis quand il s’agit de ces médicaments. Le Dr Amir Ali Sepehry est le président de la Section de psychopharmacologie de la SCP. Il détient un doctorat en neurosciences, une formation postdoctorale en neurologie, une maîtrise en psychiatrie scientifique axée sur la médication, et d’autres formations sur les lésions médullaires et en psychologie du counselling. Le Dr Sepehry enseigne actuellement à l’université Adler de Vancouver, collabore avec l’université de la Colombie-Britannique et travaille avec des neuropsychologues médico-légaux sur des cas de nature juridique et médicale. Il affirme que la discipline de la psychopharmacologie est à la fois très ancienne et très nouvelle.
« Elle remonte aux temps anciens où les gens de diverses spécialités utilisaient des substances psychoactives, des herbes et ainsi de suite pour traiter les maladies mentales. Cependant, on constate une incroyable accélération depuis cinq ans, parce qu’il s’est produit beaucoup de choses. C’est en partie dû à l’actuelle crise du SARS-COVID-19. Quelques développements mineurs surviennent pendant que plusieurs d’entre nous tentent de repositionner les médicaments. »
La réaction immunitaire antivirale normale d’une personne exige l’activation des voies inflammatoires du système immunitaire. Les cytokines sont produites dans le contexte de la réaction immunitaire. Une réaction immunitaire incontrôlée et excessive est connue sous le nom de cascade de cytokines ou tempête de cytokines. Ceci peut causer des dommages aux tissus, ce qu’on a observé dans plusieurs cas de COVID-19 graves et survient en raison d’une surabondance de cytokines pro-inflammatoires. Le Dr Sepehry souligne que c’est l’un des angles sous lequel les psychopharmacologues examinent le repositionnement des médicaments existants.
« Les antidépresseurs ont montré des propriétés anti-inflammatoires. Ils pourraient donc être utilisés pour contrer les cascades de cytokines qui sont produites par la COVID. Nous en sommes encore au stade où nous devons déterminer les effets à long terme de la COVID sur le cerveau et le comportement, sur les changements sur le plan de la personnalité, sur la maladie mentale et sur l’éventuel rétablissement. Nous avons besoin de l’engagement d’un plus grand nombre de psychologues. Nous savons qu’il y a des taux croissants de maladie mentale, particulièrement chez les personnes âgées qui ont contracté la COVID. Ainsi, l’apport de la psychopharmacologie est crucial. »
Selon la Dre Velikonja, il existe d’autres manières d’étudier les médicaments, en particulier dans le contexte de la COVID, au fur et à mesure que nous comprenons ses effets à court et à long terme.
« Les médicaments pourraient être repositionnés pour traiter certaines choses comme la fatigue, ce que les gens appellent le brouillard mental, qui, avec d’autres symptômes, est présent dans ce que l’on désigne comme la COVID longue. Lorsque les gens manquent d’énergie ou de motivation physique pour faire des choses, il y a probablement lieu de cibler ce domaine. »
Au cours des deux dernières années, on a observé une mobilisation sans précédent de l’expertise scientifique mondiale. Les experts de presque toutes les disciplines scientifiques se sont réunis pour aborder chaque aspect de la pandémie, et le travail interdisciplinaire et transdisciplinaire atteint des sommets inégalés. Les psychopharmacologues ont l’habitude du travail interdisciplinaire et ils apportent une vaste étendue d’expertise à cette arène scientifique. La Dre Velikonja considère que leur engagement dans ce gigantesque effort est essentiel.
« Je crois que cela est primordial à de nombreux égards, au sens où tout le monde parle de la prochaine vague, ce qui est en réalité la vague de la santé mentale. Nous connaissons les nombreux défis du domaine de la psychiatrie, notamment sur le plan du nombre de praticiens disponibles. Je crois que les psychologues sont bien placés pour jouer ce rôle, pour travailler de concert avec la psychiatrie afin d’examiner la question de la prescription de médicaments et l’intégration de stratégies comportementales. Nous aurons besoin que tous mettent la main à la pâte pendant que se déploie la vague de problèmes de santé mentale. »
Cette vague est en mouvance actuellement, et nous constatons la montée des situations de violence familiale, ainsi que l’augmentation des taux de dépression, d’anxiété, de traumatismes et de problèmes de toxicomanie. Personne ne sait à quoi ressemblera cette vague dans quelques mois ou quelques années. Mais quand elle déferlera, nous devrons tous vraiment mettre la main à la pâte. Et nous pouvons nous sentir un peu rassurés en sachant que certaines de ces mains appartiendront à des personnes qui ont passé des années à devenir des experts dans leur domaine respectif, des scientifiques pour qui apprendre une seule chose n’est pas suffisant, qui veulent en apprendre toujours plus. Vous savez, les passionnés…

Dr Kerry Mothersill

Dre Kelsey Collimore

Dre Stephanie
Greenham
Dr Kerry Mothersill, Dre Kelsey Collimore, et Dre Stephanie Greenham, Psychologues en milieux hospitaliers et en centres de santé
Plusieurs psychologues travaillent dans le système public de soins de santé, certains dans les hôpitaux et d’autres, dans les centres de santé comme membres d’équipes interdisciplinaires traitant une grande diversité de patients. Les Drs Kelsey Collimore, Stephanie Greenham et Kerry Mothersill nous proposent certaines réflexions sur leur travail.
Psychologues en milieux hospitaliers et en centres de santé
Brooke d’Hondt n’a que seize ans, et elle a déjà une équipe d’entraîneurs et d’experts qui l’aident à exceller en snowboard demi-lune. Brooke a terminé à la dixième place à l’épreuve de demi-lune en planche à neige pour le Canada aux Jeux olympiques de Beijing, et lorsque les Jeux seront terminés, elle retournera à l’école. Imaginez être dans son cours de gymnastique!
La psychologie du sport a en quelque sorte émergé des cours de gymnastique; l’éducation physique est née dans le monde de l’éducation et a évolué au fil du temps vers la psychologie du sport que nous connaissons aujourd’hui. Habituellement, les programmes d’études supérieures en psychologie du sport sont dispensés dans les écoles de kinésiologie des universités. Ils offrent des diplômes qui produisent des scientifiques spécialistes de la psychologie du sport.
Aujourd’hui, deux voies principales s’offrent aux personnes qui souhaitent exercer la psychologie du sport et deux types de titres de compétences existent en Amérique du Nord. L’un d’eux est le psychologue agréé, dont le champ d’activité est le plus vaste lorsqu’il a acquis la formation et l’expérience nécessaires pour se dire spécialisé en psychologie du sport et de l’exercice ou en psychologie de la performance. L’autre est un professionnel appelé « conseiller en performance mentale » (CPM). Les personnes qui détiennent ce titre sont titulaires de diplômes scientifiques et ont suivi une formation appliquée, mais leur champ d’activité est limité à l’application des connaissances psychologiques dans le contexte de la performance ou du sport.
La Dre Zarina Giannone a emprunté ces deux voies. Psychologue agréée spécialisée en psychologie du sport et de la performance, la Dre Giannone a fait sa formation de deuxième cycle en psychologie du counseling, mais a suivi une formation appliquée en psychologie du sport (le CPM).
« La psychologie du sport est l’un des domaines de la science du sport au sens large, explique-t-elle. Même mon propre travail en tant que psychologue du sport n’est qu’une petite part d’un plus grand gâteau, dans la mesure où il couvre l’application de la psychologie de la performance. Il consiste à prendre des données scientifiques et théoriques et à les appliquer à des situations réelles. »
La question de la santé mentale des athlètes n’a jamais été autant sous les projecteurs qu’aujourd’hui. Des athlètes de haut niveau parlent de leur santé mentale, se retirent de leur sport pour prendre soin de leur santé mentale et rendent publiques leurs difficultés. Naomi Osaka, Simone Biles, Calvin Ridley, Clara Hughes, Andy Robertson. La liste des athlètes qui ont commencé à parler publiquement de la santé mentale s’allonge de jour en jour. C’est une tendance qui enthousiasme la Dre Giannone.
« Même pendant mes sept années d’études supérieures, j’ai remarqué certains changements très intéressants. Au début des années 2000, le domaine se concentrait davantage sur les aptitudes mentales traditionnelles enseignées aux équipes, aux athlètes et aux entraîneurs. Imagerie mentale, régulation de l’éveil, contrôle de l’attention, ce genre de choses. Ce sont des compétences importantes qui, si elles sont bien maîtrisées par les athlètes, peuvent améliorer leurs performances. Il s’agit également de compétences transférables qui peuvent améliorer le bien-être général et le fonctionnement quotidien. Ces derniers temps, les psychologues et les CPM personnels sont de plus en plus recherchés. Cela s’explique, entre autres, par le fait que les athlètes se sentent plus à l’aise pour divulguer leurs problèmes de santé mentale. La stigmatisation associée à ces problèmes a diminué. Cela signifie que le rôle des psychologues dans les clubs et les organismes sportifs est plus prisé qu’avant. »
Les Colts d’Indianapolis, par exemple, ont lancé une initiative appelée Kicking The Stigma et le porte-parole de la campagne est le défenseur vedette Darius Leonard, qui parle ouvertement de ses crises d’angoisse et de sa dépression. Mais pour chaque équipe qui s’attaque aux problèmes de santé mentale et tente de lutter contre la stigmatisation qui leur est associée, il semble y avoir un autre groupe qui tarde à faire de même. La Ligue canadienne de hockey a récemment publié un rapport dévastateur sur l’existence d’un « code du silence » qui a permis à l’inconduite à l’extérieur de la patinoire de devenir une « norme culturelle ».
« Je connais certaines organisations et certaines équipes qui prennent la santé mentale très au sérieux, et il y a des psychologues du sport qui sont impliqués dans la résolution de problèmes dans une perspective de justice sociale, poursuit la Dre Giannone. Par exemple, ceux qui travaillent avec des cas d’abus ou d’inconduite sexuels. Ces psychologues ont contribué à la création de changements systémiques dans certaines organisations. On observe de plus en plus de politiques de santé mentale, ou de politiques de diversité et d’inclusion être mises en œuvre dans les organisations. J’espère que les gens en ressentiront les effets, et que ce ne sera qu’une question de temps avant que toutes les grandes organisations sportives emboîtent le pas. »
Pour la première fois depuis longtemps, les joueurs de la LNH ne sont pas présents aux Jeux olympiques. Cela signifie que les équipes de hockey qui s’affrontent se répartissent en deux catégories : soit un groupe de joueurs qui jouent ensemble dans un contexte ou un autre depuis longtemps, soit une équipe composée des meilleurs joueurs disponibles qui ont peu d’expérience de jeu entre eux. Comment créer une dynamique de groupe et développer la confiance de l’équipe? Selon la Dre Giannone, ces questions sont de plus en plus du ressort des psychologues du sport et des CPM.
« Les psychologues du sport ne se contentent plus d’offrir des formations classiques sur les aptitudes mentales et de simples évaluations des compétences mentales. Aujourd’hui, mon travail se concentre sur l’optimisation des performances, mais il concerne également d’autres difficultés propres au sport, notamment la dynamique de groupe entre les membres de l’équipe, le leadership des entraîneurs et la gestion de divers problèmes de santé mentale rencontrés par les athlètes, comme l’épuisement professionnel, la dépression, l’anxiété ou les troubles de l’alimentation. À bien des égards, le rôle du psychologue du sport a été réinventé et consiste désormais à répondre à la fois aux besoins psychologiques et aux exigences de la performance inhérentes au sport. »
La Dre Giannone travaille principalement en pratique privée au Vancouver Psychology Centre, où elle reçoit des clients en psychologie générale et d’autres personnes qu’elle aide en sa qualité de psychologue spécialisée en psychologie du sport et de la performance. Dans cet espace, elle voit un large éventail d’athlètes et d’artistes – des jeunes jusqu’aux professionnels. À l’occasion, elle accepte un contrat avec une équipe, pour laquelle elle met en œuvre un programme de développement des aptitudes mentales ou fournit d’autres services de groupe. Elle travaille également avec le Canadian Centre for Mental Health in Sport (CCMHS), où elle offre des services de santé mentale aux athlètes et aux artistes.
« Depuis 2013, le financement fédéral de ces services a vraiment augmenté, et ce, assez rapidement. Il existe aujourd’hui quelques services financés par le gouvernement fédéral destinés aux sportifs de niveau national. Par exemple, il y a le programme Plan de match, qui offre une vaste gamme de services aux athlètes brevetés de haut niveau au Canada. Mon rôle au CCMHS s’adresse à tous les sportifs, entraîneurs et administrateurs, quel que soit leur niveau, et permet à certaines personnes d’accéder à du financement à cet effet. Les autres pays sont un peu en retard dans ce domaine, ce qui fait du Canada un chef de file dans la sphère de la santé mentale des sportifs. »
Comme c’est le cas de tous les événements majeurs des deux dernières années, la COVID est une question centrale des Jeux olympiques de 2022. Elle a perturbé l’entraînement, entravé la consolidation des équipes et fait perdre à de nombreux athlètes la chance de concourir sur la scène mondiale. La COVID a même coûté à certains athlètes la chance de concourir après leur arrivée aux Jeux, lorsqu’un test positif a mis fin prématurément à leur parcours olympique. La Dre Giannone a vu tous les hauts et les bas créés par la pandémie chez les athlètes de tous les niveaux.
« Au début, les sports étaient sur pause. Les tournois importants ont été reportés. À ce moment-là, il fallait vraiment modifier et faire évoluer les services psychologiques vers un mode de prestation en ligne. Nous avons fait des choses en équipe avec plus de 25 personnes sur Zoom! Au cours de la dernière année, de nombreux athlètes ont repris le sport, et il se présente des défis nouveaux auxquels nous n’avons jamais été confrontés auparavant. Le contenu du travail a changé – imaginez un jeune athlète qui n’a participé à aucune compétition au secondaire depuis deux ans. Il était en secondaire 2, et il est maintenant en secondaire 4. Ce que cela représente pour ces jeunes sur le plan du développement et du perfectionnement des compétences propres au sport est intéressant.
Mes recherches portent principalement sur le développement de l’identité dans le sport. Ce qui arrive lorsqu’une personne se blesse ou prend sa retraite, et la perte d’identité qui en découle. La COVID est à l’origine d’un grand nombre de menaces pour l’identité, qu’il s’agisse d’enfants ou d’athlètes olympiques. Ces personnes qui tirent du sport une telle estime de soi et une telle valeur sont involontairement contraintes de le mettre de côté pendant un certain temps. Cela peut être très déstabilisant pour les gens.
Je dirais, à l’inverse, que la COVID a offert aux athlètes une occasion inédite de pratiquer leur sport d’une manière nouvelle et différente. Prenons l’exemple d’un sportif qui n’avait jamais le temps de regarder des vidéos de lui-même. Désormais, il est capable d’apprendre des choses différentes sur lui-même. Il est peut-être capable de faire un peu plus de musculation. J’ai été frappée par la résilience et la créativité dont ont fait preuve les gens durant cette période.
Ce qui m’a vraiment frappée au début de la pandémie, c’est le passage de l’entraînement aux compétences physiques et mentales à la création de nouvelles conceptions de la culture d’équipe. Je me souviens d’être intervenue dans des équipes et d’avoir aidé à faciliter la réalisation des objectifs, et à cultiver les valeurs de l’équipe et les relations entre ses membres. Cela ne veut pas dire que je ne le ferais pas pendant une saison régulière, mais la pandémie a vraiment mis cela en évidence car il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire quand la situation était si incertaine. »
La santé mentale des athlètes est un domaine en expansion rapide. Le rôle des psychologues dans la résolution de certains problèmes sociaux et systémiques tels que les comportements inappropriés des athlètes, la violence dans le sport, les abus et le harcèlement, l’inclusion et la diversité culturelle, devient de plus en plus important. Les psychologues participent à la création de mesures de soutien, mais aussi à la promotion de changements systémiques au sein des systèmes et des organisations, et tout cela se répercute sur les athlètes. Mais leur influence et leur implication ne se limitent plus aux vestiaires.
Comme l’évoque la Dre Giannone, « les professionnels de la psychologie du sport sont désormais sortis du cadre traditionnel du sport et de l’exercice. Ils s’occupent des problèmes liés à la performance dans d’autres domaines. Il n’est pas rare de voir des psychologues du sport travailler avec des militaires, des artistes de la scène, des premiers intervenants ou des dirigeants d’entreprise de haut niveau. Presque tout le monde se retrouvant dans des situations très stressantes. Je m’attends à voir davantage de psychologues possédant ces compétences spécialisées se frayer un chemin dans divers milieux. »
Les Jeux olympiques, qui se déroulent en ce moment même, présentent une gamme de situations stressantes pour les athlètes, sous le regard du public, tous les jours, toute la journée. Nous pouvons nous réjouir de la performance improbable de l’équipe canadienne en poursuite par équipes de patinage de vitesse, mais aussi compatir à la douleur de l’équipe japonaise, dont la chute de l’une de ses membres a donné la médaille d’or au Canada. Nos yeux, les yeux du monde, ajoutent une pression inédite pour ces sportifs. Cette situation peut être difficile, et un psychologue peut aider l’athlète à y faire face. Que vous soyez Jennifer Jones, qui participe à ses deuxièmes Jeux olympiques à l’âge de 47 ans ou une planchiste de 16 ans, qui s’apprête à retourner à ses cours de géographie.

Dr Jude Mary Cénat

Dre Helen Ofosu

Anita Shaw
Dr Jude Mary Cénat, Dre Helen Ofosu, Anita Shaw, Kafui Sawyer, Dre Erin Beettam, et Dre Monnica Williams, Section de Personnes Noires en Psychologie

Kafui Sawyer

Dre Erin Beettam

Dre Monnica Williams
L’une des deux nouvelles sections de la SCP est la Section de la psychologie des Noirs; elle vise à accroître la présence des professionnels de la psychologie noirs et à accroître l’accès aux services de santé mentale pour la communauté noire.
Section de Personnes Noires en Psychologie
« Quel domaine peut être plus antiraciste que la psychologie? Nous sommes là pour soutenir les êtres humains, le développement de la personne et le bien-être des individus! Il n’y a pas de domaine qui puisse aborder les questions raciales aussi bien que la psychologie. »
Jude Mary Cénat, Ph. D., se passionne pour la lutte contre le racisme en psychologie et invite ses collègues du secteur de la santé mentale à se joindre au mouvement. Le Dr Cénat est professeur agrégé à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa et le directeur du Laboratoire de Recherche Vulnérabilité, Trauma, Résilience et Culture (V-TRaC).
Au Canada, les populations racisées vivent des traumatismes et des problèmes de santé mentale qui leur sont propres. Les Canadiens noirs ne font pas exception. En plus des choses qui touchent tout le monde – la pandémie, le stress au travail, les problèmes familiaux –, ils doivent faire face au racisme sociétal, ainsi qu’à l’hostilité et aux microagressions au travail, qui font partie de la vie quotidienne dans notre pays.
« Nous ne pouvons continuer à perpétuer et à encourager la discrimination raciale. Nous ne pouvons continuer à nous contenter d’être une société “sans préjugés raciaux”. Les personnes qui connaissent de hauts niveaux de discrimination raciale sont trente-six fois plus susceptibles de présenter des symptômes graves de dépression. »
La volonté de s’assurer que la psychologie joue le rôle de chef de file qu’elle peut et doit jouer dans la résolution des problèmes raciaux est l’un des principes qui ont amené cinq membres et affiliées de la SCP à devenir la force motrice de la création d’une nouvelle section, la Section de la psychologie des Noirs. Kafui Sawyer, Anita Shaw, la Dre Helen Ofosu, la Dre Monnica Williams et la Dre Erin Beettam ont donné à la section la mission de soutenir et de servir les praticiens, les éducateurs, les étudiants et les scientifiques du domaine de la psychologie qui s’identifient comme Noirs et qui s’intéressent aux questions de nature psychologique qui ont une incidence sur la population noire. Chacune d’entre elles a vu l’impact de la discrimination raciale, certaines personnellement, au cours de sa carrière.
La Dre Helen Ofosu est psychologue du travail et des organisations, coach pour cadres et conseillère en ressources humaines à Ottawa. Elle travaille avec des organisations, y compris des ministères, pour améliorer la culture organisationnelle et l’inclusion. Dans les deux dernières années, depuis le début de la pandémie, elle a remarqué que beaucoup d’employés racisés décident de chercher du travail dans des organisations plus inclusives, car ils se rendent compte qu’en travaillant à domicile, ils ne sont plus soumis aux outrages quotidiens qu’ils subissent dans un lieu de travail physique. « Ce genre de choses se produit depuis des années, mais maintenant, les gens ne sont plus dans leur environnement habituel, et ils ont la tranquillité d’esprit que procure le fait de pouvoir travailler sans se soucier des microagressions ou craindre de se faire regarder de travers ou d’être exclus des déjeuners, des pauses-café et des conversations. Lorsque tout cela disparaît, les gens se sentent beaucoup plus détendus car ils peuvent se concentrer sur leur travail.
Je crois que le véritable déclencheur a eu lieu à l’été 2021, au moment où de nombreuses organisations planifiaient le retour au travail de leurs employés dans leurs locaux. Ce n’est que lorsque les gens ont commencé à réaliser “Oh mon Dieu, je vais peut-être devoir retourner au bureau” qu’ils se sont mis à se dire “Un instant! Je ne pense pas être capable de retourner au bureau. Je ne veux pas retourner au bureau! Je ne veux pas retourner à ce que les choses étaient avant.” »
Pendant tout ce temps de réflexion, beaucoup de gens ont jugé qu’il était opportun pour eux de changer d’emploi et de trouver un lieu de travail où il y a plus de représentation, plus d’inclusion, plus de diversité, en somme, un milieu où il y a une meilleure culture organisationnelle. D’après ce que j’ai vu, les gens réfléchissent à plein de choses pendant la pandémie. Ils tentent donc de trouver un emploi où ils peuvent être eux-mêmes et se concentrer sur leur travail au lieu de chercher continuellement à se protéger contre toutes ces agressions psychologiques. »
Anita Shaw est étudiante au doctorat à l’Université de Northern British Columbia.
« Pendant que je fais mon doctorat, je réfléchis vraiment à la décolonisation, raconte-t-elle. Non seulement la décolonisation de ma propre pensée, mais aussi la façon dont la psychologie a contribué à la colonisation et comment elle pourrait contribuer à la décolonisation. J’ai travaillé avec un mentor qui est un chercheur autochtone, et nous avons élaboré un modèle de programme de cours visant à décoloniser la psychologie. »
Kafui Sawyer est une psychothérapeute, une consultante en traumatologie pour Santé Canada et la directrice clinique du Joy Health and Research Centre. Elle aide les familles à traverser des expériences traumatisantes, aide les employés du gouvernement qui ont vécu certaines expériences et situations difficiles (comme le racisme) dans leur milieu de travail, et bien plus encore. Souvent, les clients demandent de travailler avec elle, car elle est Noire et a un vécu commun avec eux. Pour elle, ce qui est le plus gratifiant, c’est de travailler sur des cas complexes comme les troubles de la personnalité, et de voir ses clients passer d’une personnalité pathologique à une personnalité plus saine.
Comme le mentionne Mme Sawyer, ce qu’espèrent les fondatrices de la section, c’est « créer un espace où des gens qui ont des valeurs et des croyances similaires peuvent faire bouger les choses. Nous espérons que la section rassemblera des personnes animées du même esprit afin de prendre notre place au sein de la SCP. » Pour les fondatrices, la section offre l’occasion de créer un espace où les gens peuvent mettre en commun leurs intérêts et leurs expériences de manière à « se donner les moyens de devenir meilleurs ».
De plus, la Section de la psychologie des Noirs est un espace important pour les alliés des membres, des étudiants et des affiliés noirs. La Dre Erin Beettam s’identifie comme une psychologue clinicienne pour enfants et adolescents. Bien qu’elle ait reçu une formation en psychologie scolaire, elle travaille principalement dans les hôpitaux, en pédopsychiatrie et dans le système public de santé mentale. Erin se spécialise dans le traitement des adolescents et des jeunes adultes qui souffrent d’anxiété, de dépression, de troubles de la personnalité en émergence et de troubles de l’alimentation. Elle travaille actuellement dans une commission scolaire et exerce en pratique privée. Elle mentionne qu’elle est de plus en plus consciente de « l’absence de services accessibles et efficaces pour les personnes de couleur, pour les communautés noires, dans les milieux de travail et dans les milieux d’enseignement ». Cette prise de conscience l’a amenée à examiner ce qu’elle « peut donner et faire pour apporter son soutien dans ce paysage en mutation ».
La Dre Monnica Williams est chercheuse à l’Université d’Ottawa et milite depuis longtemps pour l’inclusion dans la recherche. Pendant trop longtemps, les personnes de couleur ont été exclues des recherches de toutes sortes, notamment dans divers domaines de la psychologie.
« Une grande partie de la recherche qui se fait exclut d’emblée la diversité, et non seulement elle perpétue le problème, mais elle en est aussi le symptôme. Le fait que nous n’ayons pas assez de chercheurs de couleur pour faire des recherches pour les personnes de couleur est une partie du problème.
Je fais beaucoup de recherches pour mettre en lumière ces questions – comment les traitements doivent être adaptés aux personnes de couleur, comment les thérapeutes qui sont actuellement en formation peuvent en apprendre davantage sur la manière de traiter les gens dans une optique plus inclusive. Tout le monde doit comprendre les meilleures pratiques lorsqu’il s’agit de travailler avec les questions raciales, ethniques et interculturelles. »
Le collègue de la Dre Williams à l’Université d’Ottawa, le Dr Cénat, fait également la promotion de ces meilleures pratiques en matière de race, d’ethnicité et d’interculturalisme. Ses collègues et lui ont créé un cours appelé « Comment fournir des soins de santé mentale antiracistes », qui donne droit à des crédits de formation continue approuvés par la SCP. Le Dr Cénat espère que tous les professionnels de la santé mentale et les Canadiens en général s’engageront dans la lutte contre le racisme.
« Comme l’a dit Ikram Kendi, il n’y a pas de “racistes” et de “non-racistes”. Il y a des “racistes” et des “antiracistes”. Si vous êtes simplement “non raciste”, vous ne posez pas de geste qui puisse contrer le racisme. Et ce n’est qu’en agissant contre le racisme que nous créerons une société antiraciste. »
La Section de la psychologie des Noirs, dont la création a été approuvée par le conseil d’administration de la SCP en novembre 2021, recrute désormais des membres. Une fois que les membres seront réunis, la section proposera son mandat au conseil d’administration de la SCP aux fins d’approbation, et procédera ensuite à l’élection de son comité exécutif; toutes ces démarches devraient être achevées en 2022. L’objectif de la section sera de travailler avec d’autres intervenants pour accroître la présence de professionnels noirs en psychologie et faciliter l’accès de la communauté noire aux services de santé mentale, de mieux-être et de consultation, ainsi qu’aux services organisationnels, en mettant l’accent sur les membres de cette communauté qui ont de la difficulté à avoir accès aux soins de santé mentale appropriés et à d’autres services psychologiques (p. ex., formation, leadership, interventions organisationnelles, recherche fondamentale et appliquée, etc.). La section pourra éventuellement devenir un espace communautaire pour les membres, les affiliés et les étudiants affiliés de la SCP qui s’intéressent à ces questions et, en particulier pour les étudiants, les éducateurs, les chercheurs et les psychologues noirs. Pour en savoir plus sur la façon de se joindre à la section, rendez-vous à l’adresse https://cpa.ca/fr/sections/black-psychology/.

Dr Vinay Bharadia

Dre Kristina Gicas
Dr Vinay Bharadia et Dre Kristina Gicas, Neuropsychologie clinique
Notre cerveau et notre corps entretiennent une relation, parfois harmonieuse, parfois conflictuelle. C’est le domaine de la neuropsychologie clinique. Nous avons parlé au Dr Vinay Bharadia et à la Dre Kristina Gicas pour en savoir plus.
Le mot « neuropsychologie » est difficile à prononcer. Il ressemble à un mot que l’on utilise pour avoir l’air intelligent. Comme « nomenclature » ou « cumulatif ». Comme il faut beaucoup de temps pour le dire, les neuropsychologues ont trouvé un moyen astucieux de raccourcir ce terme – ils disent plutôt « neuropsy ». Le fait d’omettre les deux dernières syllabes a sans aucun doute permis, au fil des décennies, d’économiser un nombre incalculable d’heures de conversation dans les départements universitaires de partout au Canada.
Ajoutez le mot « clinique » et vous voilà dans un tout nouveau monde, à la nomenclature encore plus complexe. Et ce monde, la Dre Kristina Gicas, présidente de la Section de neuropsychologie clinique de la SCP, est heureuse de le faire découvrir. La Dre Gicas est neuropsychologue clinicienne et professeure adjointe à l’Université York, où elle forme des étudiants en neuropsychologie clinique. Elle enseigne, fait de la recherche et exerce aussi des activités cliniques à Toronto.
« La neuropsychologie clinique est l’étude de la relation entre le cerveau et le comportement, dit-elle. Nous examinons la structure et le fonctionnement du cerveau, et nous étudions comment ces éléments sont reliés aux capacités de réflexion. Cela comprend l’attention, la mémoire, le langage, les habiletés visuelles, la vitesse de traitement et même le fonctionnement émotionnel. »
Les neuropsychologues sont des spécialistes de l’étude de ces relations entre le cerveau et le comportement, et de l’utilisation de ces informations à diverses fins. La première chose qu’ils font est de diagnostiquer certaines choses comme les blessures ou les maladies qui touchent le cerveau (commotion cérébrale, accident vasculaire cérébral, tumeurs, démence). Ils cherchent également à comprendre le développement normal de la personne et son vieillissement. Un autre domaine de spécialisation des neuropsychologues est la conception et la mise en œuvre d’interventions visant à améliorer le fonctionnement quotidien des individus.
La SCP désigne cette section sous le nom de « neuropsychologie clinique », car tous les neuropsychologues reçoivent d’abord une formation de psychologue clinicien. Le volet « neuropsychologie » est une spécialisation, que les praticiens acquièrent en suivant des cours supplémentaires, par exemple, des cours de doctorat en neuroanatomie (un autre mot difficile à prononcer – seulement, celui-ci est difficile à contracter). Ils apprennent ce que sont les outils d’évaluation et les tests cognitifs, ce qu’ils signifient et comment ils sont utilisés. La plupart des psychologues peuvent faire passer ces tests, mais ce sont les neuropsychologues qui peuvent les relier au fonctionnement du cerveau – la relation entre cerveau et comportement dont il est question ci-dessus.
Vous avez peut-être remarqué que l’un de vos parents commence à perdre la mémoire et à être moins attentif aux tâches qu’avant. Vous pourriez l’amener chez le médecin, qui pourrait alors lui faire passer un test, comme le MoCA Test (Montreal Cognitive Assessment). Il s’agit d’une évaluation préliminaire qui peut aider à déterminer dans quelle mesure une intervention est nécessaire. Si votre parent atteint un certain seuil, il pourrait être dirigé vers un neuropsychologue clinicien, comme le Dr Vinay Bharadia.
Le Dr Bharadia partage son temps entre un cabinet privé, les Cliniques TELUS Santé, où il occupe le poste de responsable de la neuropsychologie, et l’Université de Calgary, où il forme des psychologues au niveau du doctorat et de la maîtrise. Il travaille principalement avec des personnes souffrant de lésions cérébrales, de démence, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et d’autres pathologies neurologiques qui affectent la fonction cognitive.
« Si vous êtes dirigé vers nous, nous effectuons des tests plus poussés de la mémoire, de l’attention et d’autres capacités cognitives, après que votre médecin généraliste a effectué un test de dépistage, comme le MoCA Test, explique-t-il. Nous recherchons également des signes de dépression et d’anxiété, car ils peuvent également affecter les capacités cognitives. Nous établissons ensuite un lien entre les tests que nous effectuons et l’hippocampe ou le thalamus – des parties du cerveau que nous savons liées à la mémoire – ou d’autres zones et réseaux neuronaux. Nous examinons vos antécédents médicaux, les résultats de vos tests d’IRM et de tomodensitogramme, etc., et nous tentons de poser un diagnostic ou de déterminer le traitement à prodiguer. »
Une grande partie des recherches effectuées par les spécialistes des sciences cognitives, comme Jonathan Wilbiks, de la Section cerveau et science cognitive (voir l’article précédent du Mois de la psychologie), influencent le travail des neuropsychologues cliniciens. Les spécialistes des sciences cognitives produisent des recherches et des données, et il revient ensuite aux neuropsychologues cliniciens d’appliquer ces connaissances dans un cadre clinique pour améliorer la vie de leurs patients. Et ces patients sont très différents selon leur état, leurs symptômes et leur âge.
Le Dr Bharadia poursuit : « Si vous avez 25 ans et présentez des symptômes de dépression, vous ne verrez probablement pas un neuropsychologue. Vous serez plus susceptible de consulter un psychologue clinicien ou un thérapeute, et peut-être un omnipraticien pour la prise de médicaments. Mais si vous avez 55 ans et êtes atteint de dépression, il est à espérer que l’omnipraticien se demande si cela pourrait être autre chose. Qu’est-ce qui ressemble à une dépression dans la cinquantaine? Si l’on tient compte de certains éléments de vos antécédents médicaux et des informations que pourrait révéler une IRM, il pourrait s’agir d’un symptôme de démence frontotemporale, qui ressemble parfois à une dépression dans certains groupes d’âge. À ce moment-là, il serait bon que vous passiez un test avec un neuropsychologue afin d’affiner le diagnostic. »
Cela signifie que les neuropsychologues travaillent beaucoup en équipe, avec les omnipraticiens, les psychiatres, les neurologues qui effectuent des IRM et de nombreux autres professionnels du monde des sciences du cerveau, dont les compétences se chevauchent. Si la personne de 55 ans présentant des symptômes de dépression rencontre cette équipe, celle-ci pourrait déterminer que la cause est neurologique, et dans ce cas, elle suggérera un traitement. Si, toutefois, on détermine que la cause est psychologique, un neuropsychologue pourra travailler avec la personne pour la soigner (car, ne l’oublions pas, les neuropsychologues sont d’abord des psychologues cliniciens).
La neuropsychologie est un domaine officiel qui existe depuis 70 ans. Les travaux précurseurs de la Dre Brenda Milner, à l’Université McGill, réalisés dans les années 1950 avec le patient H.M., ont révolutionné notre compréhension de la mémoire. Ce remarquable travail a été réalisé aux côtés du Dr Wilder Penfield, neurochirurgien. La Dre Milner EXERCE ENCORE à McGill à l’âge de 102 ans. D’autres pionniers ont mis sur pied un programme de neuropsychologie à l’Université de Victoria, où la Dre Gicas a fait son baccalauréat. C’est ce qui l’a conduite sur cette voie (ainsi que sa fascination pour le cerveau et sa passion pour la science en général).
« Je me souviens d’avoir lu un livre d’Oliver Sacks, intitulé L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau (1985), mentionne-t-elle. Ce livre présentait une série de cas neurologiques et je suis tout de suite devenue férue de neuropsychologie. »
Dans un épisode de Parcs et loisirs, Ben ne comprend pas la relation entre Jerry (Jim O'Heir) et sa femme Gayle (Christie Brinkley), visiblement plus belle, et suppose que c’est le résultat d’un trouble neurologique (« l’un des troubles évoqués par Oliver Sacks – elle pense peut-être que Jerry est un chapeau sympa? »). Ce n’est peut-être pas le meilleur exemple de neuropsychologie dans la culture populaire, dans la mesure où il est tout à fait faux – mais ce n’est pas une étude aussi simple à réaliser! À moins que vous ne puissiez contourner l’effet cumulatif de toute cette nomenclature difficile.

Dre Karen Blair

Dr. Rhea Ashley
Hoskin

Bre O’Handley
Dre Karen Blair, Dre Rhea Ashley Hoskin, et Bre O’Handley Orientation sexuelle et identité sexuelle
Le champ de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre a grandement évolué au cours des dernières années, de l’obtention du mariage entre personnes de même sexe, en passant par l’abolition des thérapies de conversion. Nous avons discuté de ces progrès avec la Dre Karen Blair, la Dre Rhea Ashley Hoskin et Bre O’Handley. Nous avons aussi abordé une expression que vous n’avez peut-être jamais entendue auparavant, la « féminophobie ».
Orientation sexuelle et identité sexuelle
« Je n’aime plus la bière. »
Un message publicitaire à la télé nous présente un homme qui avoue à l’un de ses amis, en murmurant honteusement, qu’il n’aime plus le goût de la bière. S’installe alors une entente implicite entre nous, les téléspectateurs, et les hommes de la publicité : le fait qu’il n’aime plus la bière atteint son sentiment de masculinité. Que de boire une bière avec les « gars » fait partie de son identité mâle qu’il est honteux de perdre. Et que le fait de ne pas aimer la bière le rend ‘féminin’, et donc moins digne de mérite que les autres.
La Dre Rhea Ashley Hoskin est titulaire de la bourse postdoctorale AMTD Waterloo Global Talent de l’Université de Waterloo, où elle est affectée au département de sociologie et d’études juridiques et à celui des études sur la sexualité, la famille et le mariage. Elle est secrétaire-trésorière de la Section de l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle de la SCP. En général, son travail est axé sur la diversité sexuelle et de genre, plus particulièrement sur le traitement sociétal de la féminité et la « féminophobie ».
« La féminophobie évoque la manière dont la société déprécie et régule la féminité et tout le monde peut en être la cible. Elle peut viser un homme cisgenre qui commande une salade, ou qui est vu comme efféminé, parce que la féminité est souvent perçue comme une rétrogradation sociale. Nous observons également la féminophobie qui cible les femmes du domaine scientifique pouvant être vues comme trop ‘féminines’ et être traitées comme si elles étaient incompétentes parce qu’elles sont trop maquillées ou parce qu’elles n’ont pas l’air de scientifiques. »
Dans la publicité, l’ami du protagoniste traite son aveu de ne plus aimer la bière avec un haussement d’épaules et ne semble pas croire que celui-ci soit pour autant un homme diminué. Et puis, évidemment, il lui offre autre chose qu’une bière, un alcool fort, que nous les téléspectateurs supposons être une substitution adéquate et aussi masculine aux yeux de la société.
La féminophobie touche à la fois les gais et les hétérosexuels, les hommes et les femmes, et même les personnes qui s’identifient comme non-binaires. Nous vivons tous, la plupart du temps inconsciemment, les tiraillements entourant la définition de notre personnage public en fonction de ce qui est vu comme féminin. Chacun de nous est, d’une façon ou d’une autre, touché par cette situation, que ce soit les hommes qui commandent une bière régulière au lieu d’une bière légère, par crainte d’être vus comme trop ‘féminins’, ou les femmes qui portent moins de maquillage pour paraître plus intelligentes ou ‘professionnelles’.
La Dre Karen Blair est professeure adjointe de psychologie à l’Université Trent. Elle est la présidente de la Section de l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle de la SCP depuis 2014. Ce qui est bien avec la féminophobie, c’est qu’une fois qu’elle a fait tilt, on commence à la voir partout. On commence à remarquer toutes les façons dont nous dévalorisons la féminité. Chez les hommes, nous avons un éventail assez étroit de la « féminité acceptable », et la plupart du temps, nous préférons qu’ils n’en aient aucune. Dans les vestiaires d’une équipe de football, l’entraîneur pourrait, pour invectiver les joueurs de son équipe, dire qu’ils jouent comme « des filles ». C’est dit pour injurier, et les joueurs comprennent le message, et que l’entraîneur est insatisfait. Si un homme a une démarche trop ‘féminine’, parle de manière efféminée, ou parle avec ses mains, il perd des points pour ces raisons. Dans notre société, nous utilisons la féminité comme une arme ou une insulte. »
L’occupation se déployant à Ottawa depuis quelques semaines a donné lieu à une recrudescence des attaques envers le premier ministre, à la fois parmi les insurgés et dans les médias sociaux. La Dre Blair et la Dre Hoskin surveillent ce genre de choses. À quoi ressemblent les attaques dirigées envers les personnalités publiques et les politiciens, et pourquoi la féminophobie en fait-elle si souvent partie?
« Quand les gens veulent attaquer Justin Trudeau, ils posent certains gestes : d’abord, ils ont tendance à l’appeler par son prénom. Quand nous étions irrités par Stephen Harper, nous l’appelions quand même Harper. Mais quand nous sommes irrités par Trudeau, nous employons son prénom, et certains l’appellent même Justine. Pourquoi serait-ce une insulte que d’appeler quelqu’un par un prénom féminin? Pourquoi est-ce insultant de féminiser une autre personne? La réponse est la misogynie et la féminophobie. Ce ne sont pas que les politiciens comme le premier ministre qui en sont la cible; nous faisons cela à tous les niveaux. Quand les gens veulent se moquer de Poutine ou de Trump, l’un des mèmes les plus communs sur Internet est d’ajouter du fard à leurs visages pour leur donner l’allure d’une femme trop maquillée. Peu importe ce que l’on pense de Trudeau, Trump ou Poutine, ils se font tous écraser par la même attaque contre la ‘féminité’. On l’emploie pour affirmer qu’ils sont inférieurs, stupides, idiots, frivoles, ou excessifs. Toutes ces idées peuvent être transmises simplement en les rendant féminines. Ce qui nous donne à penser : que disons-nous vraiment des gens qui sont féminins? C’est un peu comme quand les gens avaient l’habitude de dire “oh, c’est tellement gai”, alors qu’ils voulaient en fait qualifier une chose de stupide ou insignifiante. »
‘Nous’ (la société) avons fait beaucoup de chemin au cours des dernières décennies. Lorsque la Section de l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle a été lancée au début des années 2000, la question la plus urgente était le mariage entre personnes de même sexe. L’expansion des droits civils au Canada pour les couples de même sexe était une préoccupation majeure chez plusieurs psychologues. Pendant cette période, un énoncé de politique de la SCP affirmait notre soutien à l’idée selon laquelle les couples de même sexe avaient le droit de se marier. Cela semble un peu étrange aujourd’hui, le fait que nous soutenions évidemment cette idée, mais la Dre Blair affirme qu’il s’agissait d’un énoncé assez novateur et stimulant à l’époque.
« Au début des années 2000, la recherche démontrait que les relations entre personnes de même sexe étaient semblables aux relations entre personnes de sexes différents en ce qu’elles étaient bénéfiques pour les gens, et saines, et que l’amour, c’est l’amour. C’est sur ces éléments que s’attardaient les chercheurs. Ils essayaient d’aider les responsables des politiques à comprendre que si on exclut les gens d’une institution comme celle du mariage, cela modifie les relations qu’ils entretiennent avec leur famille, leurs amis et leurs collègues. Prenons l’exemple anodin des célébrations du temps des Fêtes dans une entreprise où les invitations incluent les conjoints. En 1999, il était loin d’être évident, pour un couple de même sexe, que le conjoint allait être inclus, et souvent, il était assez clair qu’il ne le serait pas. »
À cette époque, plusieurs estimaient qu’ils ne pouvaient pas parler de leur conjoint au travail, pas plus qu’avoir sa photo sur leur bureau. Les psychologues travaillant dans ce contexte ont été en mesure de souligner qu’au fil de temps, ces situations avaient des répercussions néfastes sur la santé mentale et le bien-être des personnes concernées. La Dre Blair poursuit ainsi : « Plusieurs recherches révélaient que les familles des personnes LGBTQ ne ‘comprenaient pas’. Et qu’elles ne comprenaient vraiment qu’au moment où elles assistaient au mariage. Les cérémonies de mariage comportent plusieurs conventions sociales qui nous indiquent quand il faut se lever, quand il faut porter un toast, quand il faut applaudir, et ainsi de suite. En intégrant les relations de même sexe à un rituel social que les gens comprenaient, on a instauré un environnement où les familles et les amis pouvaient comprendre la relation, ce qui à son tour a suscité un plus vaste soutien des cercles intimes de plusieurs individus LGBTQ, et par ricochet, une amélioration du bien-être mental au sein de toute la communauté. »
La santé mentale en a pris un coup pendant la pandémie, et ce, pour plusieurs raisons. Bre O’Handley est étudiante à la maîtrise en psychologie à l’Université de Trent et la Dre Blair est sa superviseure. Elle travaille à une thèse qui étudie le bien-être des personnes LGBTQ pendant la pandémie et la manière dont les mécanismes de soutien peuvent jouer un rôle dans cette situation.
« J’examine les trajectoires du bien-être chez les personnes LGBTQ pendant la COVID. De nombreuses études effectuées partout dans le monde ont révélé que les individus LGBTQ se portent plutôt mal pendant la pandémie. Leur santé mentale a été très affectée, ils rapportent des taux plus élevés de dépression, d’anxiété et de stress que les autres. Tout le monde vit la COVID et l’isolement social, mais il existe des facteurs supplémentaires qui pourraient avoir des répercussions chez les individus LGBTQ. Il se peut qu’ils vivent dans un milieu qui ne les soutient pas, particulièrement s’ils sont plus jeunes. Ils sont séparés des communautés solidaires, comme si vous aviez un groupe d’amis à l’école qui vous soutiennent et vous acceptent, mais que vous n’alliez plus à l’école. La pandémie diminue l’accès aux centres de ressources LGBTQ. Pendant longtemps, les personnes trans n’ont pas eu accès à leur traitement hormonal substitutif (THS) et aux chirurgies d’affirmation de genre, puisque ces services ont été jugés non essentiels au début de la pandémie, et que les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ont créé des délais dans la livraison d’importants médicaments et hormones. »
Dans plusieurs pays, on a même adopté des politiques de lutte contre la COVID discriminatoires. Au Pérou, on a mis en place un règlement qui obligeait les hommes à ne quitter la maison qu’à certains jours précis et les femmes, les autres jours. Par conséquent, les individus trans et ceux qui ne s’identifiaient comme homme ni comme femme faisaient face à des situations intenables. Ils sont plusieurs à avoir été harcelés et à subir des crimes haineux alors qu’ils étaient à l’extérieur de la maison. La recherche de Bre n’aborde pas la discrimination comme telle, mais davantage le soutien qui est nécessaire à ceux qui sont la cible de cette discrimination.
« Comment favoriser la résilience dans ces circonstances, et comment les personnes LGBTQ s’en sortent-elles pendant cette pandémie? Si je me sens proche de la communauté LGBTQ, alors ça devrait atténuer certains des problèmes qui touchent la santé mentale. Mais comment établir une distinction entre cet aspect et le soutien social plus général? Est-ce que le simple fait de compter sur le soutien des gens et des membres de la famille qui vous entourent est suffisant, ou avez-vous plutôt besoin de contacts sociaux avec les membres de votre groupe de pairs pour maintenir véritablement votre résilience? La situation actuelle, avec l’avènement de la COVID, nous donne l’occasion de démêler tout cela. »
Le travail n’est jamais terminé et de nouveaux défis émergent constamment. Le mariage entre personnes du même sexe est inscrit à la législation canadienne depuis seize ans. Depuis une décennie, l’adoption par les couples de même sexe est légale dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada. La thérapie de conversion est maintenant prohibée et plusieurs membres de la Section de l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle se sont activement engagés dans les discussions avec les responsables des politiques pour que cela se produise. Aujourd’hui, l’identité de genre rejoint la lutte pour les droits à l’égalité des couples homosexuels et lesbiens. Comme le mentionne la Dre Blair, « on peut en savoir beaucoup sur l’orientation sexuelle et les minorités sexuelles et ne rien savoir sur l’identité de genre et les minorités de genre, et vice-versa. Les deux dimensions se sont rejointes dans une même section de la SCP, alors que l’identité de genre était moins courante et que l’intérêt était probablement plus centré sur l’orientation sexuelle à ce moment-là. Avec le temps, le genre est devenu une question tout aussi importante que l’orientation sexuelle au sein de la section. »
Tous autant que nous sommes dans la société canadienne en apprenons un peu plus sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, à l’instar des scientifiques qui acquièrent des connaissances sur le sujet et nous renseignent en cette matière. La Dre Hoskin cadre cela sous l’angle de la féminophobie.
« Notre capacité de détecter la féminophobie provient de l’étude de la diversité sexuelle et de genre. La féminophobie est éclairée par notre habileté à établir des distinctions entre l’identité de genre et le sexe assigné à la naissance, et l’expression de genre. Lorsque nous pouvons voir ces choses comme différentes, nous pouvons voir comment l’expression du genre entre en jeu et comment elle est régulée par la société. »
Nous faisons tous partie de cette société, et la manière dont nous régulons nos attitudes à l’égard des membres de la population LGBTQ+ joue un rôle primordial dans le maintien et l’amélioration de leur santé mentale. Il peut s’agir d’utiliser les bons pronoms pour s’adresser à quelqu’un, d’embrasser sa fille lesbienne, ou quelque chose d’aussi simple que de dire avec assurance « Je n’aime plus la bière. »

Dre Shahnaz Winer
Dre Shahnaz Winer, Carrières et professions en psychologie
L’une des deux nouvelles sections de la SCP, la Section des carrières et des professions en psychologie, est un endroit où réseauter et collaborer, destiné aux personnes qui ont un diplôme en psychologie, mais qui travaillent dans d’autres sphères que le milieu universitaire ou la pratique clinique.
Carrières et professions en psychologie
En juin 2014, l’État islamique/DAESH envahit le territoire kurde du nord de l’Irak, capturant successivement Samarra, Mosul et Tikrit. La Dre Shahnaz Winer est une jeune célibataire qui enseigne la psychologie dans une université du Moyen-Orient de la région, endroit où elle est née et que sa famille l’incite à quitter. Elle choisit donc de monter dans l’avion qui la ramènera au Canada, alors que le Kurdistan est frappé de bouleversements et de violents affrontements.
La Dre Winer se remémore affectueusement la période où elle enseignait en Irak, soulignant qu’il s’agissait des meilleurs moments de sa carrière. Elle est évidemment attristée que ce chapitre ait dû prendre fin, et surtout de la manière dont il s’est terminé. Mais cette morosité est de courte durée. Elle occupe une série d’emplois voués à une sphère qui l’a motivée pendant toute sa carrière : la mise en application de la science et du savoir en psychologie pour rehausser le quotidien de… eh bien… tout le monde! Après plusieurs emplois à l’intérieur et à l’extérieur du milieu universitaire, elle démarre sa propre entreprise. Et c’est en tant que propriétaire de cette entreprise qu’elle s’adresse l’an dernier aux étudiants, lors du salon de l’emploi de la SCP.
Les salons de l’emploi de la SCP, tenus depuis quelques années, comptent parmi les activités les plus attendues, attirant une importante participation. Au cours de ces évènements, les étudiants ont l’occasion de se familiariser avec divers postes et parcours professionnels destinés aux diplômés en psychologie, et ce, à l’extérieur de la prestation de services de santé et des milieux universitaires. Qui plus est, ils sont en mesure de rencontrer des personnes qui occupent ces postes et d’explorer toute la gamme de possibilités d’emploi qui s’offrent aux diplômés en psychologie.
Des gens comme Sophie Kenny, qui travaille en technologie des mouvements oculaires chez VPixx Technologies. Ou encore Anne-Marie Côté, de TakingITGlobal, qui coordonne des excursions virtuelles pour les étudiants habitant les communautés autochtones des régions nordiques et éloignées. Ou bien notre collègue, la directrice générale associée de la SCP, Lisa Votta-Bleeker, dont le travail à la SCP est certainement distinct des milieux universitaires ou de la pratique clinique.
Ces activités permettent aux étudiants, aux professionnels et à d’autres personnes intéressées de réseauter dans un milieu conçu pour élargir les options offertes aux diplômés en psychologie et à tous ceux qui sont attirés par un parcours professionnel moins traditionnel. Mais que se passerait-il si ces gens qui partagent une vision commune pouvaient profiter d’un réseau pendant toute l’année, plutôt que seulement quelques fois lors d’activités ponctuelles? Voilà l’idée derrière la création de la toute nouvelle Section des carrières et des professions en psychologie de la SCP.
La Dre Winer s’est alliée à la Dre Votta-Bleeker pour lancer cette section. La Dre Winer détient un doctorat en neuroscience cognitive de l’Université de Waterloo. Elle est l’une de ces personnes ayant choisi un parcours non traditionnel. L’entreprise qu’elle a créée, Vibrant Minds, est une plateforme éducative en ligne où la Dre Winer amalgame les principes de la psychologie à d’autres sujets d’intérêt. Elle crée des produits numériques qui aident les gens à planifier, à fixer et à atteindre leurs objectifs de carrière et de vie.
« Le fait que je puisse toucher un auditoire international d’étudiants par ce moyen est l’un des aspects que j’apprécie le plus. Je peux entrer en contact avec plein de gens différents, et les aider à appliquer ce que la psychologie nous enseigne et ce que la recherche universitaire a découvert. »
La Dre Winer a bien fait un séjour dans un rôle traditionnel en milieu universitaire, en tant que professeure. Elle souligne que pendant cette période, elle a constaté que les étudiants convergeaient davantage vers un type particulier de cours.
« Les parties des cours qui soulevaient l’enthousiasme des étudiants étaient celles où ils pouvaient mettre en application ce qu’ils apprenaient dans leur propre vie. Par exemple, si nous explorions la mémoire, une session entière était consacrée à l’application du savoir pour qu’ils puissent étudier plus efficacement et se souvenir plus aisément des matières liées aux examens. Alors, c’est ce genre d’application qui m’a réellement stimulée et j’estimais que cet aspect était largement absent au sein de la psychologie traditionnelle et de toutes les autres professions et disciplines. Jeter un pont entre le volet universitaire et rejoindre les gens pour transmettre cette information. »
Lorsque la Section des carrières et des professions en psychologie commencera à recruter ses membres, la plupart d'entre eux seront des personnes qui comblent ce fossé; des personnes qui appliquent la science et le savoir en psychologie à toutes les industries imaginables à travers le Canada; des personnes qui rendent le transport aérien plus sûr, les milieux de travail plus inclusifs et créent des édifices à haut rendement qui minimisent l’empreinte écologique. Ce nouvel espace de collaboration rassemblera ces personnes, dans toute leur diversité.
« Cette section s’est réellement inspirée du besoin de fournir un lieu à ceux d’entre nous qui, comme moi, avons des antécédents en psychologie, sans avoir suivi une voie traditionnelle. Je suis devenue membre de la SCP quand j’étais étudiante. Mais quand j’ai quitté le milieu universitaire, j’ai aussi quitté la SCP parce que j’estimais qu’il n’y avait plus rien pour moi. Et je me sentais en fait très seule! C’était merveilleux de pouvoir compter sur ce genre de communauté, ce soutien et les ressources qu’offre la SCP. Alors, quand on a communiqué avec moi, avec l’idée de créer une nouvelle section, destinée particulièrement aux personnes intéressées aux champs d’activité extérieurs aux domaines typiques de la psychologie, mon intérêt s’est immédiatement éveillé! »
La Section des carrières et des professions en psychologie est actuellement à l’étape où elle a été approuvée. La prochaine tâche consiste à recruter les membres fondateurs. Avec 90 nouveaux membres dès les premières semaines de recrutement, la section connaît un départ dynamique. La Dre Winer a une idée de ce que pourraient être ces premiers membres. Elle songe à une alliance diversifiée composée de professionnels établis, en début de carrière et évidemment, d’étudiants.
« Nous voulons créer un espace accueillant pour les étudiants qui explorent leurs possibilités de carrière. Ce groupe compte beaucoup pour moi parce que je sens que j’ai été très privilégiée. Quand j’effectuais mes études de doctorat, pendant la première année, toute l’information qui me parvenait, tous les ateliers et tous les séminaires et salons de l’emploi, toutes ces activités étaient axées sur les étapes à franchir pour intégrer le milieu universitaire ou encore la pratique clinique. À ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je souhaitais connaître les autres options qui m’étaient offertes.
Ma superviseure, la Dre Myra Fernandes, croyait vraiment que nous devions explorer toutes les options mises à notre disposition. Alors, dans le cadre de notre propre laboratoire, elle a créé une série de séminaires où elle invitait différents conférenciers. Par exemple, une personne ayant fait des études en psychologie qui travaillait pour l’entreprise pharmaceutique Eli Lilly est venue nous entretenir de son parcours et de son travail. Le fait d’être exposée à ces débouchés m’a inspirée et m’a transmis beaucoup plus de connaissances. Cependant, mes camarades des études supérieures ne profitaient pas de ces occasions ou de ces renseignements supplémentaires. »
Certaines des autres personnes qui ont manifesté un intérêt pour la section sont des professionnels qui souhaitent échanger entre eux, des personnes qui sont disposées à offrir du mentorat aux étudiants et des personnes qui ont choisi la voie universitaire ou clinique, mais qui ont aussi d’autres intérêts. Plusieurs font ce que de nombreux diplômés en psychologie font, comme de la recherche. Mais ils l’effectuent dans un cadre hospitalier, gouvernemental, dans le secteur privé ou encore dans de jeunes entreprises, plutôt que dans une université. Par conséquent, ils ne se sentent pas très branchés au traditionnel volet universitaire.
Comme l’évoque la Dre Winer, « bon nombre de personnes se situent dans l’entre-deux, et c’est ce qui est si formidable de ce vaste spectre. Nous accueillons toute personne, d’où elle provienne, qui souhaite se joindre à nous et entrer en contact avec ce groupe de gens qui ont une large gamme d’intérêts. »
La Dre Winer s’estime chanceuse et elle est reconnaissante d’avoir vécu ces expériences lors de ses études et d’avoir par conséquent choisi une trajectoire non traditionnelle. En plus d’être doyenne des sciences sociales, d’occuper un éventail de postes d’enseignante et de mener sa propre entreprise, elle a aussi travaillé comme conceptrice et éducatrice de programmes d’enseignement, directrice d’une école de programmation pour les jeunes, et comme animatrice et coordonnatrice du Programme mémoire et vieillissement pour un groupe de centres d’hébergement pour personnes âgées de l‘Ontario.
Ce sont ces expériences que Dre Winer souhaite partager avec les autres membres de la nouvelle section – des personnes ayant des visions communes qui ont choisi différentes trajectoires de carrière et des étudiants qui tireraient grandement profit d’être exposés à des débouchés différents qu’ils n’auraient peut-être pas découverts autrement. L’idée derrière tout cela est de concevoir un grand et long salon des carrières, qui évolue et se développe sans cesse; un salon qui crée un lieu pour les diplômés en psychologie qui pourraient autrement avoir l’impression d’être sur une île; un salon qui fonctionne, collabore et agit en réseau, non seulement 48 heures à la fois, mais 365 jours par année.

Dr Marvin McDonald

Dre Tanya Mudry

Dre Jessica Van Vliet

Dr Houyuan (Hy) Luo

Dre Janet Miller
Dr Marvin McDonald, Dre Tanya Mudry, Dre Janet Miller, Dr Houyuan (Hy) Luo, et Dre Jessica Van Vliet, Psychologie du counseling
La psychologie du counseling a de nombreuses facettes et est exercée par de nombreux praticiens différents. Nous avons parlé avec cinq d’entre eux de leur travail et de la manière dont il influence la vie quotidienne des gens.
Syd Barrett a fondé Pink Floyd en 1964, et a été la force motrice de l’album phare du groupe, The Piper at the Gates of Dawn, paru en 1967. Il n’a participé qu’à un seul autre album, A Sauceful of Secrets, avant que des problèmes de drogue et de santé mentale ne conduisent à son départ du groupe. Il s’est ensuite retiré de la vie publique, gardant obsessionnellement sa vie secrète pendant 35 ans, jusqu’à sa mort en 2006.
En insistant pour qu’il y ait cinq membres sur scène en tout temps, la Section de la psychologie du counseling pourrait bien être la Pink Floyd des disciplines de la psychologie. Étant donné qu’il s’agit d’une discipline collaborative et inclusive, je n’étais pas surpris, lorsque j’ai demandé à rencontrer la Section de la psychologie du counseling de la SCP, qu’un groupe de cinq personnes se présente sur Zoom.
Le Dr Marvin McDonald est professeur à l’Université Trinity Western, en Colombie-Britannique. Il est le Syd Barrett du groupe (en ce sens qu’il est là depuis le début), l’ancien président qui a contribué à faire de cette section ce qu’elle est aujourd’hui. Le Dr McDonald a un peu plus d’expérience que les autres et a bien sûr vu l’évolution de la discipline.
« Lorsque j’ai fait mes études de doctorat aux États-Unis dans les années 1980, le cours d’éthique était un cours optionnel! souligne-t-il. Ce n’était pas un cours obligatoire; j’évoque ce fait simplement pour vous donner un exemple très concret de la façon dont ont changé les choses. Le point positif de la transition qui s’est opérée au fil des ans est que les normes professionnelles ont suivi les preuves empiriques. Lorsque j’ai commencé mon cours sur la psychopathologie de l’enfant, les données des enquêtes communautaires sur les besoins en santé mentale n’avaient pas encore été regroupées. La question des différences entre les sexes en ce qui concerne les besoins en santé mentale était toujours débattue dans la documentation. Ce n’est qu’à la fin des années 1980 et au début des années 1990 que les données ont montré clairement que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à demander de l’aide, et que les hommes présentent des taux plus élevés de consommation de drogue et de toxicomanie. C’est ce type de connaissances qui a fait progresser la psychologie du counseling au cours des dernières décennies et qui a une incidence considérable sur la pratique, et pas seulement sur la recherche. »
La Dre Tanya Mudry, professeure de psychologie à l’Université de Calgary et psychologue du counseling qui a quelques clients en pratique privée, est la nouvelle présidente de la section. Elle est la David Gilmour du groupe, dans la mesure où elle a remplacé le Dr McDonald – et dans le sens où elle fait avancer le groupe avec un but précis.
Pour elle, la psychologie du counseling est « un groupe assez diversifié. Nous avons tendance à travailler dans la collectivité avec les familles, les enfants et les couples. Nous travaillons souvent avec des personnes qui sont confrontées aux transitions de la vie – cela peut être des problèmes familiaux ou conjugaux – et avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des troubles liés à l’usage de substances psychoactives. Nous avons tendance à adopter une perspective diversifiée – de nombreux psychologues privilégient une méthode particulière de thérapie, tandis que les psychologues du counseling sont plus polyvalents. Certains s’intéressent au passé et à l’enfance. Certains s’intéressent au contexte social de l’individu ou à ce qui se passe à l’intérieur du cerveau, et d’autres encore se concentrent sur les questions de justice sociale et la défense des intérêts. »
La Dre Janet Miller est la Richard Wright de l’appel Zoom (Wright était le claviériste de Pink Floyd, connu pour sa maîtrise de divers instruments et pour les rythmes et mélodies jazz syncopés qu’il apportait à la musique). La Dre Miller travaille à l’Université Mount Royal de Calgary, mais elle n’est pas professeure. Elle est conseillère d’orientation et exerce également en pratique privée à Calgary. Elle apporte un style jazz improvisé à la conversation, lorsqu’on lui demande comment la psychologie du counseling peut affecter la vie quotidienne d’une personne qui ne suit pas, elle-même, une thérapie.
« Lorsque vous arrivez à la caisse à l’épicerie, l’employé vient tout juste de sortir d’une séance de counseling, où il apprend à gérer son anxiété sociale pour pouvoir travailler avec le public et être à l’aise avec les interactions publiques. En thérapie, il aura appris à prendre conscience de son corps, à se centrer et à mettre son anxiété de côté pendant un certain temps afin de pouvoir entrer véritablement en contact avec les gens. Il a peut-être utilisé les mécanismes d’adaptation qu’il a appris, et lorsque vous êtes arrivé à la caisse pour payer votre épicerie, l’interaction entre vous deux s’est déroulée sans heurts. Votre séance de magasinage à l’épicerie a été agréable, l’employé a passé une belle journée au travail et est rentré à la maison avec de l’énergie à consacrer à sa charmante famille. »
Le percussionniste du groupe, Nick Mason, est le seul membre de Pink Floyd à figurer sur ses cinq albums. Il est devenu l’emblème du « son Pink Floyd » et a écrit certaines des plus grandes chansons du groupe. Le Nick Mason de notre quintette est le Dr Houyuan (Hy) Luo, qui incarne tout à fait la définition classique du psychologue du counseling. Il exerce en pratique privée à Toronto et est le président désigné de la Section de la psychologie du counseling. Le Dr Luo affirme que, bien que la pandémie ait rendu la prestation de services de counseling plus difficile à certains égards, plusieurs de ses clients accueillent favorablement les nouvelles méthodes de prestation.
« J’ai commencé à offrir des services de counseling complètement virtuels en mars 2020. Je travaille au centre-ville de Toronto, dans les gratte-ciel, et les bureaux ont été pendant de nombreux mois désertés par les travailleurs. Les services de counseling en ligne étaient alors plus pratiques et plus faciles pour beaucoup de gens. Avec la vaccination, les gens reviennent lentement au bureau et nous nous attendons à recommencer graduellement à offrir des services en personne en plus des services virtuels. »
Le Dr Luo souhaite élargir le domaine de la psychologie du counseling pour y inclure davantage de personnes de couleur, car il y a une véritable pénurie de psychologues capables de partager leur vécu avec leurs clients, qui peuvent provenir de milieux différents.
« Toronto, où je travaille, est une ville très diversifiée. Les clients qui veulent travailler avec un psychologue qui a la même origine ethnique qu’eux ont de la difficulté à en trouver un, même à Toronto. Nous devons vraiment aider les étudiants PANDC du premier cycle dès qu’ils entrent à l’université, pour veiller à ce qu’ils soient soutenus tout au long de leur parcours. »
La Dre Jessica Van Vliet, la Roger Waters du groupe, est également très impliquée dans les changements sociaux et la défense de la justice sociale. Roger Waters, le bassiste et l’auteur-compositeur principal de Pink Floyd, est le membre qui a fait évoluer le groupe dans une direction plus ouvertement sociale (pensez à The Wall). La Dre Van Vliet, professeure à l’Université de l’Alberta en psychologie du counseling, affirme que le plus grand changement récent observé dans le domaine de la psychologie du counseling concerne la justice sociale.
« La justice sociale a toujours été importante en psychologie du counseling, mais elle l’est aujourd’hui plus que jamais. Elle est désormais à l’avant-garde de tout ce que nous faisons. Nous avons toujours mis l’accent sur la diversité, mais aujourd’hui plus que jamais, je pense que notre discipline joue un rôle de premier plan dans le domaine du travail interculturel et avec des personnes, des questions et des méthodologies différentes. Je pense également que le leadership et la défense des intérêts sont de plus en plus valorisés et mis en avant dans notre domaine. »
Pour l’instant, le plus grand problème de la psychologie du counseling – et de pratiquement toutes les autres industries, professions et disciplines de la psychologie du monde entier – est la COVID. Elle a fait augmenter le besoin de thérapeutes capables d’aider les personnes confrontées à l’épuisement professionnel, à la dépression, au désespoir et à tous les autres problèmes de santé mentale qui sont apparus dans la foulée de la pandémie. Nous avons enregistré notre appel Zoom en octobre 2021, et les pensées de la Dre Mudry exprimées à cette époque semblent prémonitoires.
« L’un des domaines où les psychologues du counseling vont jouer un rôle déterminant est celui de la reconstruction après la COVID. J’ai récemment participé à des travaux sur l’épuisement professionnel parmi les travailleurs des soins intensifs, et je crois que les besoins seront énormes. En Alberta, en particulier, et partout au Canada, nos professionnels de la santé sont exténués. Aussi les familles et les personnes qui ont de la difficulté à travailler de la maison, le manque d’interactions sociales, nos enfants ont de la difficulté à s’adapter au va-et-vient de la maison à l’école. Dans les prochaines années, les psychologues du counseling seront très occupés. »
En quoi la psychologie du counseling aidera-t-elle particulièrement à traiter l’épuisement professionnel et tous les autres problèmes qui sont apparus? La Dre Van Vliet répond ainsi à la question :
« Une partie de ce que nous faisons est de modifier le discours que les gens entretiennent dans leur esprit. Nous aidons à transformer ce discours en le faisant passer de “Qu’est-ce qui ne va pas chez moi?” à “Qu’est-ce qui va bien chez moi?” L’accent mis sur les forces, l’aspect positif de la psychologie du counseling, constitue une énorme richesse dans notre domaine. Je pense que cela a largement contribué à la manière dont les gens se perçoivent eux-mêmes, perçoivent les autres et perçoivent le monde. »
Très peu de gens, voire personne, ne savent ce que Syd Barrett a fait pendant les 35 dernières années de sa vie. À la fin des années 1970, Roger Waters l’a aperçu dans le grand magasin Harrods de Londres. Barrett a vu Waters, a laissé tomber ses sacs et est sorti du magasin en courant. C’était la dernière fois qu’un membre de Pink Floyd voyait son fondateur. Nous savons qu’il est devenu un jardinier passionné et qu’il s’est consacré à la peinture, mais c’est à peu près tout. Nous espérons qu’il s’en est bien sorti pendant les dernières années de sa vie et qu’il a pu surmonter certains de ses problèmes avec un professionnel qui aura pu l’aider à améliorer son sort. Un professionnel, comme un psychologue du counseling peut-être?

Dre Jenna Boyd

Dr. Rachel Langevin
Dre Jenna Boyd et Dre Rachel Langevin, Section du stress traumatique
Traumatic Stress shows itself in more than just PTSD, and can be caused by more than just major single events. Dr. Jenna Boyd and Dr. Rachel Langevin are working to help those affected by trauma, and working to learn more about traumatic stress as they do.
“In the 80s and early 90s, there was nothing known about the victims of child sexual abuse. Now, there are volumes of research on the subject.”
Dr. Rachel Langevin is an assistant professor of counselling psychology at McGill University, as well as a clinical psychologist who does a bit of private practice. She is currently the Chair-Elect of the CPA’s Traumatic Stress Section. She says her PhD advisor was one of the pioneers in researching the sexual abuse of children in Quebec and Canada. At the time she decided to work on this, it was a reality that many people didn’t even recognize existed. The first step had to be acknowledging, socially, that the sexual abuse of children DID exist, and that often it happened within families. It may seem difficult to imagine now, but it took a very long time for this kind of abuse to be recognized as real in the public at large.
“In the early 80s, some researchers in the States, like David Finkelhor, started trying to really understand child sexual abuse and the specific impact it had related to other traumatic experiences. One of the first to start working on it here in Quebec was Martine Hébert, who was my PhD advisor. Her advisor had been a specialist looking at perpetrators of sexual abuse, but not victims – and Dr. Hébert was the only one looking at that side. She did her research with a lot of autonomy, because no one else had that expertise!”
Today, child sexual abuse is one of the most-studied types of child maltreatment. Research into traumatic stress has come a long way in a short time. Dr. Jenna Boyd is a psychologist at an anxiety treatment and research clinic at St. Joseph’s Healthcare Hamilton, and an assistant professor in the department of psychiatry and behavioural neuroscience at McMaster University. She is the current Chair of the CPA’s Traumatic Stress Section, and specializes in the treatment of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).
“Cognitive Behavioural Therapy (CBT) is my main area of practice. A little more than 20 to 30 years ago, the main therapies that we’re using now were just emerging. From the perspective of treating PTSD, there was almost a thought that we couldn’t really treat it, but we could kind of help people cope with it. Today, we do have some really effective treatments.
Potentially traumatic experiences are pretty common. Over the course of their lives, most of us will be exposed to a traumatic event. It could be the death of someone close to us, a serious injury, sexual or intimate partner violence, or a frightening near-death experience. For some of us, it’s part of our jobs – a first responder or someone in the military could be exposed to a traumatic event more than once in a day. ‘Traumatic stress’ is what comes about as a reaction to that trauma.
It’s quite normal to have a stress-based reaction to a traumatic event or series of events. Most people who are exposed to one will have some kind of stress-response as a result. Many people will recover over time through a process of natural recovery, but others may go on to develop PTSD. This is where the symptoms related to the trauma persist over a longer period of time. Dr. Langevin says those symptoms can be multiple, complex, and varied.
“We encounter many different symptoms in this line of work. Re-experiencing symptoms, like nightmares, intrusive memories. Someone might be doing something and suddenly an image pops into their head causing distress. Every time they’re exposed to something that might resemble the trauma they endured, or something that makes them think about it, they will have a stress reaction, and anxiety will rise up. That might lead them to the second category of symptoms, which is avoidance. People start avoiding things that remind them of the trauma because it’s too stressful and uncomfortable.
The third big category of symptoms is a change in cognition, mood, and self-image. This includes things like self-blame, taking an overly large share of responsibility over what happened, feeling disconnected from others, or feeling no emotion whatsoever. And finally, there are arousal and reactivity symptoms. This is a more physiological response, and includes things like always being on your guard and looking over your shoulder, being very easily startled, difficulty sleeping, irritability, and possibly self-harm behaviours.”
When a clinical psychologist specializing in trauma sees someone who presents with a cluster of these symptoms, that persists for a month or longer after the traumatic event, and those symptoms are affecting that person’s life, that’s when they start talking about something like PTSD. At that point, it is no longer a normal reaction, and it requires attention. As Dr. Boyd says, there are now many ways that attention can be delivered.
“We now have Cognitive Processing Therapy, Prolonged Exposure Therapy, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) to name just a few. These treatments have had a lot of research supports behind them over the past 20 or 25 years. We now know they’re really effective for many people, and we have tools where we can say ‘let’s try this and see if we can get you to a place where you’re functioning better’. Many people can return to some of the things in their lives that have been taken away from them.”
Treatments are always improving, clinical psychologists are always innovating, and researchers are continually expanding our understanding of trauma, stress, and the interaction of the two. Dr. Langevin’s current research is looking into the intergenerational continuity of family violence, including child maltreatment and intimate partner violence.
“We know that a parent who was maltreated in their childhood is at increased risk of having a child that will also experience trauma and maltreatment – whether or not it’s at their own hands. Sometimes the mistreated parent becomes a perpetrator of abuse, and other times that doesn’t happen but the child still ends up being mistreated by someone else in the environment. There’s this continuity that we see in the data and in clinical practice, but the mechanisms that are responsible for this – the protective factors, the risk factors that are involved – are still trying to be understood. What makes one parent end up in a cycle where there is repetition of their own maltreatment history with their child, versus parents who are able to break those cycles? We’re looking to help parents who have been in this situation end the cycle, and foster resilience and positive adaptation in their children and themselves.”
Dr. Langevin is quick to point out that treating traumatic stress, and the problems that come along with it, go far beyond PTSD. She says,
“Everything can be associated with trauma, including behaviour problems, emotion regulation, depression, anxiety, bullying, difficulties with attachment and relationship. There are a host of different areas where we can see the consequences of traumatic events. PTSD is just one part of it, there’s a lot more. And we’ve come a long way in learning about it!”

Dr Andrew Hyounsoo Kim

Dr Nassim Tabri
Dr Andrew Hyounsoo Kim et Dr Nassim Tabri, Psychologie de la dépendance
La psychologie de la toxicomanie couvre de nombreux domaines, de la consommation de substances psychoactives jusqu’aux jeux vidéo. Le Mois de la psychologie met en vedette aujourd’hui le Dr Andrew Hyounsoo Kim et le Dr Nassim Tabri, qui parlent du travail qu’ils font dans le domaine des dépendances et de la lutte contre la stigmatisation qui entoure le sujet.
« Je n’ai jamais eu de client qui, à la question “Qu’est-ce qui vous amène ici?”, me réponde “Je voulais devenir accro, alors me voilà.” Ça ne m’est jamais arrivé. »
Andrew Hyounsoo Kim est professeur adjoint au département de psychologie de l’Université Ryerson et président de la Section de la psychologie des toxicomanies de la SCP. Psychologue clinicien (exercice autonome provisoire), le Dr Kim a fait sa résidence au Programme de traitement de la toxicomanie et des troubles concomitants du Royal. Il souligne que personne ne commence à consommer de la drogue ou de l’alcool ou à adopter un comportement donné avec une intensité telle que son fonctionnement en sera perturbé.
Presque tout le monde a déjà consommé de l’alcool et de la drogue. Rares sont les Canadiens qui n’ont jamais parié ni joué à un jeu vidéo en ligne. Certaines personnes finissent par s’adonner à ces activités de manière excessive ou à se livrer à ce genre de comportements plus souvent et plus longtemps que d’autres. Mais très peu de personnes développent une dépendance. Nous faisons tous le choix d’essayer certaines choses et nous pouvons choisir de continuer à les faire dans une certaine mesure – mais personne ne choisit de devenir dépendant.
La toxicomanie est l’un des problèmes de santé mentale les plus stigmatisés. Dans le but de remédier à cette situation et de susciter une plus grande compréhension de la part du public, un réel changement s’est opéré au cours de la dernière décennie pour abandonner le langage stigmatisant qui lui est associé. Les chercheurs et les cliniciens de ce domaine n’utilisent plus les mots « addiction » ou « abus », mais plutôt le terme « usage de substances psychoactives ».
« Nous n’utilisons plus le mot “drogué”, dit le Dr Kim. Nous disons plutôt “une personne qui souffre d’une dépendance”. Nous n’utilisons pas le mot “héroïnomane ou junkie”, et même l’expression “être clean” ne fait plus partie de notre vocabulaire car ces mots ont plutôt une connotation négative. »
En eux-mêmes, les mots « addiction, dépendance ou toxicomanie » sont largement utilisés – et mal utilisés – dans la société en général. Nous avons tendance à les utiliser pour décrire toute activité à laquelle les gens s’adonnent pendant une longue période de temps.
« Pensez à toutes les publicités qui disent par exemple : “Cette émission de télévision est vraiment addictive” ou “Je suis accro à ce jeu”. Les gens utilisent abondamment ces termes sans vraiment savoir ce qu’ils signifient. La dépendance a une signification très précise qui est beaucoup plus nuancée qu’une simple activité à laquelle une personne s’adonne pendant de longues périodes. Elle englobe non seulement le biologique (le cerveau), mais aussi le comportement, les émotions, les pensées et les conséquences qui en découlent. »
Outre le mauvais usage du mot, il subsiste de nombreuses idées fausses sur la dépendance elle-même, à savoir qu’il s’agit d’un échec moral ou d’un choix personnel, et que devenir dépendant est le signe d’un manque de caractère.
« Au tout début, lorsque vous commencez à vous livrer à un comportement de dépendance, c’est vous qui décidez de le faire, poursuit le Dr Kim. Mais avec le temps, le problème devient beaucoup plus complexe qu’un simple manque de volonté. Des changements se produisent dans le cerveau et dans le contexte émotionnel et psychosocial de la personne, et l’on passe d’un choix à une compulsion, c’est-à-dire que la personne s’y adonne même si cela ne lui procure plus de plaisir. S’il suffisait, pour arrêter, de se dire “arrête de consommer”, les psychologues cliniciens qui se spécialisent en toxicomanie ne travailleraient pas. Les dépendances, c’est beaucoup plus complexe que le simple fait d’arrêter. »
Le Dr Nassim Tabri est professeur adjoint de psychologie à l’Université Carleton. Ses recherches portent sur la toxicomanie et la santé mentale, en particulier les facteurs transdiagnostiques qui sont présents dans une gamme de comportements problématiques, comme le jeu et les troubles de l’alimentation.
« Pour comprendre ce qu’est une dépendance et comment une personne peut développer éventuellement une dépendance, il faut voir les choses de la manière suivante. Vous buvez de l’alcool pour la première fois, pour essayer, ou vous prenez un jeu vidéo et commencez à jouer. Cela ne signifie pas nécessairement que, parce que vous faites une chose qui a un fort potentiel addictif, vous développerez une dépendance. La dépendance s’installera si vous répétez le comportement même si vous n’en retirez plus de plaisir. Alors, vous devez répéter le comportement pour mieux fonctionner, et non plus pour le plaisir, et le fait de ne pas consommer ou vous adonner au comportement en question vous rend malheureux. »
La psychologie de la toxicomanie est une vaste discipline qui touche à pratiquement tous les aspects de nos vies connectées. Les publicités, les jeux, les téléphones, etc. sont conçus selon les principes de la science de la toxicomanie. Mais il existe un seuil défini de comportements qui constituent une dépendance. Ce n’est pas un seuil précis, car il peut être un peu différent chez chaque personne qui souffre de dépendance, mais le degré auquel l’activité, la consommation de la substance ou le comportement affectent la vie de cette personne est très élevé.
« La “dépendance” est un terme qui doit être réservé à une pathologie grave, souligne le Dr Tabri. Les publicités ou les jeux d’argent nous incitent, d’une certaine manière, à adopter un certain comportement. Le fait qu’une personne développe ou non une dépendance dépend en fait de son profil de risque (facteurs de risque biopsychosociaux). Le fait de se livrer modérément à ces activités, même si l’on est influencé, ne mérite pas le terme de “dépendance” ».
Je n’ai pas touché à mon téléphone depuis environ deux heures. Je le prends et je fais défiler les notifications – CBS Sports veut m’informer que les Broncos de Denver ont embauché le coordonnateur offensif de Green Bay, Nathaniel Hackett, comme nouvel entraîneur. L’appli Flipp voudrait que je voie les nouvelles aubaines disponibles cette semaine chez Loblaws. Mon petit jeu mobile veut que je sache qu’il m’a accordé des vies supplémentaires, Pharmaprix est très inquiète que je rate ma chance d’obtenir 10 000 points Optimum en dépensant 40 $ à son magasin et Twitter m’a envoyé huit notifications à propos de huit nouveaux abonnés que j’ai attirés aujourd’hui.
Bien que ces notifications ne concernent pas nécessairement le travail des psychologues spécialisés en toxicomanie, elles sont toutes influencées par la psychologie de la toxicomanie. Toutes sont conçues pour provoquer une réponse de ma part, pour me faire interagir avec l’appli, la boutique d’applis ou le contenu de manière à maximiser le temps que je passe sur mon téléphone et, par extension, à minimiser le temps que je passe à faire d’autres choses, vraisemblablement plus productives, mais moins intéressantes sur le moment. Bien que ces choses soient créées et étayées par la psychologie de la toxicomanie, le fait qu’elles m’influencent ne signifie pas que je suis « dépendant »; il y a un certain seuil à partir duquel on peut utiliser ce terme et si je ne me prive pas de sommeil, ne saute pas les repas et ne quitte pas le travail quatre heures plus tôt pour jouer à Words With Friends, je n’ai probablement pas dépassé ce seuil.
« Certains principes utilisés augmentent la probabilité de comportements addictifs sur les téléphones intelligents, ajoute le Dr Kim. Il s’agit de choses qui augmentent le temps passé sur l’appareil. Pour rendre l’appli plus attrayante, envoyer des notifications. Par exemple, avec les jeux vidéo en particulier, les tableaux des meneurs ou des messages comme “Voici une offre spéciale aujourd’hui – pour seulement 1,99 $, vous pouvez obtenir des vies supplémentaires”. Le jeu est un autre exemple : des connaissances et des principes psychologiques ont été utilisés pour développer les machines à sous, de sorte que les gens restent plus longtemps devant la machine. »
Bien que les principes psychologiques de la dépendance puissent être, et ont été utilisés pour engendrer des comportements addictifs qui entraînent parfois une dépendance, les psychologues qui se spécialisent dans ce domaine ont tendance à travailler sous l’angle opposé. Ils se concentrent sur la prévention et le traitement. Ils ont créé les Directives de consommation d’alcool à faible risque, les Lignes directrices sur les habitudes de jeu à moindre risque et les Recommandations pour l’usage du cannabis à moindre risque, les théories derrière le certificat Smart Serve Ontario et des initiatives de réduction des méfaits comme les sites d’injection supervisée. C’est là que les connaissances en psychologie sont directement appliquées pour réduire les méfaits que peuvent causer certaines de ces substances ou certains de ces comportements.
« La psychologie est l’étude scientifique de l’esprit et des comportements humains, ajoute le Dr Kim. En ce sens, la psychologie de la toxicomanie utilise des méthodes psychologiques scientifiquement fondées pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes consomment des substances psychoactives jusqu’à en devenir dépendantes, et d’autres, non. La psychologie essaie aussi de mieux comprendre les effets des substances et d’autres comportements addictifs sur le cerveau, et, ce que je trouve le plus intéressant, les façons de mettre au point des interventions, des traitements et des mesures de prévention de manière à réduire les préjudices et la souffrance subis par les personnes qui vivent ou ont vécu avec une dépendance. »
Lorsque nous entendons le mot « dépendance », nous avons tendance à l’associer à des substances plutôt qu’à des comportements. La cigarette, l’alcool, la crise des opiacés nous viennent à l’esprit lorsqu’il est question de dépendance, mais ces comportements addictifs sont-ils similaires, par exemple, à ceux associés aux jeux d’argent ou aux jeux vidéo? Selon le Dr Tabri, ce n’est pas nécessairement le cas.
« Une des choses sur lesquelles nous nous concentrons est le cerveau. Je donne un cours complet sur le système dopaminergique de la récompense. Il me semble que le grand public comprend que les comportements addictifs ont une influence similaire sur le cerveau car ils détournent le système dopaminergique de la récompense. Cela signifie que la personne qui a développé une dépendance ne s’adonne plus aux activités qui ont du sens pour elle et qui la font se sentir bien, mais qu’elle fait la seule et unique chose qui la fait se sentir vraiment bien, au détriment de toutes les autres choses qui composent sa vie.
Mais toutes les dépendances sont-elles identiques dans le cerveau? Pas nécessairement. À une certaine époque, la théorie la plus répandue était que tout est dû à la dopamine, qui est à la base de tout. Cela a commencé par des recherches sur les rats dans les années 1950, et l’histoire s’est imposée parce qu’elle était attrayante. L’idée que la dopamine peut expliquer toutes sortes de comportements addictifs s’est développée. Mais quand on regarde les publications, on constate que la dopamine est très utile pour expliquer les comportements liés à l’alcool, par exemple, ou à la nicotine dans une certaine mesure. Mais elle ne l’est pas tellement, lorsqu’il s’agit de la dépendance au cannabis, par exemple. La dopamine n’explique pas tout, et les choses sont plus nuancées et complexes. Elle joue probablement un rôle, mais elle n’est pas la clé de tout dans le cerveau. »
La science de la toxicomanie et la psychologie qui la sous-tend évoluent constamment à mesure que nous apprenons des choses nouvelles et que nous abordons celles-ci d’une manière différente. Tout comme nous avons modifié la terminologie utilisée relative à la santé mentale, à la consommation de substances et aux personnes qui souffrent de dépendance, nous avons mis en place de nombreux programmes, campagnes et initiatives pour réduire les risques et la stigmatisation. À travers tout cela, plusieurs choses restent vraies, la plus importante étant que « personne ne choisit la toxicomanie ».

Juanita Mureika

Dawn Hanson
Juanita Mureika et Dawn Hanson, Psychologues et la retraite
Même après la retraite, de nombreux psychologues poursuivent leurs activités professionnelles. Le Mois de la psychologie met en vedette aujourd’hui Juanita Mureika et Dawn Hanson, qui nous parlent de leur travail dans ce domaine.
Beaucoup de psychologues se lancent dans la profession dans un but de défense des intérêts – ceux de leurs clients, de l’avancement de la recherche en psychologie, de la mobilisation des connaissances et de la déstigmatisation entourant la santé mentale. Que la défense des intérêts soit une ambition explicite ou implicite, c’est un élan universel chez les personnes qui consacrent leur vie à aider les autres.
Cette motivation à être au service des autres ne prend pas fin une fois la carrière terminée. Prendre sa retraite après avoir exercé la profession de psychologue ne signifie pas nécessairement cesser de militer pour les grandes causes. En fait, la fin de la vie active pourrait donner plus de temps pour relever ce genre de défis, voire découvrir de nouvelles causes à défendre.
C’est le cas de Juanita Mureika et de Dawn Hanson, coprésidentes de la Section des psychologues et la retraite de la SCP. Juanita a pris sa retraite en 2011 après avoir exercé comme psychologue scolaire, mais elle demeure active dans l’arène politique du Nouveau-Brunswick. Elle a passé une grande partie de l’année 2021 à faire pression contre le projet de loi-35, dans le cadre duquel le gouvernement du Nouveau-Brunswick a l’intention de retirer les évaluations des élèves des mains des psychologues scolaires et de permettre aux enseignants d’effectuer ces évaluations à la place.
Dawn a pris récemment sa retraite de la présidence de la Manitoba Association of School Psychologists, mais elle reste active et impliquée dans le projet de loi-64 qui vient d’être proposé. Le projet de loi ferait disparaître tous les conseils scolaires, afin de centraliser l’administration scolaire à Winnipeg. « À la Manitoba Association of School Psychologists, nous sommes toujours à l’affût de tout ce qui pourrait avoir une incidence sur les services psychologiques au Manitoba, particulièrement en ce qui concerne les enfants d’âge scolaire et les familles, dit Dawn. Je ne peux pas imaginer – à la retraite ou non – ne pas être impliquée dans ces dossiers et ces questions brûlantes. Nous avons été très impliqués dans la création d’un nouvel ordre des psychologues au Manitoba. Nos psychologues scolaires ne faisaient pas encore partie de l’organisme de réglementation avant aujourd’hui. Ainsi, avec l’arrivée d’un nouvel ordre, nous travaillons pour que les psychologues scolaires puissent y être représentés, tâche que nous avons entreprise il y a plusieurs années. »
Pour Juanita, Dawn et la Section des psychologues et la retraite dans son ensemble, la représentation des intérêts ne cesse pas avec la retraite. Et la retraite elle-même ouvre en fait d’autres domaines où la défense des intérêts peut être très utile. Partout au Canada, les psychologues à la retraite sont très préoccupés par les règlements en vigueur dans leur province respective en ce qui concerne la durée de conservation des dossiers. Dans une province, les dossiers doivent être conservés en lieu sûr pendant 15 ans – mais si le client est un enfant d’âge scolaire, le dossier doit être conservé en lieu sûr pendant 15 ans après l’année où l’enfant atteint l’âge de la majorité. Selon Dawn, « il s’agit d’une tâche très lourde pour les psychologues qui doivent trouver un moyen de garder et de conserver ces dossiers en lieu sûr, parfois pendant des décennies! Juanita et moi avons exercé la plupart de nos activités dans le cadre scolaire, de sorte que, après avoir pris notre retraite, ce problème ne nous concernait plus. L’école doit garder ces dossiers en lieu sûr, conformément à ce qui est exigé par l’organisme de réglementation ou par la province. »
Ni Dawn ni Juanita ne sont concernées par ce problème, mais elles défendent néanmoins la cause. La Section des psychologues et la retraite a envoyé un sondage à tous les autres organismes de réglementation du Canada, y compris ceux des territoires, afin de déterminer quels étaient les problèmes en matière de confidentialité, de conservation des dossiers, de consentement éclairé, etc. Au moment d’écrire ces lignes, les réponses de ces groupes continuent de nous parvenir – lentement. Jusqu’à présent, la seule chose qui est claire, c’est que les règlements, les politiques et les pratiques régissant la conservation des dossiers varient énormément d’une province à l’autre.
Imaginez que vous fermez votre cabinet et que vous prenez votre retraite. En plus de détenir un grand nombre de fichiers électroniques, vous avez également des mètres et des mètres de dossiers papier que vous devez garder en sécurité pendant encore 15 ans. Il est probablement peu pratique et peu sûr, voire illégal, de garder tous ces documents dans votre sous-sol. Allez-vous payer pendant 15 ans un garde-meuble, à même votre revenu de retraite? Quelles sont vos options et comment pouvez-vous procéder? Et par qui seront assurés ces dossiers, selon l’endroit où ils sont stockés?
Dawn et Juanita sont sur l’affaire. Cela peut prendre un certain temps avant d’obtenir des réponses, car à chaque étape du processus, une nouvelle difficulté surgit. Comme le dit Juanita, « Une autre chose dont nous devons dorénavant tenir compte est le fait que de nombreuses provinces exigent un testament professionnel aux personnes qui projettent de prendre leur retraite. La conservation des dossiers deviendra donc le problème de quelqu’un d’autre si vous prenez votre retraite ou si vous mourez. Or ce ne sont pas toutes les provinces qui l’exigent. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Mais pensez aux dossiers médicaux ou dentaires; ils sont conservés pendant très longtemps et il devrait en être de même des dossiers psychologiques. C’est simplement un peu trop lourd pour les gens qui se demandent « combien de temps cela va-t-il durer? »
Juanita, Dawn et les membres de la Section des psychologues et la retraite sont peut-être à la retraite, mais ils sont de plus en plus impliqués dans la représentation des intérêts. Au sein des conseils scolaires, des politiques provinciales et de la section elle-même, il existe de multiples possibilités d’influencer les systèmes afin de les améliorer. Juanita et Dawn vont continuer de faire avancer les questions importantes – pour les retraités, pour les psychologues scolaires et pour tous les autres.

Dr Jonathan Wilbiks
Dr Jonathan Wilbiks , Cerveau et sciences cognitive
Les chercheurs du domaine des sciences du cerveau et des sciences cognitives s’intéressent à la façon dont le cerveau fonctionne et à la façon dont il perçoit et trie les stimuli externes. La rubrique du Mois de la psychologie d’aujourd’hui se penche sur ce sujet, avec le Dr Jonathan Wilbiks, qui nous parle de son travail – et de Snoop Dogg et Angela Hewitt.
« With so much drama in the LBC
It's kinda hard bein’ Snoop D-O-double-G. »
Vous assistez au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg et Kendrick Lamar sont sur scène, et vous vibrez au rythme de la musique. Sur le grand écran, vous pouvez voir Snoop faire du rap, et la musique frappe fort dans vos oreilles. La foule qui vous entoure hurle et applaudit. Vous êtes perdu dans le moment présent et vous ne vous demandez pas vraiment « comment savoir que tout cela est réel? Qu’est-ce qui me dit que c’est bien la voix de Snoop Dogg que j’entends? Comment puis-je être certain que le bruit de la foule autour de moi est fait par les autres supporters? » Vous n’avez pas à répondre à ces questions parce que votre cerveau rassemble les informations pour vous. Les lèvres de Snoop bougent sur le grand écran et semblent correspondre aux paroles que vous entendez. Le bruit de la foule vient de derrière, de devant et tout autour de vous, et votre cerveau fait le tri pour vous, de sorte que vous savez qu’il y a des milliers de personnes qui crient de milliers de façons, et vous n’avez pas besoin de prêter attention à une quelconque voix dans la foule.
La façon dont le cerveau exécute ces tâches est le domaine des sciences cognitives, qui est la spécialité de chercheurs comme le Dr Jonathan Wilbiks, professeur agrégé en psychologie à l’Université du Nouveau-Brunswick, Saint John. Le Dr Wilbiks est le président de la Section cerveau et science cognitive de la SCP et il étudie l’intégration audiovisuelle et le traitement multisensoriel – comment le cerveau reçoit diverses informations sensorielles et décide implicitement si ces choses proviennent de la même source. (Vos lèvres bougent et j’entends chanter – c’est probablement votre voix que j’entends.)
Dernièrement, certains des travaux du Dr Wilbiks ont porté sur la perception et les aptitudes musicales. Son équipe de chercheurs a constaté que les musiciens obtiennent de bien meilleurs résultats que les non-musiciens dans des tâches où le son et les images sont en concordance, c’est-à-dire que l’image correspond au son et se produit au même moment. Mais les musiciens sont moins performants que les non-musiciens lorsque le son et les images ne sont pas en concordance. Les personnes qui ont une formation en musique, plus que celles qui n’en ont pas, utilisent l’information auditive pour donner un sens à ce qu’elles voient.
Lorsque Angela Hewitt s’assoit devant son piano et place devant elle la partition des Variations Goldberg, tout est parfaitement logique. Chaque note qui figure sur la feuille représente une note qu’elle doit jouer au piano, et les deux choses concordent : elle a fait cela toute sa vie et c’est plus facile pour elle que pour… eh bien, tout le monde. Mais si, au lieu de la partition, on lui avait présenté une tablette cunéiforme représentant une notation musicale, il se peut qu’elle soit complètement perdue. En fait, quelqu’un qui ne sait pas du tout lire la musique pourrait être capable d’accomplir cette tâche mieux qu’elle. (Les plus anciennes notations musicales jamais découvertes datent d’environ 1 400 avant J.-C. et sont inscrites sur une tablette cunéiforme trouvée dans l’actuel Irak.)
Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le béhaviorisme était le courant le plus populaire en psychologie. Les chercheurs béhavioristes plaçaient un rat dans une boîte et l’exposaient à un stimulus, puis ils mesuraient les réactions du rat et la façon dont elles évoluent dans le temps avec une exposition répétée au même stimulus. Ils ne portaient pas vraiment attention à ce qui se passait réellement dans le cerveau. Selon le Dr Wilbiks, c’est parce que la science repose sur des faits observables, et qu’à l’époque, il n’y avait aucun moyen d’observer ce qui se passait dans le cerveau. Cela a commencé à changer à la fin des années 1960, lorsque le psychologue germano-américain Ulric Neisser a publié Cognitive Psychology, où il avançait que les processus mentaux d’un individu peuvent, en fait, être mesurés et analysés.
« Les chercheurs en sciences cognitives qui ont fait leur apparition dans les années 1960 ont dit “il se produit plein de choses dans le cerveau”, explique le Dr Wilbiks. Bien sûr, nous ne savons pas exactement ce qui s’y produit, mais il se produit quelque chose, et ce serait une erreur de ne pas en tenir compte. Ils ont donc essayé d’émettre des hypothèses sur ce qui se produit et de mesurer cela à l’aide d’observations secondaires. La tâche de temps de réaction en est un exemple simple. Je vous donne un bouton et vous demande d’appuyer dessus chaque fois qu’une lumière clignote sur l’écran devant vous. Les gens sont généralement assez rapides – leur temps de réaction est d’environ 200 millisecondes. Mais si je vous donne deux boutons et que je vous demande d’appuyer sur le bouton de gauche lorsque la lumière verte clignote et sur le bouton droit lorsque la lumière rouge clignote, il faudra plus de temps – peut-être 400 millisecondes. Nous ne pouvons pas voir ce qui se produit dans le cerveau, mais nous pouvons supposer que si la première tâche prend 200 millisecondes et la deuxième, 400 millisecondes, cela signifie très clairement que le traitement des informations dans le cerveau prend du temps. »
Avec le temps, bien sûr, les choses ont dépassé le stade de la lumière rouge et de la lumière verte lorsque les expériences sont devenues plus sophistiquées et que la technologie nous a permis de voir réellement ce qui se passe dans notre tête. Nous sommes capables de voir la tension électrique créée par les impulsions neurales dans le cerveau. Les appareils d’IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) permettent aux scientifiques d’observer et de mesurer les variations de l’oxygénation du sang qui indiquent des niveaux différents d’activité cérébrale. Nous pouvons désormais dire quelles zones du cerveau sont actives, quand elles le sont, et ensuite corréler cela avec les informations comportementales que nous recueillons.
Le domaine des sciences du cerveau et des sciences cognitives est vaste et a une incidence qui se manifeste dans notre vie quotidienne, et ce, de multiples façons. En ce moment, il se passe plein de choses autour de vous. Supposons que vous êtes assis sur une chaise. Il y a d’autres meubles dans la pièce, peut-être des décorations sur les murs. Il y a de la circulation à l’extérieur, le lave-vaisselle fonctionne peut-être en arrière-plan et quelqu’un regarde la télévision dans une autre pièce, tout cela pendant que vous lisez cet article. Il vous est impossible de prêter attention à tout en même temps, c’est pourquoi votre cerveau filtre tous ces stimuli externes avant même que vous ne les perceviez, pour éviter que vous ne soyez submergé.
Votre cerveau décide, pour vous, de ce qui est important. La circulation que vous entendez dehors? Vous pouvez l’ignorer parce qu’elle ne constitue pas une menace. Comme le dit le Dr Wilbiks, il est rare qu’une voiture percute une maison; ainsi, lorsque vous êtes assis dans votre maison, vous n’avez pas à faire attention au bruit des voitures. Mais lorsque vous marchez dans la rue, le bruit des voitures est très important pour vous – si vous entendez le bruit d’une voiture qui accélère au moment où vous vous engagez sur un passage pour piétons, vous devriez à l’évidence tourner la tête vers ce bruit pour voir ce qui se passe, car il existe maintenant une réelle possibilité de danger.
Le cerveau crée des raccourcis pour obtenir une efficacité maximale avec un minimum d’effort, et ce phénomène est appelé « économie cognitive ». Parce que nous utilisons de tels raccourcis, et que nous ne traitons que les informations les plus pertinentes et ne retenons que les indices les plus importants, nous sommes plus sensibles aux « incitations douces ». Ce sont de petites choses que les sciences cognitives ont créées pour nous inciter à nous comporter d’une certaine manière. Comme conduire plus prudemment. Le Dr Wilbiks en donne un exemple :
« Vous êtes sur la route au volant de votre voiture et vous savez que vous roulez dans une petite rue résidentielle. Vous savez que la limite de vitesse est de 40 km/h, vous conduisez donc plutôt lentement, et vous êtes attentif. Vous guettez s’il y a des enfants qui courent dans la rue, un chien en liberté, un ballon de basketball qui roule vers la route. Si vous roulez sur l’autoroute, vous portez attention à beaucoup d’autres choses, mais vous ne cherchez pas un ballon de basketball égaré. Nous pouvons utiliser la compréhension cognitive et les incitations douces dans une situation où, par exemple, les gens ont tendance à rouler trop vite dans une rue résidentielle. Nous pouvons faire des choses pour les faire ralentir. Vous verrez parfois de petits îlots, surmontés d’un arbre ou d’autre chose, qui rendent la route un peu plus étroite. Ces îlots ne gênent pas la circulation, mais le commun des mortels ne se sentirait pas à l’aise de passer dans cet espace étroit à une vitesse supérieure à 40 km/h. »
La seule chose sur laquelle mon cerveau se concentre, que je sois dans ma voiture ou en train de travailler sur mon ordinateur, c’est la musique. Partout où il y a de la musique, que ce soit en fond sonore ou dans le garage de mon voisin au bout de la rue, je ne peux pas l’ignorer. Le Dr Wilbiks dit que l’un des cours qu’il préfère donner est le cours de psychologie de la musique, car il englobe de nombreux aspects de la psychologie en général, et pas seulement des sciences cognitives.
« Je fais généralement peur aux étudiants lors des premiers cours, parce que nous commençons par la physique. La physique du son et des ondes sonores, et leur fonctionnement. Ensuite, nous abordons la façon dont les vibrations pénètrent dans l’oreille, comment elles se traduisent dans le cerveau et comment on les perçoit. Puis nous passons à la psychologie du développement – comment développer nos aptitudes musicales, le parallèle étroit entre développement musical et développement linguistique. Nous parlons de thérapie – il se fait des travaux très intéressants qui utilisent la musique (thérapie d’intonation mélodique) pour aider les personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral à retrouver certaines capacités linguistiques. »
Nous avons tous deux hémisphères dans notre cerveau, et il y a une zone dans l’hémisphère droit où nous traitons la musique. Il y a une région dans l’hémisphère gauche qui reproduit presque exactement la partie musicale, et c’est là que nous traitons le langage. Lorsque les personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral chantent les mots qu’elles essaient de prononcer, elles peuvent, avec le temps, entraîner l’autre hémisphère de leur cerveau pour qu’il traite à nouveau le langage. À la longue, elles pourraient retrouver jusqu’à 70 % à 80 % de leur capacité de parole. Les personnes atteintes de démence sont souvent capables de créer un lien avec la musique qu’elles ne peuvent pas établir avec le langage, car la musique peut déclencher des souvenirs qui seraient autrement inaccessibles.
Vous avez peut-être vu le mème qui circule et qui dit « my ability to remember song lyrics from the 80s far exceeds my ability to remember why I walked into the kitchen » (ma capacité à me souvenir des paroles de chansons des années 1980 dépasse de loin ma capacité à me rappeler pourquoi je suis en ce moment dans la cuisine) ». Cela pourrait bien être vrai, car la musique de notre jeunesse reste un puissant déclencheur de souvenirs. C’est pourquoi les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence chantent souvent ensemble des chansons de leur jeunesse – des chansons des Beatles et des Beach Boys et des chansons folkloriques traditionnelles du pays où elles ont grandi. Dans quelques années, les choses seront peut-être un peu différentes – en 2054, ces groupes de soutien pourraient chanter « Gin et Juice » de Snoop Dogg. Les chansons de rap produiront-elles le même genre de souvenirs et amélioreront-elles les capacités linguistiques de la même façon? Seul le temps le dira, mais lorsque nous aurons la réponse à cette question, elle nous sera fournie par des psychologues spécialisés en psychologie cognitive et d’autres spécialistes du domaine.

Dre Gilla Shapiro
Dre Gilla Shapiro, Psychologie de la santé et médecine du comportement
La psychologie de la santé et la médecine comportementale couvrent beaucoup de domaines, qu’il s’agisse d’encourager les personnes atteintes de diabète à prendre leur insuline ou d’inciter les gens à adopter des habitudes alimentaires plus saines. Le Mois de la psychologie met en vedette aujourd’hui la Dre Gilla Shapiro, qui parle du travail qu’elle fait dans le domaine du cancer et de la vaccination.
Psychologie de la santé et médecine du comportement
« Nous savons que le taux de vaccination varie selon le vaccin. Même avant la COVID-19, certains vaccins, comme le vaccin ROR (vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole), étaient beaucoup plus administrés que le vaccin contre la grippe. Il existe également des différences entre les vaccins destinés aux enfants et aux adolescents. C’est le cas du vaccin contre le VPH [papillome humain], qui est administré dans les écoles aux adolescents. »
Les psychologues de la santé et les scientifiques du comportement possèdent une expertise qui s’étend à une grande variété de spécialités et de disciplines. Plusieurs d’entre eux sont également des psychologues cliniciens agréés, autorisés à fournir des services et des traitements psychologiques. Les cliniciens spécialisés en psychologie de la santé aident les gens à surmonter leurs problèmes médicaux, leurs maladies et leurs maladies chroniques. Les spécialistes du comportement étudient tout cela, surtout lorsqu’il s’agit de comportements de prévention et de comportements qui peuvent avoir une incidence sur l’évolution d’un diagnostic médical. Qu’est-ce qui aide une personne atteinte d’une maladie cardiaque à suivre un régime alimentaire strict? Qu’est-ce qui influence la constance avec laquelle un diabétique administre son insuline? Et – point très important ces derniers temps – quels facteurs influencent le consentement et la volonté d’une personne à se faire vacciner?
Imaginez que vous venez tout juste de recevoir un diagnostic de cancer. Des centaines de questions surgissent probablement dans votre esprit et encore plus de craintes vous assaillent soudainement. D’autres facteurs peuvent aussi ajouter à ce stress, comme la possibilité de devenir infertile, la perte de revenu possible ou la nécessité de faire garder les enfants pendant le traitement. Il se peut également que vous soyez désormais entouré de toute une série de nouveaux médecins et spécialistes que vous n’aviez jamais rencontrés auparavant – oncologues, infirmières en oncologie, intervenants-pivots, consultants en génétique. Cela fait beaucoup de choses à gérer, outre le fait d’avoir à accepter le diagnostic lui-même.
L’une des personnes qui pourrait vous aider à traverser cette période difficile est un psychologue, comme la Dre Gilla Shapiro, au Princess Margaret Cancer Centre de Toronto. La Dre Shapiro est une psychologue clinicienne spécialisée en psychologie de la santé et une psycho-oncologue (une spécialiste du cancer). Elle travaille avec des personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer, avec celles qui suivent un traitement et avec les personnes qui reçoivent des soins de fin de vie.
« De nombreuses personnes éprouvent une détresse élevée [liée au cancer et à son traitement]. Il est donc très important de disposer d’une équipe de traitement spécialisée pour les soutenir, ainsi que leurs proches. »
Une partie de l’aide offerte prend la forme de thérapies de soutien, et une autre partie est liée à la prise de décision. Si une personne atteinte d’un cancer doit prendre la décision de commencer ou non un traitement de chimiothérapie, compte tenu des effets dévastateurs de ce traitement sur l’organisme et du pourcentage de chances qu’il a de fonctionner, le fait d’en parler peut beaucoup aider. La décision de participer ou non à un essai clinique peut être un choix très difficile à faire pour une personne atteinte d’un cancer. Un psychologue, comme la Dre Shapiro, appréhende cela de plusieurs façons :
« Les gens ont besoin de soutien de différentes manières et ont des inquiétudes différentes, qui peuvent être d’ordre social, pratique, psychologique ou émotionnel. Certains se demanderont comment aborder le cancer avec leurs enfants. D’autres auront besoin de soutien pour traiter leurs symptômes comme la douleur, l’insomnie, l’anxiété ou la dépression. Certains types de cancer sont associés à une prédisposition génétique. Ainsi, si un test génétique est effectué, certaines personnes se demanderont à qui elles devraient le dire, et comment le dire. »
Au Princess Margaret Centre, une équipe travaille à l’élaboration d’interventions fondées sur des données probantes pour réduire la détresse et améliorer les conditions de vie des patients atteints de cancer. Par exemple, une intervention appelée « thérapie CALM » (Managing Cancer And Living Meaningfully) est conçue pour aider les patients à s’adapter à la vie à un stade avancé du cancer. Elle s’inspire de théories en psychologie et en santé mentale – théorie relationnelle, théorie de l’attachement et théorie existentielle – l’objectif étant d’aborder une gamme de problèmes de manière individualisée. La prise en charge des symptômes, les changements dans la relation du patient avec lui-même et avec ses proches, le sens de la vie et la finalité de l’existence, les espoirs et les préoccupations relatifs à l’avenir sont autant de facteurs pris en compte dans la thérapie CALM et sont tous vécus différemment par chaque personne qui reçoit un diagnostic de cancer en phase terminale.
Si la Dre Shapiro a décidé de travailler au Princess Margaret Cancer Centre, c’est en partie parce son superviseur, le Dr Gary Rodin, et Sarah Hales, une collège de ce dernier, est la personne qui a élaboré la thérapie CALM. Le Dr Rodin et sa collègue, la Dre Madeline Li, ont également fait des travaux intéressants pour comprendre les facteurs qui influencent les individus lorsqu’ils ont à prendre des décisions difficiles en lien avec leur santé. L’aide médicale à mourir, ou AMM, apparue très récemment, est une décision importante dans le domaine de la cancérologie. La Dre Shapiro voulait apporter à ce travail la dimension de l’équité en santé et l’optique des politiques en matière de santé. Mais ce n’est pas là que la Dre Shapiro a commencé ses travaux en psycho-oncologie et en sciences du comportement; elle a commencé à travailler en psycho-oncologie dans le domaine de la prévention du cancer et de la vaccination. Elle s’intéressait notamment aux vaccins, comme le vaccin contre le VPH, et à la façon de prévenir les virus qui causent le cancer du col de l’utérus et d’autres cancers en aidant les personnes à faire des choix comportementaux, comme se faire vacciner.
Moins de deux ans avant que la COVID-19 ne soit qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Dre Shapiro a fait son doctorat sur l’hésitation à l’égard du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) chez les parents canadiens. Avec ses collègues de l’Université McGill, elle a mis au point des échelles pour mesurer les attitudes à l’égard des vaccins et a mené des recherches pour comprendre les facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination dans la population canadienne.
En 2019, elle a commencé à travailler avec l’OMS à l’élaboration d’outils de vaccination infantile systématique et à mesurer les facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination à l’échelle mondiale. Lorsque la pandémie a frappé, ce travail a ensuite permis de comprendre l’acceptation des vaccins par les adultes et leur intention de se faire vacciner contre la COVID, lorsque le vaccin serait offert.
Pendant la pandémie de COVID-19, la Dre Shapiro faisait partie du groupe de travail sur les sciences du comportement et la lutte contre la COVID-19 de l’Ontario; de concert avec ses collègues du groupe de travail (dont plusieurs sont également des membres de la Section de psychologie de la santé et de médecine comportementale de la SCP), elle a publié en octobre un document intitulé « Behavioural Science-Informed Strategies for Increasing COVID-19 Vaccine Uptake in Children and Youth » [LIEN].
Tout en étudiant les facteurs comportementaux et sociaux qui ont une incidence sur l’acceptation des vaccins contre la COVID-19, elle a également commencé à s’intéresser à un effet domino de la pandémie, à savoir les vaccinations systématiques manquées ou retardées. La Dre Shapiro et ses collègues de l’OMS et d’autres pays viennent de terminer une étude sur l’omission des vaccins à administrer dans le cadre de la vaccination systématique des enfants dans 26 pays pendant la pandémie [LIEN - COVID-19 and missed or delayed vaccination in 26 middle- and high-income countries: An observational survey].
Imaginez que vous ayez reçu un diagnostic de cancer, que vous ayez été opérée et ayez subi une radiothérapie, et que vous soyez maintenant sortie de tout cela avec un bilan de santé (relativement) positif. Un psychologue clinicien de la santé vous a peut-être aidé tout au long du processus, mais maintenant une autre menace existentielle, hors de votre contrôle, apparaît : une pandémie mondiale. Étant immunodéprimée, votre santé dépend de la vaccination de votre entourage contre le virus. Ce n’est pas une situation facile, mais il est rassurant de savoir que des psychologues de la santé et des scientifiques du comportement comme la Dre Shapiro y sont attentifs.

Ann Marie Beals

Dre Natalie Kivell

Ramy Barhouhe
Ann Marie Beals, Dre Natalie Kivell, et Ramy Barhouhe, Psychologie communautaire
La psychologie communautaire concerne davantage l’aspect « communautaire » que l’aspect « psychologique » et est très impliquée dans les questions de justice sociale. Le Mois de la psychologie met en vedette aujourd’hui Ann Marie Beals, la Dre Natalie Kivell et Ramy Barhouhe, qui nous parlent de leur travail dans ce domaine.
« Les personnes impliquées dans la transformation sociale au sein de leur collectivité – organisateurs communautaires, responsables des mouvements populaires – s’appuient sur des théories aussi rigoureuses sur le fonctionnement du changement que celles que l’on trouve dans le monde universitaire. »
La Dre Natalie Kivell est professeure adjointe au programme de psychologie communautaire de l’Université Wilfrid Laurier. « Il y a très peu de programmes de psychologie communautaire dans les universités canadiennes, dit-elle, et les personnes qui travaillent dans le domaine tendent à être beaucoup plus impliquées dans le volet “communautaire” que dans le volet “psychologique” de leur travail. »
Ann Marie Beals est l’une de ces personnes. Ann Marie est une étudiante de deuxième cycle au programme de psychologie communautaire de l’Université Wilfrid Laurier. Elle est Micmaque – de descendance afro-néo-écossaise et micmaque – et elle s’intéresse à l’effacement des communautés métisses afro-autochtones, hier et aujourd’hui, à la vérité et la réconciliation et à l’actuelle marginalisation des nations autochtones et des communautés noires du Canada.
Ramy Barhouhe, un autre étudiant de Natalie, est originaire du Liban et vivait aux États-Unis avant de venir à l’Université Wilfrid Laurier pour étudier au programme de doctorat en psychologie communautaire. Dans le cadre de ses études, il s’intéresse au colonialisme et à la colonisation. Il cherche à savoir, d’une part, comment les structures coloniales ont façonné le développement de systèmes communautaires entiers en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Ouest, et d’autre part, comment cela oriente la façon dont les gens perçoivent, ressentent et expérimentent le monde sur le plan du temps, de l’espace, de la moralité, du pouvoir, de l’éducation, de la santé, de la justice, de la politique, de l’économie et plus encore.
Ramy, Ann Marie et Natalie sont venus à la psychologie communautaire par des chemins très différents, mais ils ont tous des vues similaires dans la mesure où ils placent tous la « communauté » avant la « psychologie ». Ils sont tous les trois très investis dans le démantèlement des systèmes actuels et très conscients qu’ils travaillent eux-mêmes dans certains de ces systèmes. Ramy étudie les moyens d’opérer la décolonisation dans le milieu universitaire, lui-même un vestige structurel des pratiques coloniales. Ann Marie est membre de la SCP et est la trésorière de la Section de la psychologie communautaire de la SCP, deux institutions qui sont façonnées par l’héritage du colonialisme. Natalie est professeure de psychologie, un domaine d’étude qui a longtemps été complice non seulement du colonialisme, mais aussi de la marginalisation des populations minoritaires.
Selon Ramy, « le monde universitaire est tellement imbriqué dans le système capitaliste néolibéral qu’il est très difficile de l’en détacher. L’écart de pouvoir entre les personnes qui contrôlent le flux de connaissances et celles qui ne le contrôlent pas est trop grand. Prenons l’exemple d’un universitaire qui reçoit une subvention pour faire des recherches, qui fait appel ensuite à une communauté pour obtenir des informations de celle-ci. Mais il n’a pas à obtenir l’approbation de cette communauté par la suite en ce qui concerne la diffusion et la mobilisation des connaissances. Il obtient le mérite, la reconnaissance et le financement, mais la communauté elle-même n’en retire rien. Elle ne fait qu’appuyer et aider l’université. Il s’agit donc d’un problème lié à la structure du colonialisme au sein de l’université dont nous devons encore parler et que nous devons surmonter.
Nous en parlons beaucoup dans notre programme et nous reconnaissons que nous faisons également partie du problème. Si nous effectuons cette recherche, nous ne sommes pas pour autant dégagés de la structure et de l’impact qu’elle a sur la communauté; nous faisons toujours partie du problème. Nous essayons de trouver une façon de reconcevoir cela, et cela exige une certaine dose de respect et d’humilité envers la communauté dans laquelle nous travaillons. Il faut s’assurer qu’elle obtient sa juste part et le respect qui lui est dû, et même des fonds, qui lui serviront à répondre à ses besoins. C’est là que la transformation s’impose : comment utiliser les ressources qui font malheureusement partie d’un système corrompu pour en faire bénéficier ces communautés? Et comment utiliser leurs connaissances comme étant les leurs, et non comme étant les miennes, simplement parce que j’ai fait une enquête dans la collectivité. »
Ann Marie considère la situation actuelle, influencée par la pandémie de COVID-19, comme une fenêtre ouverte sur le travail qui doit être fait. « La pandémie a révélé à quel point les politiques et les pratiques d’austérité néolibérale ont affecté nos systèmes de soins de santé et comment les travailleurs précaires touchant le salaire minimum ou occupant des emplois peu rémunérés – principalement des femmes noires, des personnes racisées, des nouveaux arrivants et des Autochtones – sont touchés de manière disproportionnée par le manque de compassion, de soins et de filets de sécurité adéquats, qui ont été démantelés par les gouvernements néolibéraux.
À titre d’exemple, l’actuel gouvernement de l’Ontario, dans le contexte d’un régime capitaliste, a adopté une loi limitant les augmentations de salaire à 1 % pour les travailleurs du secteur public comme les travailleurs de la santé, car l’inflation dépasse les 4 % [4,1 % en août 2021]. Dans notre programme de psychologie communautaire, nous comptons des étudiants et des chercheurs universitaires issus et résidents de communautés directement touchées par les pratiques néolibérales et coloniales, comme celle-ci, qui continuent à creuser les écarts en matière de soins de santé et de stabilité économique. En même temps, les droits fondamentaux de la personne, comme le logement, l’éducation, l’eau potable et la qualité de vie ne sont pas seulement bafoués, ils sont délibérément ignorés. En tant qu’étudiante chercheuse, j’examine, avec d’autres psychologues communautaires critiques, l’intersection entre les structures de pouvoir, comme la suprématie blanche, le colonialisme, le néolibéralisme et le patriarcat, et les êtres humains et la Terre mère à partir d’une infinité d’identités interconnectées.
Nous examinons ces structures de pouvoir, au travers du contrôle des ressources situées sur les terres autochtones volées, du racisme anti-Noirs et des politiques colonisatrices. Et j’entends par là les personnes qui soutiennent et maintiennent ces structures de pouvoir. Parfois, nous parlons des structures de pouvoir de manière abstraite ou théorique, mais nous devons être conscients du fait que les gens soutiennent et maintiennent ces structures. Ils essaient de dicter notre mode de vie et oppriment systématiquement toute personne qui ne correspond pas à la conception de ce qu’est un “Canadien”, à savoir un homme blanc cisgenre hétérosexuel et non handicapé. Pour moi, cela revient toujours à démanteler les structures de pouvoir qui oppriment les gens dans ma communauté. »
Il existe plusieurs mots qu’Ann Marie, Ramy et Natalie utilisent assez souvent : intersection, démantèlement, néolibéral, colonialisme. Un autre mot qu’ils utilisent tous, peut-être encore plus souvent, est celui de « collaboration ». Ramy parle de collaboration avec les communautés, de sorte que le travail qui y est effectué ne vise pas à extraire, mais plutôt à améliorer les connaissances, la santé et la réussite de cette communauté. Ann Marie parle de collaboration, dans le sens où le mérite du travail accompli n’est pas seulement l’objectif final, mais est contraire au processus d’autodétermination des collectivités. Natalie parle de dizaines d’autres organismes communautaires, militants locaux et disciplines scientifiques avec lesquels elle travaille pour faire avancer les innombrables causes de la justice sociale. En fait, le tout premier mot qu’elle utilise pour décrire la psychologie communautaire est « interdisciplinaire ».
« La psychologie communautaire est une science sociale interdisciplinaire, axée sur les valeurs et sur l’action et engagée dans la communauté. Elle s’intéresse à la justice sociale à l’intersection de la justice raciale, climatique, migratoire, sexuelle, carcérale ainsi que la justice pour les personnes handicapées. Nous travaillons à l’intersection des questions complexes de justice sociale qui se touchent de manière interconnectée. La psychologie communautaire est guidée par un ensemble de théories. Nous abordons ces questions sociales complexes à partir de lieux de prévention, de la théorie écologique, de perspectives critiques et de perspectives de décolonisation. Nous cherchons à situer les relations entre les individus, les communautés et les sociétés. Lorsque nos communautés sont justes et équitables, les personnes qui les habitent sont en meilleure santé. La psychologie communautaire a donc comme objectif de trouver des moyens de reconstruire, reconcevoir et créer collectivement des systèmes scolaires, des systèmes de santé, des systèmes pénitentiaires équitables, etc. ».
Puisque la psychologie communautaire s’attaque à un aussi vaste éventail de systèmes et de structures, le travail des psychologues communautaires transcende de nombreuses frontières et touche à d’autres aspects de la psychologie – justice pénale, environnement, éducation, etc. Bien qu’ils soient peu nombreux, leur collaboration avec les disciplines, les sciences, les groupes communautaires et les organisations militantes leur permet d’avoir un impact considérable.

Dre Milica Miočević

Dr Rob Cribbie
Dre Milica Miočević et Dr Rob Cribbie, Méthodes quantitatives
Méthodes quantitatives est une science qui fonctionne avec presque toutes les branches de la psychologie. Tous les chercheurs utilisent des méthodes différentes pour analyser les données, mais tous les chercheurs analysent les données. Dans le cadre du Mois de la psychologie d’aujourd’hui, le Dr Milica Miočević et le Dr Rob Cribbie discutent du travail qu’ils font pour rendre la collecte et l’analyse des données plus faciles, plus cohérentes et plus précises.
Dans le vaste domaine de la psychologie, les méthodes quantitatives, c’est comme la radio étudiante indé de l’université. Celle qui faisait jouer U2 et R.E.M. dans les années 1980 avant que « Sunday Bloody Sunday » et « Man on the Moon » jouent partout. Celle qui a « découvert » les Red Hot Chili Peppers au début des années 1990 avant Blood Sugar Sex Magic et les Grammys. Ou qui, il n’y a pas longtemps, a révélé les Black Eyed Peas avant l’arrivée de Fergie et leur succès commercial.
Les méthodes quantitatives, c’est l’ado avec un piercing dans le nez et une chemise à carreaux qui s’intéressait à la modélisation par équation structurelle, aux statistiques bayésiennes ou à la modélisation linéaire hiérarchique avant que ce soit branché. Celui qui a passé des mois dans sa chambre, à éplucher le catalogue, à apprendre toutes les facettes de cette méthode statistique, avant de l’abandonner et de l’envoyer dans le monde pour qu’elle soit utilisée par les chercheurs en psychologie. La plupart de ces méthodes ont été étudiées en profondeur par un très petit groupe de psychologues spécialisés en méthodes quantitatives à une certaine époque, mais sont aujourd’hui largement utilisées à la grandeur de la discipline.
Elles sont également, d’une certaine façon, le Rick Rubin de la psychologie. Vous savez comment les Red Hot Chili Peppers ont connu le succès avec Blood Sugar Sex Magic? C’est grâce au producteur Rick Rubin. Reign, le chef-d’œuvre de Slayer, 21, d’Adèle, Licensed to Ill, qui a fait connaître les Beastie Boys? Rick Rubin. Et pour les chercheurs en psychologie qui font un travail poussé – que ce soit sur la dépression, la confiance en la vaccination ou l’ESPT chez les couples de militaires –, le producteur qui travaille en coulisses pour assurer la rigueur scientifique, ce sont les méthodes quantitatives. Les psychologues spécialisés en méthodes quantitatives aident ces chercheurs à élaborer leurs études afin de déterminer la meilleure façon de recueillir les données, de tenir compte des éventuels accrocs et de définir la taille de l’échantillon nécessaire pour détecter les effets pertinents.
Le Dr Rob Cribbie est le président de la Section des méthodes quantitatives de la SCP et un psychologue spécialisé en méthodes quantitatives au département de psychologie de l’Université York.
« Les méthodes quantitatives s’intéressent aux méthodes de recherche et à l’analyse de données. Les personnes qui travaillent dans le domaine des méthodes quantitatives font tout, qu’il s’agisse de conseils sur la taille des échantillons, les plans de recherche et l’analyse des données, ou de la recherche de méthodes nouvelles ou améliorées d’analyse de données. Nous étudions également les aspects psychométriques des outils que nous utilisons et leur efficacité. », dit-il.
À quoi ressemble ce genre de travail au quotidien? Que fait exactement un psychologue spécialisé en méthodes quantitatives? La Dre Milica Miočević est la secrétaire-trésorière de la Section des méthodes quantitatives de la SCP et une psychologue spécialisée en méthodes quantitatives au département de psychologie de l’Université McGill. Elle donne un exemple de son travail :
« J’ai récemment publié un article avec un coauteur spécialisé en biostatistique sur la puissance statistique avant la répartition. Nous essayions de trouver un moyen d’utiliser les données historiques d’une étude liée à une étude en cours, mais réalisée à l’aide d’un échantillon provenant d’une population légèrement différente. Nous cherchions des façons de quantifier les différences entre les participants à l’étude précédente et les participants à l’étude en cours, et nous avons évalué si l’utilisation de notre méthode avec les données de l’étude précédente pouvait améliorer les inférences de l’étude en cours. L’article que nous avons publié permettra aux chercheurs en psychologie de
s’appuyer sur des données historiques pour améliorer les inférences statistiques des nouvelles études de recherche sans exiger des tailles d’échantillon excessivement grandes ».
Le champ lui-même est, d’une certaine manière, assez nouveau. La Section des méthodes quantitatives de la SCP célèbre son dixième anniversaire cette année, et la discipline, bien que largement reconnue aujourd’hui, était bien moins connue il y a 10 ou 20 ans.
« Je me souviens quand je menais des entretiens d’embauche, autour de l’année 2000, la plupart des personnes interviewées me demandaient « Dans quel domaine de la psychologie êtes-vous? » Et je répondais « les méthodes quantitatives », et elles disaient « Non, je veux dire, est-ce la dépression, la psychologie clinique, la psychologie culturelle, qu’étudiez-vous au juste? » Et je disais « Eh bien… les méthodes quantitatives ». Elles ne voyaient pas cela comme une discipline. Il y a eu un véritable changement depuis. Il est maintenant totalement courant de dire ‘Je suis chercheur en psychologie quantitative’. Le domaine des méthodes quantitatives est si vaste aujourd’hui, et nous utilisons tellement d’outils qu’il nous faut vraiment des gens qui se spécialisent dans les différentes méthodes », explique le Dr Cribbie.
La croissance de ce domaine a entraîné une évolution des méthodes d’analyse et d’interprétation des données par les psychologues. L’avènement de logiciels comme R et d’autres logiciels ont ouvert un monde de possibilités qui étaient beaucoup plus laborieuses, voire inaccessibles, il y a 20 ou 25 ans. Et ce monde est en constante évolution. Lorsqu’une nouvelle méthode devient populaire et se répand dans le monde de la psychologie, les psychologues spécialistes des méthodes quantitatives sont déjà passés à autre chose.
« Nous passons par des périodes où nous voyons ce qui est intéressant et ce qui doit être développé davantage. Quand je faisais mes études supérieures, les méthodes bayésiennes commençaient à faire parler d’elles. Aujourd’hui, il semble que ce soit l’apprentissage automatique, et nous attendons de voir ce qui viendra ensuite. J’ai l’impression que d’année en année, nous ajoutons quelque chose de nouveau à la boîte à outils des méthodes quantitatives en psychologie. Parfois, les approches nouvelles proviennent des statistiques, et parfois, d’autres domaines, comme l’économie. J’ai observé beaucoup de changements en 10 ans! », ajoute la Dre Miočević.
Vous connaissez les excellentes chansons de Taylor Swift, Dido, Alicia Keys ou Imagine Dragons? Celles avec un rapper invité? Ce rapper invité, c’est Kendrick Lamar. Les méthodes quantitatives sont, d’une certaine manière, le Kendrick Lamar de la psychologie, même si elles n’auront probablement jamais la même reconnaissance en solo que celle qu’il a obtenue lorsqu’il a remporté le prix Pulitzer. Elles collaborent avec n’importe qui, dans n’importe quelle discipline, à n’importe quel moment, à tel point qu’au bout d’un moment, on remarque à peine leur présence. Chaque facette de la psychologie, chaque discipline, se nourrit des derniers outils d’analyse de données, des méthodes et pratiques de recherche les plus à jour et de la rigueur scientifique que fournissent les méthodes quantitatives.
Pour le Dr Cribbie, « les méthodes quantitatives englobent tous les domaines de la discipline. Ainsi, si vous survoliez chaque section de la SCP, vous découvririez que la Section des méthodes quantitatives joue un rôle dans chacune d’elles. C’est formidable que cette section permette aux personnes intéressées de discuter de méthodes nouvelles et différentes, et de la façon dont les gens les appliquent. »
C’est pour cette raison que le Mois de la psychologie de 2022 commence par la Section des méthodes quantitatives – c’est la seule section qui alimente toutes les autres sections. Le Dr Cribbie, la Dre Miočević et leurs collègues sont les enfants cool du quartier, qui se donnaient à fond dans cette méthode de recherche bien avant que vous n’en entendiez parler. Vous pouvez suivre la Section des méthodes quantitatives sur Twitter, avec le mot-clic @cpa_qm, sur son site Web https://canadianquantpsych.wordpress.com/ ou par l’entremise de son bulletin https://cpa.ca/fr/sections/quantitativemethods/newsletter/. Vous pourrez ainsi, vous aussi, être un enfant cool, qui sait tout avant tout le monde!

Dre Elena Antoniadis

Dr Steve Joordens
Dre Elena Antoniadis, Dre Elizabeth Bowering, et Dr Steve Joordens, Enseignement de la psychologie
L’enseignement de la psychologie est une science où tout ne se passe jamais exactement de la même manière. Les groupes et les contextes d’enseignement influencent tous l’apprentissage, et ce, de multiples façons. Le Mois de la psychologie met en vedette aujourd’hui la Dre Elena Antoniadis, la Dre Elizabeth Bowering et le Dr Steve Joorden, qui nous parlent de leur travail.
Enseignement de la psychologie
Le Dr Steve Joorsens, professeur de psychologie à l’Université de Toronto, utilise une analogie pour expliquer ce qu’est l’enseignement de la psychologie :
« Je vois l’enseignement comme un art. Comme de la bière artisanale – si vous voulez être un bon brasseur, qui produit une bonne bière, vous devez connaître les éléments scientifiques des recettes et la façon de les combiner. Il y a aussi un élément subjectif. Le mélange d’ingrédients qui vous convient vraiment peut, pour une raison ou une autre, ne pas convenir à quelqu’un d’autre. Ainsi, il y a un mélange de connaissances scientifiques – les ingrédients qui pourraient constituer une expérience pédagogique marquante – mais ensuite, le professeur lui-même doit trouver ce qui lui convient, et ce qui convient à sa classe et au contexte dans lequel il enseigne. C’est là que l’art entre en jeu, fusionnant les éléments scientifiques avec l’humain pour créer une expérience pédagogique exceptionnelle pour les étudiants. »
Le brasseur Whiprsnapr Brewing Company, de Bells Corners, en Ontario, a créé une bière artisanale appelée OK Lah. Il s’agit d’une Cream ale d’inspiration sud-asiatique fabriquée avec de la coriandre et du gingembre. Elle n’est certainement pas à la portée de tous les palais, et quand j’en ai envoyé à ma sœur, elle est restée dans son garage pendant deux ans, car elle était considérée comme « la bière dont personne ne veut ». Cela dit, elle demeure l’une des plus vendues année après année. C’est une formule qui a fait ses preuves et qui convient à beaucoup de personnes, mais pas à la plupart des gens. Comme c’est le cas de l’enseignement de la psychologie, l’inspiration peut venir de n’importe où, mais la mise au point de la formule gagnante dépend de l’individu.
La Dre Elena Antoniadis est membre du corps professoral de la Red Deer Polytechnic en Alberta et est également membre du corps professoral de l’Université de Calgary. Elle est la présidente de la Section de l’enseignement de la psychologie de la SCP et fait de la recherche sur les façons d’intégrer les applications des neurosciences fondamentales à l’enseignement afin de soutenir et de faciliter l’apprentissage des étudiants des cycles supérieurs.
« La pédagogie de l’enseignement de la psychologie est un champ de formation et de recherche qui s’intéresse aux approches fondées sur la recherche qui permettent d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage en classe, explique-t-elle. Certaines de ces recherches proviennent de laboratoires qui font des études en sciences cognitives qui enrichiront nos façons d’enseigner. D’autres formes de recherche se font directement en salle de classe. Nous recueillons des données en classe, et ces données peuvent orienter nos pratiques pédagogiques, l’objectif étant de concevoir et de dispenser efficacement des programmes d’enseignement supérieur en utilisant ces études fondées sur la recherche afin d’enrichir la théorie et la pratique pédagogique. »
En 2016, la brasserie artisanale Beau’s de Vankleek Hill, en Ontario, a fait de chacun de ses employés un copropriétaire de l’entreprise. En 2011, elle s’était associée à un organisme communautaire local appelé Operation Come Home afin d’embaucher de jeunes sans-abri pour livrer sa bière. Non seulement elle a une place dans la collectivité qui achète sa bière, mais elle fait participer la collectivité à chaque étape du processus, ce qui lui a valu un énorme succès local. Ce genre d’approche influence une grande partie de l’enseignement de la psychologie, et la participation communautaire qu’elle implique est appelée « apprentissage par le service communautaire ».
La Dre Elizabeth Bowering est professeure de psychologie à l’Université Mount St Vincent et présidente de la Section de l’enseignement de la psychologie. Elle donne une gamme de cours, comme l’introduction à la psychologie, et des cours de perfectionnement. Certaines de ses recherches portent sur l’apprentissage par le service communautaire.
« Dans mon cours sur le développement de l’adolescent, je demande à mes étudiants d’effectuer des activités d’apprentissage par le service communautaire, dit-elle. Ils travaillent donc avec des jeunes qui présentent un risque de décrochage au secondaire. Ils travaillent avec eux, en leur offrant du soutien scolaire et en les encadrant, afin de les encourager dans leurs propres études. Nous essayons de multiples façons d’élargir le processus d’enseignement et d’apprentissage, non seulement pour les personnes qui sont déjà aux études, mais aussi pour les autres. »
La Church Brewing Company de Wolfville, qui se trouve à environ trois pâtés de maisons de l’Université Acadia, produit une Gose exceptionnelle baptisée Saltwater Joys. Une Gose fabriquée avec de l’eau salée, cela semble logique – après tout, l’entreprise est au bord de l’océan. Et il ne peut y avoir de bière plus locale! Mais ce n’est pas parce que quelque chose est là, accessible, et semble génial que cela va nécessairement fonctionner. Le Dr Joorsens le sait bien, car sa spécialité est l’utilisation de la technologie pour améliorer l’apprentissage. Il mentionne qu’au cours de la dernière décennie, les universités se sont montrées plutôt prudentes avant de s’enthousiasmer pour les récentes technologies.
« Dès le stade de l’approvisionnement, les universités sont beaucoup plus prudentes aujourd’hui lorsqu’il s’agit de définir les pratiques pédagogiques et de s’assurer qu’elles sont fondées sur des preuves. Il faut faire de la recherche pour encourager l’usage des nouvelles technologies tape-à-l’œil qu’elles achètent et nous ne laisserons pas les gens les utiliser simplement parce que c’est branché. L’un de nos grands rôles est de créer la base d’éléments probants requise pour soutenir ces technologies. On peut mettre la meilleure technologie entre les mains de quelqu’un, mais si on ne la soutient pas adéquatement, elle risque de ne pas fonctionner et de ne pas être utile. »
La pédagogie de l’enseignement de la psychologie repose sur ces recherches, sur ces instruments et sur la mesure des éléments probants qui sont intégrés à l’enseignement, mais pas seulement à la psychologie. Bien qu’une grande partie de ces travaux aient été réalisés dans des laboratoires ou dans des classes de psychologie, l’objectif ultime est que toutes ces recherches puissent être appliquées à d’autres classes, d’autres manières et par d’autres personnes afin d’améliorer l’expérience d’apprentissage de tous les étudiants. La Dre Antoniadis en donne un exemple :
« Une application pratique pourrait améliorer les interactions sociales en classe, les interactions sociales entre étudiants, mais aussi entre étudiant et professeur. Ou bien, une application pourrait être utilisée pour améliorer la motivation des étudiants, ou pour diriger et orienter l’utilisation des évaluations. »
Selon la Dre Bowering, « peu importe depuis combien de temps on enseigne, on apprend toujours de nouvelles choses, et on est surpris par les expériences qui se vivent à l’intérieur et à l’extérieur des salles de classe. Notre section offre soutien et encouragement aux gens à toutes les étapes de leur carrière : aux jeunes universitaires qui commencent à se faire la main, aux professeurs en milieu de carrière qui ont donné un cours des dizaines de fois et qui veulent apporter quelque chose de nouveau à leur enseignement, voire aux personnes dont la carrière est plus avancée et qui souhaitent offrir du mentorat à d’autres enseignants. L’enseignement de la psychologie est un domaine très vaste! »
La microbrasserie Lake of the Woods a pignon sur rue à Kenora, en Ontario, et à Winnipeg. Comme pratiquement toutes les autres microbrasseries, elle a récemment élargi sa gamme de produits en y ajoutant des boissons gazeuses, par exemple, la racinette Hockeytown. Bien que cela semble s’éloigner des produits standard de la brasserie, cette évolution vers les boissons gazeuses a été un succès pour les brasseries de tout le pays et lui a permis de vendre un autre produit aux personnes qui étaient cloîtrées chez elles pendant les confinements imposés par la pandémie de COVID-19. De la même façon, dans le domaine de l’enseignement de la psychologie, la pandémie a ouvert la voie à des façons de faire qui peuvent être appliquées universellement et avec succès dans l’ensemble du Canada, notamment, en faveur des étudiants, qui pourraient avoir du mal à assumer les coûts liés aux études supérieures.
« Au cours de la dernière année, j’ai fait des recherches sur les ressources pédagogiques ouvertes. J’ai également découvert le Diener Education Fund, qui a été créé par deux psychologues qui, par hasard, forment un couple et qui ont recueilli des fonds pour financer les dégagements d’enseignement des membres du corps professoral qui sont des experts dans certaines sous-disciplines, explique la Dre Antoniadis. Ils peuvent ainsi trouver un expert en psychologie évolutionniste et lui demander d’écrire un chapitre sur la psychologie évolutionniste. Puis un expert en statistiques ou en psychologie du développement, et le fonds financera le dégagement d’enseignement de l’expert pour qu’il puisse écrire ce chapitre. Le Diener Education Fund a conçu un site Web appelé Noba Project où les membres du corps professoral peuvent aller et personnaliser leurs propres manuels. Je peux entrer sur le site et prendre les chapitres de mon choix, qui couvrent la même matière que celle présentée dans les ouvrages publiés par des maisons d’édition de manuels scolaires. J’ai élaboré ainsi mon programme de cours afin de l’harmoniser avec les résultats d’apprentissage. Les modules sont accompagnés d’images libres de droits, de présentations PowerPoint que je personnalise moi-même, et j’ai intégré cette ressource pédagogique ouverte à mon système de gestion de l’apprentissage. Dans notre étude, nous cherchions à savoir si cette méthode pouvait faire vivre une expérience d’apprentissage similaire à celle d’un étudiant qui aurait acheté un manuel auprès d’une maison d’édition scolaire, et nos résultats le confirment. Les étudiants ont vécu une expérience positive et ont obtenu les résultats d’apprentissage du cours. J’ai reçu un courriel d’un étudiant qui m’a dit qu’il venait de perdre son emploi et que s’il avait dû payer les manuels, il n’aurait pas pu suivre le cours. »
« Je nous vois comme des spécialistes du « savoir-faire ». La société remet continuellement sur le tapis des choses que nous pourrions mieux faire : offrir une formation scolaire équitable, offrir un enseignement de haut niveau accessible, tenter d’améliorer les compétences de tous nos étudiants afin qu’ils obtiennent leur diplôme équipés d’une pensée critique aiguisée et d’une grande créativité, et ainsi de suite. S’assurer que les pédagogies autochtones sont représentées dans l’expérience éducative que nous offrons à nos étudiants. La société exprime beaucoup de ces désirs; mais comment faire cela? Et nous sommes les psychologues qui essaient de répondre à cette question. C’est un peu comme si la société décrivait le paradis, et que c’était nous qui construisions les escaliers menant au paradis », explique le Dr Joordens.
La Burton Bridge Brewery, située à Burton-on-Trent, en Angleterre, produit une bitter anglaise baptisée – pour le moment – Stairway To Heaven, en attendant l’inévitable poursuite de Led Zeppelin.
« J’ai récemment découvert le terme “intra-preneur”, un mot qui désigne les personnes qui travaillent au sein d’une organisation en essayant constamment de trouver des manières différentes et innovantes de faire les choses au sein de cette structure, poursuit Steeve. Et je pense que beaucoup d’entre nous, les spécialistes de l’enseignement de la psychologie, sont des “intra-preneurs”, qui se demandent constamment “comment puis-je améliorer les choses? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire différemment pour rendre mon cours plus intéressant?” Enfin ce genre de chose. »
En 2015, le brasseur, copropriétaire (avec Chris Phillips, ancien joueur des Sénateurs d’Ottawa) et intra-preneur Lon Laddell, de la brasserie Big Rig d’Ottawa, a changé la formule et les ingrédients de l’Iron Arse Ale. L’Iron Arse est la bière en édition limitée que crée Lon chaque année à l’occasion de la campagne de lutte contre le cancer de la prostate Ride for Dad. Cela a provoqué une certaine consternation à l’époque, car la formule précédente était très aimée à Ottawa. Mais la nouvelle formule s’est avérée encore plus réussie, et la bière, encore plus savoureuse qu’auparavant. Pour l’heure, j’ai épuisé les analogies, mais, simple suggestion, si vous vous trouvez à Ottawa en mai ou juin, ne manquez pas d’aller déguster une Iron Arse Ale au Big Rig.

Dre Nasreen Khatri

Dre Colleen Millikin
Dre Nasreen Khatri et Dre Colleen Millikin, Développement adulte et vieillissement
La psychologie du développement adulte et vieillissement est l’étude, l’évaluation et la gestion du fonctionnement physique, psychologique, cognitif, émotionnel et social des personnes âgées de 18 ans et plus et comprend le vieillissement sous toutes ses formes, les étapes, les joies et les défis. Dans le cadre du Mois de la psychologie d’aujourd’hui, le Dr Nasreen Khatri et la Dre Colleen Millikin discutent du travail qu’ils font dans ce domaine.
Développement adulte et vieillissement
« Ce n’est pas votre faute. C’est votre cerveau qui vous laisse tomber. »
La perte de mémoire est encore, à ce jour, fortement stigmatisée. C’est pourquoi la Dre Colleen Millikin utilise cette phrase lorsqu’elle parle à des personnes âgées atteintes d’un trouble cognitif léger ou de démence.
« Les gens ne le prennent pas personnellement quand ils marchent et que leur genou lâche. Mais ils réagissent différemment lorsqu’il s’agit de leur cerveau. Si notre cerveau nous lâche et que nous n’arrivons pas à trouver tel mot ou tel nom, nous avons tendance à nous en vouloir beaucoup plus que si c’est notre genou qui nous lâche. »
La Dre Millikin est neuropsychologue clinicienne au programme de psychologie clinique de la santé de l’Office régional de la santé de Winnipeg et professeure adjointe au département de psychologie clinique de la santé de la Faculté des sciences de la santé Rady de l’Université du Manitoba. Elle est la présidente de la Section du développement adulte et vieillissement de la SCP. Elle travaille principalement dans le système public, où elle évalue les personnes âgées présentant un risque de trouble cognitif léger ou de démence. Le terme « trouble cognitif léger » (TCL) est utilisé pour décrire les problèmes de mémoire qui se situent entre le vieillissement normal et la démence. Comparativement à d’autres personnes du même âge, les personnes atteintes d’un TCL présentent un risque plus élevé de démence à long terme.
« Beaucoup de choses peuvent interférer avec la mémoire sans que ce soit la maladie d’Alzheimer ou des problèmes cérébraux. La douleur chronique et les médicaments pour la traiter, les problèmes de sommeil, le stress, l’ESPT, en fait, plein de choses. Le simple fait de penser que vous pourriez être atteint de démence peut être une source d’anxiété, et l’anxiété peut rendre plus difficiles la concentration et la mémorisation des informations. »
Le domaine de la psychologie du développement à l’âge adulte et du vieillissement est très vaste. Il s’agit de l’étude, de l’évaluation et de la prise en charge du fonctionnement physique, psychologique, cognitif, émotionnel et social des personnes âgées de 18 ans et plus, ainsi que du vieillissement sous toutes ses formes, incluant ses étapes, ses joies et ses difficultés. La Dre Nasreen Khatri est psychologue du développement de l’adulte et neuroscientifique à l’Institut de recherche Rotman, un institut de neuroscience cognitive entièrement affilié à l’Université de Toronto. Elle est à la fois agréée comme psychologue clinicienne pour adultes (18 à 65 ans) et comme gérontologue (65 ans et plus). Elle est la trésorière de la Section du développement adulte et vieillissement de la SCP.
« Plus précisément, j’étudie les répercussions de la dépression et de l’anxiété sur le cerveau, à partir de l’âge de 30 ans et jusqu’à un âge avancé. La principale idée fausse sur le vieillissement est que le vieillissement est une catégorie d’âge ou un état statique. Ce n’est pas le cas. Il commence dès la conception et est un processus dynamique et continu. Vieillir, c’est tout simplement un autre mot pour dire « vivre »!
La Dre Millikin parle beaucoup de l’étendue du domaine du vieillissement et de grande diversité du travail qu’y effectuent les psychologues. Sur le déficit cognitif, qui est sa spécialité, elle dit :
« L’âge est le facteur de risque le plus important de troubles cognitifs, mais j’ai connu des personnes de 90 ans avec un cerveau en très bonne santé et des personnes dans la cinquantaine atteintes de démence. Il n’y a pas de cause unique aux troubles cognitifs. Dans la plupart des cas, il y a une interaction entre les gènes de la personne et d’autres problèmes de santé. »
Ces problèmes de santé sont mieux compris depuis quelques années, en grande partie grâce aux psychologues qui travaillent dans ce domaine.
« Nous savons maintenant que l’activité physique favorise la croissance de nouvelles cellules dans la partie du cerveau qui influence l’humeur et la mémoire. La meilleure chose à faire pour votre cerveau et pour bien vieillir est de pratiquer des activités physiques. Nous savons également désormais que les personnes qui ont des antécédents de dépression non traitée dans la quarantaine ou la cinquantaine ont presque deux fois plus de risques de développer une démence plus tard dans leur vie comparativement à celles qui n’en ont pas. La dépression est tout à fait traitable au moyen d’une variété de traitements fondés sur des données probantes. Actuellement, la démence est incurable. Par conséquent, il ne faut laisser personne s’engager sur la voie du déclin cognitif et de la démence en raison d’une dépression non traitée. L’évaluation et le traitement opportuns de la dépression aujourd’hui peuvent prévenir la démence plus tard. En d’autres mots, prendre soin de sa santé mentale aujourd’hui pourrait sauver son cerveau demain! »
Idéalement, les interventions visant à promouvoir la santé du cerveau devraient commencer le plus tôt possible dans la vie. Toutefois, il est prouvé que le fait de modifier son mode de vie peut réduire le risque de développer une démence, même chez les personnes présentant déjà un déficit cognitif léger. C’est ce que la Dre Millikin et sa collègue, Lesley Koven, une gérontologue clinicienne, cherchaient à aborder lorsqu’elles ont mis sur pied, en 2013, la Early Cognitive Change Clinic for Older Adults, un programme d’évaluation et d’intervention pour les personnes âgées présentant un déficit cognitif léger. La clinique propose une évaluation pour identifier les personnes souffrant de troubles cognitifs légers ainsi qu’un entretien pour évaluer les besoins psychologiques du conjoint de la personne concernée ou d’un autre membre de la famille ou ami proche.
« Nous offrons un programme d’éducation thérapeutique aux personnes atteintes de TCL et aux membres de leur famille afin de les aider à se familiariser avec le TCL, les stratégies permettant de contourner certains problèmes de mémoire et les habitudes de vie qui favorisent la santé du cerveau. L’exercice et l’alimentation sont bien sûr importants, mais nous constatons également que le sommeil joue un rôle majeur. Le sommeil est très important pour la santé du cerveau, mais les personnes âgées ont tendance à avoir des problèmes de sommeil à un niveau plus élevé. L’un des problèmes vient du fait que le manque de sommeil est mauvais pour la mémoire, mais aussi que beaucoup de médicaments sur ordonnance ou en vente libre que les gens prennent pour dormir peuvent interférer avec une substance chimique présente dans le cerveau qui est importante pour la mémoire. Heureusement, il est possible de modifier son comportement pour mieux dormir et l’insomnie peut être traitée par des interventions psychologiques! »
En outre, les membres de la famille des personnes atteintes de troubles cognitifs légers peuvent également ressentir un stress important. Encore une fois, la Dre Millikin insiste sur les répercussions que peut avoir une intervention précoce.
« Nous reconnaissons de plus en plus les besoins des aidants. Nous savons depuis longtemps que les membres de la famille des personnes atteintes de démence peuvent ressentir un stress important. Même lorsque le trouble cognitif est léger, les membres de la famille ou les amis proches peuvent tout de même éprouver un certain stress dû à la situation, même s’ils ne se considèrent pas comme des « aidants ». Donc, si l’on souhaite intervenir pour aider un membre de la famille à gérer son stress, on doit commencer le plus tôt possible.
Il existe de nombreuses autres facettes de la psychologie du vieillissement et du développement de l’adulte, toutes aussi importantes les unes que les autres. La Dre Millikin en donne quelques exemples.
« La Dre Kristin Reynolds, qui est professeure adjointe aux départements de psychologie et de psychiatrie de l’Université du Manitoba, a mis sur pied un programme de soutien téléphonique pour aider les personnes souffrant de solitude pendant la pandémie. Le président sortant de la Section du développement adulte et vieillissement, le Dr Marnin Heisel, fait des recherches à l’Université Western pour trouver des façons de réduire le risque de suicide chez les hommes âgés. La Dre Norah Vincent, une collègue de mon département, a élaboré des programmes de thérapie cognitivo-comportementale en ligne pour traiter l’insomnie. »
La Dre Khatri affirme que la pandémie a eu un impact profond sur les personnes âgées, allant de la santé mentale (p. ex., dépression et anxiété) jusqu’à l’aggravation des problèmes systémiques qui affectent depuis longtemps les soins de longue durée.
« Elle a mis en lumière la façon dont nous traitons nos aînés et la façon dont nous devrions les traiter. Le moment est venu de repenser les politiques de soins, et les politiques gouvernementales et sociales qui ont un impact sur les Canadiens vieillissants. Le Canada est une nation vieillissante et, dans le futur, nous devrons appliquer des politiques systémiques qui optimiseront la santé de notre cerveau (santé mentale et cognitive) et nous permettront de vieillir dans la dignité, l’autonomie et le bonheur. L’avenir de la santé du cerveau au Canada est entre nos mains, et l’un des meilleurs moyens de prédire notre avenir est de le créer.
Enfin, la pandémie nous a appris que nous devons nous concentrer sur notre mode de vie personnel (alimentation, exercice, repos, liens sociaux) à tout âge pour préserver notre santé physique, émotionnelle et cognitive et notre épanouissement. »
Autrement dit, il existe de nombreuses façons d’empêcher votre cerveau de vous laisser tomber. Cela étant dit, cela pourrait arriver quand même. Et si c’est le cas, il est important de se rendre compte que ce n’est pas votre faute.

À cause de la COVID-19, le public, de même que les psychologues, est confronté à une gamme de nouveaux défis. Durant le Mois de la psychologie de cette année, nous allons mettre en évidence les psychologues canadiens qui contribuent de diverses façons à la lutte contre la pandémie. #PsychologieEtCovid
 Dr. Justin Presseau
Dr. Justin PresseauPsychology Month has been extended two days, so we can bring you the work of Dr. Justin Presseau, who is co-Chairing a working group of behavioural scientists advising Ontario healthcare executives and government representatives on best practices during the COVID-19 pandemic.
Justin Presseau
Dr. Justin Presseau is going to welcome a new baby in about a month. His wife Leigh is eight months pregnant, which means this new child will be born in the middle of a global pandemic.
This adds one more job to Dr. Presseau’s portfolio, which also includes Scientist at the Ottawa Hospital Research Institute, Associate Professor in the School of Epidemiology and Public Health and in the School of Psychology at the University of Ottawa, and the Chair of the Health Psychology and Behavioural Medicine Section of the CPA.
As with many researchers, much of Dr. Presseau’s work had to pivot because of the pandemic. He leads a team co-developing new ways to support new Canadians with diabetes to be comfortable taking an eye test. Retinopathy is a manageable issue for people with diabetes when identified through regular screening but attendance rates could be improved, and so Dr. Presseau and his team are building relationships with different communities and community health centres virtually.
Another thing that’s difficult to do from a distance is blood donation. Dr. Presseau and his team are working with Canadian Blood Services and local communities to develop approaches to support men who have sex with men who may want to donate blood plasma, as screening and deferral policies continue to change to allow more MSM to donate if they want. Part of that work involves addressing the historic inequities that led to the exclusion of these men in the first place. But then – there was a pandemic, and his team like so many others have pivoted to continuing to develop key community relationships and campaigns virtually.
In addition, Dr. Presseau is tackling a lot of COVID-related projects, like for example a national survey of to understand what factors are associated with touching eyes, nose and mouth. The research is changing as we continue to develop an understanding of how COVID-19 is transmitted.
Maybe the most important of these COVID-related projects is the , a group of behavioural science experts and public health leaders who summarize behavioural science evidence in the context of COVID-19 and identify actionable guidance for Ontario’s pandemic response. Dr. Presseau is the co-Chair of this working group, which also involves CPA President Dr. Kim Corace.
“We sit within the larger Ontario Science Advisory Table. We’ve brought together expertise in behavioural science and particularly psychologists across Ontario, based both in academia and within government, to work alongside public health experts and ministry representatives.”
Dr. Presseau says that because the working group contains representatives from all these different areas and the team can communicate directly in this setting with decision makers and policy creators, it is the most direct form of knowledge transfer and knowledge mobilization of behavioural science in which he has been involved in his career.
“From an impact perspective, we get to translate our science to people who can make use of it right away, and they can also provide feedback to us – what are they looking for? What’s helpful to them? Of all the things I’ve done in my career this feels among the most impactful. One of the hats I also wear in the hospital where I’m based is Scientific Lead for Knowledge Translation [in the Ottawa Methods Centre], so I think about knowledge translation a lot. The ability to connect directly with those in the field that are making a difference is excellent. It’s also such a validating experience for me, as a behavioural scientist and a psychologist, to see that there’s recognition of our science and a need for an understanding of how we can draw from the behavioural sciences to support Ontarians and Canadians.”
The Behavioural Science Working Group is currently focused on vaccine confidence and uptake among health care professionals. Over 80% of Ontario health care workers say overwhelmingly that they intend to receive a COVID-19 vaccine when it is available to them. The working group is looking to communicate behavioural science approaches to support healthcare organisations across the province to optimise their vaccine promotion programs – for instance, by clarifying that despite having been created at record speed, these vaccines have been shown to be safe and effective and it’s important that those in the healthcare field get one.
Part of this is modeling good behaviour for the rest of the population. And within the healthcare field, modeling good behaviour is one way the working group is hoping to reach those who may be undecided. It’s one thing to have politicians and celebrities get vaccinated publicly, it’s another far more effective thing for your peer group, and hospital CEOs, and team leaders, to do so in front of your team.
Much of this work involves drawing on the literature from around the world to inform hospital policy or public policy. But some of it happens directly, and goes in two directions. For example,
“Our co-chair Dr. Laura Desveaux and her team did surveys with healthcare workers that not only ask if they intend to get the COVID vaccine, but also ask questions that are drawing from behavioural science and psychological principles around the specific constructs or factors might be associated with greater or lesser intention. So they were able to identify key predictors in healthcare workers in January of 2021, the most current data we have. So it’s kind of exciting to be able to quickly draw from on-the-ground data, iterate principles, and push that out to the field to support those who are doing this.”
We have asked most of our Psychology Month participants if they see a ‘silver lining’ in the pandemic. Something that is good, but that would not otherwise have happened absent the pandemic. Dr. Presseau says one silver lining is that it has highlighted just how important and relevant health psychology and behavioural medicine are to understanding and supporting health behaviour change and health and well-being during pandemics.
“After all, behaviour underpins most if not all the public health measures and vaccination activities that are key to seeing the other side of this pandemic.”
When Leigh and Justin’s baby is born, the pandemic will still be ongoing. But that baby will be born into a world that has a much greater understanding of pandemic science, of the behavioural science that accompanies it, and with more and more diverse teams of interdisciplinary experts working together to solve problems – locally, provincially, nationally, and globally.
One day, this baby will grow into a person who can take pride that Dad had a lot to do with that.
 Silver Linings in the Pandemic
Silver Linings in the PandemicPsychology Month has focused on dozens of aspects of the pandemic, a global catastrophe that is deeply tragic. To close out Psychology Month, we focus on a few positives that have come about as a result of COVID-19.
Silver Linings in the Pandemic
It has been a tough year for everyone, and so Psychology Month this year has been tough as well. No matter how many innovative, creative, dedicated psychologists are doing incredible things, it’s tough to forget the reason why. A pandemic that has ravaged the globe, caused untold economic damage, mental health issues, and more. Above all, we can’t forget the two and a half million people who have died as a result, which makes the subject of this year’s Psychology Month deeply tragic.
It is for this reason that we want to end on a high note, in as much as such a thing is possible. We asked many of the psychologists who were profiled for Psychology Month to tell us something good they saw come of the pandemic. A personal or professional observation of a way things had improved despite the global catastrophe. Here is what many of them had to say:
“Across hundreds of universities, dozens of countries, many languages, many disciplines, from the virologists to the immunologists to the mental health practitioners – all these people are working together over months. And doing this work under pandemic conditions, doing this work in labs that themselves could cause a super-spreader event. It’s an amazing human accomplishment that we’re already talking about how to get it under control.”
- Andrew Ryder
“One thing that amazed me was how quickly our field – psychology – was able to pivot to online services and mostly remote delivery of therapy when beforehand it was more of an exception to the rule to see people online or over the phone. Seeing that in-person visits can sometimes be adequately replicated via Zoom, or the phone, or other technologies, has been a really interesting experience for me as a trainee.”
- Chelsea Moran
“It wasn’t on the radar at all to offer virtual group psychotherapy for chronic pain, or for psychologists to have virtual appointments. The way Quebec is set up, we cover people who live seven, eight hours away from our centre. For them, being able to have weekly sessions with a psychologist is something that’s very precious. And for others in chronic pain where even thirty or forty minutes driving in the car to the hospital brings their pain level from a three to an eight, not having to come in on some days can be helpful as well. It’s a door that opened that wouldn’t have opened as fast had it not been for the pandemic.”
- Gabrielle Pagé
“There are certain people who, pre-pandemic, were super-productive and making amazing contributions at work. But because they weren’t bragging, and because they weren’t charismatic, they didn’t get the attention of their bosses and they were kind of overlooked. But now when everyone’s at home, it’s easier to track who’s contributing stuff, who is sending in work product. So all the ‘do-ers’ are getting their chance to shine.”
- Helen Ofosu
“I think the move toward virtual care is something that many many patients find very positive. In the capacity that they’re able to receive care from their home, rather than having to work to get themselves or their children or their family over to the hospital. Parking, and having to sit in a waiting room to come to your appointment – to know that you can do it from home is a huge advantage for a number of patients. This has really pushed us to advance in this area that is a real advantage for many of our patients.”
- Ian Nicholson
“For me, it’s being able to spend time on things I really enjoy. I really like to bake, and I really like to read non-academic books. I love murder mysteries! Being able to give yourself permission to actually engage in the activities that you enjoy, that are non-work-related, that are just for you, to me has been my silver lining.”
- Joanna Pozzulo
“Now that the pandemic has gone on for a long time, I don’t really miss the things like international travel – those were perks. But the things I do miss are seeing my family more, my friends more. Some of these things were clarifying, that the things I thought I was missing were perks but not necessary. As soon as I started giving up on my expectations and the things I was missing, it became easier to deal with them, and easier to reach out to other people for connection.”
- Vina Goghari
We also asked our members to point out some ‘silver linings’ in a poll question we included in our monthly newsletter. Here are some highlights of the responses we received:
“The involuntary aspect for many people to slow down as they were laid off or take time to quarantine and are forced to take time off from vacations and traveling is an opportunity to reflect on goals, and "reset" intentions coming out of the pandemic.”
- Charlene F.
“I have seen increased accessibility to services for people with disabilities.”
“I have seen distance barriers disappear - people are able to access learning, support, and other services virtually no matter where they are (assuming they have access to reliable internet!).”
- Gillian S.
“One positive thing for me was that I left my office and started to work virtually from home. It is much easier for me not to have to drive and find parking, and I don’t have to pay rent. The clients are really happy with that option, too, because it is a lot easier for them not to have to take a half day off work to come to the office.”
- Sharon Z.
“More people enjoying the great outdoors!”
- Julie B.
“One positive thing that I have seen come out of the COVID-19 pandemic is an increased societal focus on the importance of both mental health and social justice.”
- Danial A.
“I'm a third-year undergraduate psychology student at Ryerson. I've really been struggling with adjusting to an online semester, work from home, and volunteering and researching from home. This time has really challenged my mental health, but something positive that has come out of this pandemic is that for the first time in my life I am actually putting my mental health first and prioritizing my own wellbeing. I think I'll come out of this pandemic with so much self-growth, and I truly believe if I did not have so much time alone with my own thoughts, I would not have gone through this self-care journey.”
- Giselle F.
“I have noticed that staying at home has increased my focus on family life. Learning new and fun activities to keep the family busy while staying away from everyone we used to visit. For example, we have discovered new trails in our local area which is difficult because we are already active hikers so know most of the trails. Also, we have taken up painting rocks and searching for others' painted rocks on the more common trails.
As a student I have noticed a high increase of togetherness among students. There is a massive use of discord in the psychology department at VIU. This has helped to stay on top of school work and have discussions about our projects or simply to figure out how to get onto the zoom link the teacher put in a funny spot we can't find. Also on the psychology discord site, students are looking at common interests like gaming that they can do together and discussing various interesting novels that they enjoy.
I have never felt so connected to other students while walking around campus. Now I can log on and ask about test topics or paper ideas.
It's been tough distancing from everywhere, but I realize family life is the most important thing in my world and will not disappear from my life. School is a long term goal and I know one day I will be done with it, COVID is just a bump in the road.”
- Donna S.
“The pandemic has been grounding in the sense that many people have suddenly recognized and remembered the most important aspects of life. When faced with a universal threat to health and livelihood, the superficial details of a day become recognized as such, and the aspects with the most weight and meaning to our lives become clear.”
- Kathryn L.F.
“I believe that this pandemic has taught most individuals the importance of well-being. Seeing as we are no longer under the extreme pressures of traveling from day to day events, we now have more time for self-reflection, personal examination, questioning, and learning. It takes a certain level of resilience to shift perspective from uncertainty and anxiety to gratitude. However, with the pandemic disrupting what we knew as our normal lives and continuing to do so, those who are fortunate enough have been able to embrace this shift. Despite what may be happening in the world the most important thing we can focus on and should focus on moving forward is our overall well-being.”
- Emily T.
“A personal silver lining of the pandemic was having the time to finish my research and apply for residency a year earlier than anticipated. I also had more time to spend with my fiancée since both of us were working from home.”
- Flint S.
“More slowing down. A chance for children to play and be.”
- Jen T.
“Something positive I have seen from the pandemic is a newfound appreciation for in-person interactions, particularly in the younger generations. With so much screen time and so little face to face interaction, not only is in-person socializing of higher value, it’s become higher quality. I’ve noticed people are more likely to put their phones away and live in the moment. Interactions are limited, and we need to make the most of what we get. In my own life and for many of my friends, family, and classmates, it’s been something we’ve come to stop taking for granted.”
- Genevieve J.
“Psychologists being forced to become familiar with providing telehealth services, and the increased access that has provided.”
- Janine H.
“Nonobstant la dure réalité de la pandémie, beaucoup de réalités positives ont émergées. En premier lieu, l’esprit d’entraide et communautaire. Deuxièmement, la créativité, que ce soit dans toutes les formes d’art en tant que telles, mais aussi dans l’adaptation, la réinvention et la recherche de solutions. Troisièmement, toutes les nouvelles habitudes acquises, que ce soit le jardinage, l’exercice, l’apprentissage d’une langue, d’un instrument de musique ou d’une habileté ou encore de connaissances en général. Pour ce qui est de la psychologie, en particulier, la création de portails sécuritaires pour offrir des services en ligne.”
- Elisabeth J.
“Something positive in the pandemic- people have slowed down and reassessed their priorities, needs, and desires.”
- Heather P.
“The negatives from a global pandemic have been catastrophic. The most damaging effects being the crippling of the economy, deaths of millions of loved ones world wide, and an extreme toll taken on people's mental health in so many different ways. Keeping children away from school and their friends, forcing families to remain in abusive situations under the radar, allowing small business's to close down permanently day by day... this damage will take years to repair, and maybe won't be repairable at all.
This cannot be forgotten; however, in order to keep my head above the waters of these unforgettable events, I choose to remain optimistic and seek the positive in a sea of negative.
I remind myself that I have been given a chance to spend quality time with the most important person in my life - myself. People tend to neglect themselves daily, and I believe this pandemic has allowed us to check in with ourselves and take the time to look after our needs and self care. I also think that we often neglect the loved ones in our life. This time of isolation has encouraged me to pick up the phone and call people that I have not spoken to in a long time. I have called my parents more than ever before. I even call my friends instead of just sending them silly photos back and forth on Instagram. These conversations are meaningful. When we are allowed windows of social gathering, these windows are so meaningful also.
Besides these main points, I think that there are some little positive outcomes as well such as cooking more meals at home that are healthier for our bodies and mind, spending more time in nature and trying new activities we never would have tried otherwise, and of course, saving money if you are lucky enough to keep your job.
Negativity will drown you if you let it and positivity will keep you afloat. “
- Sacha H.
“Since COVID, I have become closer with my roommates. We spend more time together instead of doing our own thing all the time.”
- Laura J.
“1] a lot of children may be spending less time on screens by going outside tobogganing, building snow forts, and snowmen.
2] parents are actually spending more time with their children that they did before such as helping and supervising homework but also playing like colouring together and even playing non-screen table games like the good old days, monopoly, snakes and ladders etc.
3] couples like myself with my wife spend more time having coffee together and talking about all things which there may not have been time for before when people ran off to work for the entire day.”
- Jack A.
“I work in education, and I see teachers paying more attention to their own mental health. We bend over backwards for the kids we work with, but it is rare for a teacher to step back and say "I am not okay", and I have seen more of that this year than ever before. They are getting the help they need and taking time off to rest and heal. I hope this continues as teacher burnout is a real thing.”
- Danielle F.
Thank you to everyone who followed along with Psychology Month in 2021. This past year has been difficult, and it has been hard to put into words. Thankfully, there are psychologists all over Canada willing to try. We salute them all, and we salute the resilience of Canadians who have weathered this storm with diplomacy and aplomb. Take care of yourselves, and those around you.

Psychology Month has focused on dozens of aspects of the pandemic, a global catastrophe that is deeply tragic. To close out Psychology Month 2021, we focus on a few positives that have come about as a result of COVID-19.
 Dr. Karen Cohen
Dr. Karen CohenThe CPA has been adjusting, like everyone else, to working from home and embracing the new normal. Our work has been guided by our CEO, Dr. Karen Cohen.
CPA’s Communications Specialist, Eric Bollman talks to CPA’s CEO, Karen Cohen
“The tail of COVID is going to be a long one. It’s going to be psychosocial, and financial. Long after we get vaccines, long after we achieve population immunity, we’re still going to be addressing the psychosocial and financial impacts of living through a pandemic this long.”
Shortly after the NBA announced the suspension of their season on March 11, 2020, there was an all-staff meeting at the CPA head office in downtown Ottawa. The realization was dawning on everyone, and fast, that we were about to enter a different world – both in terms of our own work lives, and in terms of the role of psychology in the world at large.
We knew things were changing – if the NBA could shut down, the rest of the world was not far behind. We knew we’d all be sent home, and we spent that meeting discussing how that would work. Who needed a laptop? Who needed a refresher on Microsoft Teams, having slept through the training session less than a week before? What we did not know was that this would be the last time we saw each other in person for more than a year.
Our CEO, Dr. Karen Cohen, does not follow basketball. For her, the realization was more incremental. But she reached it at the same time, if not a little before, the rest of us. She made the decision to shut down the office and send everybody home.
“We were trying to make the decision that not only would best take care of our workplace, but that would make us a good corporate citizen. It was clear that if the world was going to be successful in managing the pandemic, we had to put in a community effort. “
As the world changed, and the CPA started working from our homes across Ottawa and connecting with people across the country, we realized that psychology was going to have an outsized role to play in helping people and communities manage the pandemic. CPA wanted to help in that effort. Dr. Cohen credits the staff at the CPA for making this transition work, almost seamlessly.
“Everything CPA has been able to contribute to managing the pandemic is to the credit of the association’s leadership, its membership and its staff. From the outset, our goal was to listen and respond to what people needed; what staff needed to work efficiently from home, what individuals and families needed to support each other, what members needed to face disruptions in their work, and what decision-makers needed to develop policies to help communities.
At first though, those lockdowns were not extended – we truly thought we’d be back at work in a few weeks, maybe a couple of months. Karen and the rest of the management team made sure to check in, and to cover their bases early on.
“One of the things we did at the outset was to survey staff – asking what’s keeping you up at night? How can we make things better? What are you most concerned about? And not just to ask the questions but to try to do something about them. We developed policies and made decisions that considered the things staff were worried about and responded to what they needed. We realized that psychology had some tools and suggestions to help them cope so we developed a webinar for staff on coping and resilience. We also reached out to staff one on one and really tried to hear them so we could help make things easier for them.”
We then thought that the survey and webinar might be helpful to the staff of other of CPA’s not for profit association partners and we delivered them to about a dozen of them. The survey enabled leaders to better understand the needs of their workplaces and psychology had some tools and suggestions to help workers cope. Something that was created internally, for the use of our own staff, ended up being of value to other organizations and an unforeseen contribution our team has been able to make.
While we didn’t know how long the pandemic would last, or what the long-term effects would be, the one group we knew for sure would be affected long-term were frontline health care workers. We were already seeing reports from Italy and Spain of overflowing hospitals, a health care system in crisis, and doctors and nurses overcome with exhaustion and despair. So what could we do?
The first major effort of the CPA during the pandemic was to ask our practitioner members if they would be willing to offer their services to frontline healthcare workers, on an urgent basis, as they faced the stressors of delivering health care services during a pandemic. It seemed essential that the people who were out there fighting against this scourge of a virus had every support possible as they took care of everyone else and, because of their work, faced heightened risk of contracting the virus and bringing it home to their families.
“Hundreds of psychologists came together to do that. It was good for CPA, it was good for psychology, and most importantly, it has been good for the health providers psychologists helped.
From there, it was a question of developing and delivering information, and getting as much of it out to members, decision-makers and Canadians as possible. Psychologists across Canada answered the call to help create more than a dozen COVID-specific fact sheets for students, psychologists, faculty, people working from home and more. Our team developed webinars, started a podcast, and undertook the herculean effort of moving the CPA annual convention online with just a few months notice.
The CPA team has been collaborating with innumerable other organizations and agencies, commissioning surveys and public opinion polls, and advocating for mental health to be front and centre in every governmental pandemic-related decision and policy across Canada. The work is ongoing, and it is not likely to stop any time soon.
“We know that rates of anxiety, depression and substance use have gone up as people cope with this prolonged chronic stressor. We can see the impact managing the pandemic has had on our work, relationships, and wellbeing. Maybe the pandemic has shown us that a pandemic takes as much of a psychological toll on our lives as a biological one. Maybe the pandemic has shown us that managing a critical health event successfully is as much about psychological and social factors as it is about the biological ones. Maybe, governments, workplaces, and insurers will fully realize that mental health matters and that it is time that making investments in mental health care matters too.”
 Dr. Jenn, Dr. Laila, and Dr. Mary
Dr. Jenn, Dr. Laila, and Dr. MaryFriends since they did an internship together at the Children’s Hospital of Eastern Ontario, child psychologists Dr. Laila Din Osmun, Dr. Mary Simmering McDonald, and Dr. Jenn Vriend are trying to reach as many kids and parents as they can during the pandemic with the Coping Toolbox podcast.
Laila Din Osmun, Jenn Vriend, and Mary Simmering McDonald
Everyone is swamped. Kids, learning virtually for the past year and dealing with constant uncertainty. Parents, looking after those kids and trying to work remotely or cope with being out of work. Psychologists, whose services are more in demand than ever but who don’t have any spots available for new clients.

Dr. Laila Din Osmun is a parent and a psychologist, dealing with two young children learning from home and an increasing demand for her professional services. She started spending time with her two children, aged five and seven, throughout the week and moved her practice to the weekends. She found she was turning people away because she just didn’t have the availability to see the number of people seeking services. And so she did something that may seem illogical – she added a whole other project to her workload.
In conversation with her friends Dr. Jenn Vriend and Dr. Mary Simmering McDonald, Dr. Din Osmun found that they were experiencing the same thing. The three had become friends during an internship at the Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), and now all three were child psychologists in private practice in Ottawa. None of them could keep up with the demand.

How do you get essential information to as many people as possible as quickly as possible? Nothing can replace one-on-one therapy, but there was clearly a void as the supply was not coming close to matching the demand. Dr. Din Osmun proposed a podcast. Coping techniques for kids, delivered one episode at a time, coupled with discussions of the issues facing families during the pandemic and some personal stories about spending time at home with their own children.
The CopingToolbox: A Child Psych Podcast was born. The first episode was published February 17th, discussing specific coping strategies (setting boundaries, practicing gratitude) for children and parents during COVID.

“Everybody’s feeling overwhelmed right now, myself included. My friends, my clients – it’s a really difficult time. One of the things I’ve been practicing is just allowing myself to feel some of those feelings. Sometimes we feel sad and we don’t want to, or we feel anxiety and we don’t want to. But it’s a really difficult time and we’re going through a lot, and I think it’s really important that we allow ourselves to feel that feeling for a little while.”
Jenn Vriend, The Coping Toolbox Episode One
Future episodes will deal with subjects like depression, as the three friends try to bring more services to more people through a new and interesting platform. On the podcast, they refer to themselves as ‘Dr. Laila’, and ‘Dr. Jenn’, and ‘Dr. Mary’. To an outsider, this might remind people of the ‘Dr. Bobby’ episode of Friends (okay it’s me – I’m the outsider who was reminded of that episode) but it also creates a friendly and welcoming atmosphere should kids be listening with their parents. This was clearly an intentional choice, as was the use of the word ‘toolbox’. Says Dr. Laila,
“We called it The Coping Toolbox because we wanted to provide tools for coping. Not getting into too much detail, and we wanted it to be useful. At the end of every podcast we give three coping skills that we review for the people listening.”
In episode one, those skills are; take a few minutes and breathe, modeling positive behaviours for your kids, and being kind to ourselves. On the podcast, Dr. Jenn says;
“We’re modeling positive behaviours, but we’re not doing it perfectly. So we can take a deep breath, do our best to model those positive behaviours, for ourselves as well as our kids, and then just be gentle and kind to ourselves knowing that we’re doing the best we can given the situation.”
All three Coping Toolbox podcast co-hosts know about doing their best given the situation. They all have young children at home, and each of them brings a different perspective. While Dr. Din Osmun has set aside a large portion of her work to take care of the kids while her husband works a demanding job, Dr. Simmering McDonald, a mom of 3- and 5-year-old boys, is balancing her clinical practice with her husband’s long work days, limited childcare, and weekly appointments regarding the health needs of family members.
In The Coping Toolbox Episode One, Dr. Simmering McDonald notes, “it’s important to consider our own well-being and our own mental health. This is necessary for our own functioning but also for the functioning of our kids and our families.” Dr. Vriend speaks about grief, something many people are experiencing with COVID-19. She separated from her son’s father a few years ago, then sadly he passed away in the summer of 2020. “I’ve had to learn not just single parenting but lone parenting, where you’re it – you’re kind of the everything. I think that perspective, during the pandemic, is going to be interesting to discuss. I remember at one point feeling like ‘I’m my son’s entire world’. I’m his teacher, and I’m his coach, and I’m his mom, and I’m his dad, and it felt very overwhelming. It can add a different perspective because there are a lot of people who discuss both parents, and when you’re a single parent it can hurt a little bit and I think the pandemic has created a whole other layer for single parents and for lone parents.”
In professional practice, divulging personal details is not something psychologists do. But in the context of a podcast, doing so can help the narrative hit home – a narrative that, in the case of The Coping Toolbox, is warm, friendly, expert-driven and truly helpful for many who can’t access that help in other ways at the moment. Dr. Din Osmun says,
“It’s been a crazy time, and we just can’t meet the demands right now. It was getting really frustrating, and the three of us kept talking in group conversations – how can we help? We’re so limited in what we can do. We had the idea of creating a podcast, but we knew nothing about podcasting. The three of us are clinicians in private practice, we have no expertise in podcasting whatsoever. It was a huge learning curve, but we figured this IS something we can do to help people because it’s something the three of us can do from home. We felt like this was a way to help more people in a shorter period of time.”
Laila has taken the lead on the podcast, including taking on hosting duties and – the most painstaking and time-consuming job of all – the editing after the fact. It will all be worthwhile if enough people listen and take away something helpful they did not already know.
You can find The Coping Toolbox: A Child Psych Podcast on Apple Podcasts. https://podcasts.apple.com/ca/podcast/the-coping-toolbox-a-child-psych-podcast/id1553993639

Introducing The Coping Toolbox: A Child Psych Podcast. Dr. Jenn Vriend, Dr. Laila Din Osmun, and Dr. Mary Simmering McDonald are three child psychologists from Ottawa.
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/the-coping-toolbox-a-child-psych-podcast/id1553993639
 Penny Corkum
Penny CorkumDr. Penny Corkum studies sleep and children, and created Better Nights Better Days, a cross-Canada trial that improved sleep for both kids and parents before the pandemic. In the last year, Dr. Corkum and her team went back to those families to see how they were doing during COVID. Their launch of a revamped Better Nights Better Days for the pandemic era is imminent.
“When we launched our survey study asking parents during the pandemic how their child’s sleep was impacting them, what really came up was that it’s the whole family and not just the child. So we not only had to help the child sleep better but also give strategies for the parent to sleep better. So we added that into the intervention as well.”
It probably goes without saying that sleep is incredibly important for children. Difficulty falling asleep and staying asleep can have a big impact on a child, in terms of daytime functioning. They’re not able to focus or learn as well, and it might result in behavioural problems. Dr. Penny Corkum has been studying sleep in children for a long time. In the last decade, her sleep studies have taken the form of connecting parents and families with the interventions they now know work for children and sleep. Part of this is an e-health program, online tools that parents can access when they need them.
Between 2016 and 2018 Dr. Corkum and her team ran a cross-Canada trial called Better Nights, Better Days, to see if this program was effective. It was, and the program resulted in improved sleep, improved daytime functioning, and even parents were less tired during the day as a result. Then the pandemic hit, and it became a constantly evolving crisis – lockdown for a while, then lockdown lifted. School online from home then back to in-person classroom learning. Right away, sleep patterns were disrupted for both children and adults around the world.
The team went back to the families who had participated in the original Better Nights, Better Days trial, to see how they were doing during the pandemic.
“It seemed like a good place to start because we already knew about their sleep, and we knew that they had learned a lot of strategies to help their child sleep. We were curious – were they still using these strategies? There was some research coming out at the time that suggested families were actually having better sleep, since they didn’t have to get up at a certain time. But that’s not what we found. A small portion of our families were doing better, but about 40% of the children and 60% of the parents were sleeping worse than they were before the pandemic.”
A lot of this was happening because of disruptions in routine and structure. We sleep best when we have consistency in our days – a regular bedtime, a regular time to wake up, a standard time for supper. All of this was being upended by a constantly evolving pandemic and the restrictions that went along with it. Two of the biggest factors were anxiety as a result of worry about the pandemic, and screen time. Kids were using screens a lot more while locked down at home which was disrupting their sleep in a big way.
With new data collected from the Better Nights, Better Days cohort, Dr. Corkum and her team could move forward. Almost all the parents said they were still using the interventions they had used for sleep pre-pandemic. 95% of them said that they thought other families should have access to these strategies during the pandemic. Based on this, the Better Nights, Better Days team was able to get some funding to launch an intervention for all families during the pandemic.
That new program launches Very soon – hopefully very early in March. It is free for families to use, intended for parents of children ages 1-10 who are struggling with falling asleep and staying asleep. There have been slight modifications, now that Dr. Corkum and her team have information about the pandemic and how it impacts sleep. They’ve also added to the intervention some information about parents’ sleep, and how to help parents sleep better. Sleep is essential for the whole family!
Dr. Corkum also runs a diagnostic clinic in Truro, Nova Scotia that brings together pediatricians, school psychologists, health psychologists and others to do differential diagnostics for kids who have fairly complex presentations and need a comprehensive assessment. Well, she normally does. But in the past year the doors have remained closed because they just can’t have all those people together in one room. It’s disappointing for Dr. Corkum and her team, who likely won’t be able to re-open until next year. Therapy can be done virtually, diagnostic assessments not so much.
Dr. Corkum says she misses working at Dalhousie and seeing her students, staff and colleagues but doesn’t miss the walk! Her parking spot is far from the office that carrying a bag, and papers, and a laptop through deep snow or a blizzard makes the walk to work something of a nightmare and a serious workout, every winter. She’s still getting the walk and the workout in – but walking a big dog three times a day is a much more pleasant experience.
Fresh air, exercise, and sleep are three of the things that can make life during the pandemic a more pleasant experience. And with the launch of Better Nights, Better Days which has been modified for the COVID-19 context, Dr. Corkum is making at least one of those things easier and more accessible as of today.
Some of Dr. Corkum’s current studies:
Pediatric Sleep Knowledge, Attitudes, and Beliefs
Did you know that there are no well-developed, validated measures to assess healthcare providers’ pediatric sleep knowledge, attitudes, and beliefs? Help us develop one by testing your pediatric sleep knowledge today!
This study will involve completing a survey about your pediatric sleep knowledge, attitudes, and beliefs at two time points. It should take about 15 minutes to participate at each timepoint. Once you finish the survey, you will be contacted again in one month to complete the survey again. After completing the survey for a second time, you will receive the correct answers, as well as access to the first version of the Promoting Healthy Sleep for Early Childhood online training program for healthcare providers, once it has been developed.
To be eligible for this study, individuals must:
- Be a licensed healthcare provider practicing in Canada (e.g., physician, psychologist, nurse, or other allied health professional)
- Have current clinical experience working with young children (under the age of 5 years) at least some of the time
If you are interested in participating, please follow the link below to review and complete a Screening Questionnaire to determine your eligibility: https://redcap.its.dal.ca/surveys/?s=AXENE3YXNA9DCM4L
Develop and Validate the Insomnia Knowledge, Attitudes, Beliefs, and Practices (iKAB-P) Questionnaire
You are invited to participate in a sleep expert panel to assess the content validity of the initial draft of the iKAB-P questionnaire for adults aged 18-64 years old. Please also share this invitation to anyone who you think may be interested in participating!
As a part of the development and validation of the questionnaire, we are requesting your expertise to estimate the content validity of the draft. This is an exciting study as there are currently no validated KAB-P tools for insomnia for Canadian adults!
The inclusion criteria to be eligible to be apart of the sleep expert panel includes:
- Currently live and work in Canada
- Experts who have 3+ years' experience in working with adults with insomnia/insomnia symptoms. Experts include academics (i.e., clinical or research appointment at a university) and healthcare providers who assess and/or treat patients with insomnia
- Those who have expertise in the development and validation of any aspect of sleep measures (i.e., published peer-reviewed development and validation studies)
- Experts who have at least five years’ experience in working with adults with insomnia/insomnia symptoms
If you are interested in learning more, please go to https://redcap.its.dal.ca/surveys/?s=FXT3W8WPYAYCLM44
“Najimpay”: Gathering Indigenous Adult Perspectives on Sleep through Interviews in Nova Scotia
Join us for an interview about sleep in Indigenous adults! We are conducting individual interviews, and we will as you questions about sleep, sleep habits, sleep challenges, and sleep education/intervention.
To be eligible for this study, individuals must:
- Live in Nova Scotia
- Be aged 20 years or older
- Identify as Indigenous
- Be able to communicate in English or Mi’kmaw
- Be associated with Membertou First Nation or the Mi’kmaw Native Friendship Centre (e.g., be a community member, user of services)
If you are interested in learning more, click the following link: https://redcap.its.dal.ca/surveys/?s=FFJXKK74WXJML3H7
 Natalie Rosen
Natalie RosenAt Dalhousie University, Dr. Natalie Rosen studies sexual health in the context of couples. Many people thought there would be a baby boom during the pandemic – Dr. Rosen explains why this hasn’t happened.
Natalie Rosen
Where are all the babies? When the COVID-19 pandemic started creating lockdowns in March of 2020, the memes were everywhere. The generation that was sure to come from the pandemic baby boom was being given all kinds of names – Coronials! Baby Zoomers! We were all looking forward to making lame jokes in 2033 about these children entering their Quaranteens.
It made some sense that we would think that way – hey, we’re stuck at home with nothing else to do, we’ll probably all bake more cheesecake, learn a new instrument, and make a bunch of babies. But the boom never came. In fact, Canada’s birth rate in 2020 declined by 0.73% from 2019 – continuing a steady trend downward that continues into 2021 (we are projected to decline by 0.74% this year). So what gives?
Dr. Natalie Rosen specializes in couples and sex. Dr. Rosen is a clinical psychologist and an associate professor in the departments of Psychology and Neuroscience, and Obstetrics and Gynecology at Dalhousie University. She and her team are currently in the middle of several longitudinal studies with couples, some of which began before the pandemic. They’re hoping that they get some good data at the end of the studies that can shed light on the impacts of pandemic-related stress on sexual health, particularly for vulnerable groups like new parents. In the meantime, she’s looking at other studies that are just now starting to release data.
“A study published last Spring in the States looked at the impact of COVID on people’s sex lives. What they found was that just over 40% of people said their sex lives had taken a hit and were declining. Just over 40% said it was about the same, and then there was a minority of about 13% who reported that their sex lives had actually improved during the pandemic. I think it’s fair to extrapolate to some extent to Canadians, which means a big chunk of us are experiencing a declines in their sex lives.”
So what happened? Why aren’t people having sex more than ever? Where are all the babies we were promised in the memes? Dr. Rosen says we probably should have known this would be the case.
“I think that was wishful thinking. We actually know that for many people, stress and uncertainty puts quite a damper on mood and desire for sex. Of course, there are lots of individual differences, so not everyone is the same, but for many people stress and uncertainty negatively impact sexuality. Also, when you think about all the young families who have had these extended periods of time with their kids at home – not only is that a stressor, but it’s also interfering with opportunities for sex.”
Dr. Rosen’s research focuses on sexual dysfunction from a couples’ perspective. In the past, much of the research has focused on the person with the problem – but of course many sexual problems exist within the context of the couple, and she says that very often the other person in the relationship really wants to be involved and to do something differently in order to help their partner and improve their sex lives. Dr. Rosen’s team is hoping to expand the availability of couple-based, empirically supported, treatments available for sexual dysfunction. They have an upcoming publication reporting on a randomized clinical trial for the results of a novel couple therapy vs. a medical intervention for pain experienced during sex, and they are hoping to do the same with low desire. They’ve just launched a CIHR-funded study into couple therapy when women have low sexual desire.
Dr. Rosen’s clinical work is small. She works with a few couples each week who have sexual problems, such as pain during sex and low desire, and with couples who are going through major life transitions, like becoming new parents. In the beginning of the pandemic she paused her practice because it was impossible to meet in-person, but Halifax is doing well enough that she was able to start seeing couples in person again last Fall. She says that some of the couples she sees have adapted to virtual sessions and now prefer that, so going forward it looks like her clinical practice will be the kind of hybrid model we might expect to see in most clinical settings post-pandemic.
The biggest disruption for Dr. Rosen is likely the lack of travel – in a typical year she’s on a plane every six weeks or so, going to an academic conference, or visiting her family in Ottawa or Toronto. She says that now, she hasn’t seen most of her family in over year outside her husband and two children – but that this slowing down of the pace of life has had its benefits.
“For us it’s been a kind of investment in the nuclear family, spending lots of time just the four of us. And we’ve also had the chance to really explore a lot of the nooks and crannies of Nova Scotia! I also find that it’s forced me to take a step back and evaluate what’s important to me. I can get caught up in the minutia of my work, and particularly early in the pandemic I felt the frustration of trying to find work-life balance with two young kids at home. But you take a deep breath, and you figure out your values - health, family, happiness. I care about my work a lot, but there’s a pandemic, and there are many times when it just can’t be the number one priority!”
People across Canada are re-evaluating their priorities and have been for almost a year now. Like Dr. Rosen and her family, they are finding ways to support one another, to balance work and home life, and to stay as healthy and happy as they can throughout. Dr. Rosen emphasizes that finding ways to prioritize and connect sexually with your partner has many benefits for health and well- being. And that’s a valuable thing to do – just don’t feel like you have to live up to the memes of March!
 Joanna Pozzulo
Joanna PozzuloDr. Joanna Pozzulo and the Carleton University Psychology Department launched a virtual space for researchers, students, and other stakeholders called MeWeRTH (The Mental Health and Well-being Research and Training Hub). It’s a means of connecting the university with community organizations and anyone else who might be a consumer of mental health and well-being research.
Joanna Pozzulo
“You’re going to come out of this pandemic either a contestant on the Great Canadian Baking Show, or a really good murderer.”
“Hmmm. Yes, I hope it leans more toward the baking…but you never know?”
Dr. Joanna Pozzulo spends a lot of her spare time during the pandemic learning new recipes, and reading murder mysteries. Dr. Pozzulo is the world’s foremost expert in the psychology behind children’s eyewitness identification. She has spent more than two decades working in Criminal Justice psychology, and so she doesn’t read a murder mystery the way the rest of us do. She notices what is plausible, and what is implausible, and the many mistakes the killer inevitably makes. “I wouldn’t do it that way”, she thinks…getting one step closer to becoming really good at murder.
As the Chair of the Department of Psychology at Carleton University, Dr. Pozzulo has been doing a lot more during the pandemic than baking stacks of cookies and devouring stacks of mystery novels. She and her department have launched a virtual space for researchers, students, and other stakeholders called MeWerth (The Mental Health and Well-being Research and Training Hub). It’s a means of connecting the university with community organizations and anyone else who might be a consumer of mental health and well-being research.
“It’s a varied group, all focused on conducting research that is of high quality around topics of mental health and well-being. Ultimately, being able to disseminate evidence-based research to the public to improve daily lives.”
MeWerth was planned before the pandemic began, which meant that the virtual platform was a little bit ahead of the curve. Dr. Pozzulo says that COVID had little impact on the creation of MeWerth, but it did make the team rethink how they were going to bring people together.
“Even though it is a virtual space, the traditional idea is that you have a launch, and you invite people to a place and you have, almost a party. We were initially going to launch it in September, but we were in the middle of COVID, so we moved the launch to December and made it virtual. It worked out really well, because we were able to reach a far larger audience without concern for borders or public health risks. We had people attend from all over the world. It was great to get so many people involved when traditionally that would not have been possible. We had one person tune in from Turkey – you can imagine the travel from Turkey to Ottawa, I’m thinking it probably wouldn’t have happened otherwise.”
MeWerth is a multi-disciplinary space with a broad range of topics. Some are COVID-related, most are not. Dr. Rachel Burns is a member working on studies related to diabetes (how and when do spouses influence the health and wellbeing of people with diabetes?). Dr. Johanna Peetz is researching financial factors in well-being. Dr. Michael Wohl is looking at several facets of addiction, notably gambling addiction, including a study on casino loyalty programs.
Every Wednesday is #WellnessWednesday at MeWerth. On the website there is a ‘Wellness Corner’ where this week Dr. Robert Coplan’s research explores the novel concept of “aloneliness”, conceptualized as the negative feelings that arise from the perception that one is not spending enough time alone. A concept that very much applies during the current pandemic. This is just one of many facets of MeWerth, a platform Dr. Pozzulo already considers to be a success.
“We had 800 people register to attend the launch, a number that’s unheard of in an academic environment - to have so many people from so many different backgrounds be interested in something. I was really pleased, and it signalled to me that we were filling a need, and maybe we had underestimated how much that need was there. I’m seeing lots of interest in MeWeRTH – and its continued interest. I’m thrilled about that and I hope we can continue to grow MeWeRTH both locally and globally.”
For Dr. Pozzulo and her team to grow MeWerth, more researchers, students, community groups, organizations and other stakeholders will need to discover the web platform and sign up (https://carleton.ca/mental-health/). So, if you are one of those individuals interested in mental health and well-being, you probably should sign up. Or else…
Or else Dr. Pozzulo might not share any of her fresh-baked chocolate and candied-pecan éclairs with you.
 Some of the psychologists doing interesting things during the pandemic
Some of the psychologists doing interesting things during the pandemic
Meet some of the psychologists who have been profiled in this Psychology Month. We speak with Dr. Adrienne Leslie-Toogood, Dr. Christine Chambers, Courtney Gosselin and Dr. Mélanie Joanisse about their work during the pandemic.
 Vina Goghari
Vina GoghariDr. Vina Goghari is the Editor of the Canadian Psychology journal. The amount of pandemic-related research and article submissions has been overwhelming in the past few months. The upcoming COVID special edition of the journal will present papers that cover a very broad range of topics related to the pandemic.
Vina Goghari
Dr. Vina Goghari had big plans for 2020. There were going to be conferences that would synergize with her vacations – including one in Banff where she was planning to rent a cottage and hang out with some of her friends. A couple of talks in Vienna were going to allow her to explore the nearby areas and experience Austria for the first time. Instead her breaks disappeared, her workload increased threefold, and she ended up stuck at home with a kidney stone for five months. 2020, right?
Dr. Goghari is a professor at the University of Toronto where she is the Graduate Chair of the Clinical Psychology program. What interests us here at the moment is Dr. Goghari’s position as the editor of Canadian Psychology/Psychologie canadienne, the flagship journal of the Canadian Psychological Association. The bulk of a journal editor’s work is remote already, so very little has changed in that respect, but the pandemic has created a bit of a slowdown in the review process.
“The ability of academics to spend their time on peer review has been impacted. I find they’ve still been gracious, and people are still volunteering to review these papers, but sometimes we find that people need more leeway in terms of time to actually get us the review back. We’ve been lucky that both the authors and the reviewers are having a little bit more patience with each other, and the editor, and the associate editors. It allows us to make sure this process is still equitable and fair and we still get enough reviews.”
Another thing that has, predictably, changed is the number of submissions Canadian Psychology is receiving concerning COVID itself. So many, that they have prepared a special issue just for the pandemic. Dr. Goghari says the volume of articles has been overwhelming.
“We did a call for COVID papers in May dealing with psychological perspectives on the pandemic – we feel a psychological, as well as a Canadian/International, lens is very important to helping people deal with the pandemic in terms of work and life balance and mental health. The Special Issue will be coming out in the next few weeks. We saw a record number of papers for that call. This was especially so (true) for the two of us who are the English-speaking editors ̶ we were fielding a tremendous number of papers! It was positive in the sense that the psychological perspective on the pandemic is resonating with people, but also really increased our workload, as we always want to ensure we do a professional job with all submissions. Luckily we were able to get through all of them, and I really think we have a fantastic special issue
Canadian Psychology is a generalist journal, which allowed Dr. Goghari and her team to design the COVID special issue with intention. They wanted the articles to cover a wide range of topics related to Canadians, and to reflect different parts of our society and our population. There are articles about work, sleep, mental health, adults, children, training, and much more. There are also two articles in French, and Dr. Goghari hopes that there is something for everybody in this journal issue.
Not only have they seen an increase in COVID papers, but papers regarding race-related issues that have become increasingly front and centre over the past year. More papers addressing topics such as mental health and racial disparities have been submitted. Dr. Goghari says she wishes this has also been the case for journal in the past given the importance of these societal issues, but is heartened to see that this is more of a focus now.
“One of the things COVID highlighted was that the pandemic doesn’t affect everyone equally. There are certain groups that are more affected by the pandemic like the elderly, we know that there were racial disparities in both outcome and incidence of the virus. And so the two things came together – the societal tensions on race, but also highlighted and made worse by the COVID pandemic interacting with these factors.”
Dr. Goghari says that she is encouraged by the rise in awareness created by the new focus on inequities and dismantling the systemic causes of racism. She is also encouraged by the number of papers she and her team are receiving surrounding COVID and expects that the studies launched later in the pandemic that focus on longer term impact, challenges, opportunities, and resilience, will produce some new, useful, and fascinating results. Dr. Goghari is above all an optimist. Even when it comes to missing out on some great trips, and a kidney stone!
“I find I don’t really miss the things like travel – they were just perks. I miss seeing my friends and my family. I also had some interaction with the health care system because I had a kidney stone for five months. I was very grateful for all the people who are still doing ultrasounds and CT scans and keeping the hospitals clean for us. They were just so kind! Even though they themselves were dealing with all these things, I was touched by their professionalism and their help even while I could see the burden on the health care system. When the kidney stone clinic had to close, there was an onslaught of people and we all have to get in…it was a very eye opening experience. Given what the health care workers go through, they were tremendous even though they must be in a difficult situation. I think COVID plus a kidney stone made me grateful for all the smaller things!”
 Judy Moench
Judy MoenchDr. Judy Moench has helped create protocols to help her Alberta community and others during the pandemic. Prepped 4 Learning helps teachers, parents, and kids cope with disruption. The Self-care Traumatic Episode Protocol (STEP) is helping mental health clinicians, hospital staff, and others decrease stress and increase coping.
Judy Moench
“I feel like a budding musician who started out in the basement! During COVID we weren’t able to get into a studio or anything like that so I literally developed these videos in my basement using audio on my phone.”
The Self-care Traumatic Episode Protocol fits into a neat little acronym – STEP! Was this one of those programs that worked backward, to shoehorn its description into an easily-remembered four-letter word? Dr. Judy Moench says no.
“It was named that on purpose because it’s a modified version of a protocol that was developed called EMDRGTEP – which is the Eye Movement Desensitization and Reprocessing Group Traumatic Episode Protocol.”
Nobody worked backward, I think we can assume, to make EMDRGTEP a neat little acronym!
Dr. Moench is a registered psychologist in Alberta with a private practice, and also an adjunct professor at the University of Alberta. During COVID, she’s been working on a number of protocols that might be helpful in the community. One is a school-based program, focused on the universal promotion of emotional health with an emphasis on the well-being of students. Prepped 4 Learning is a self-regulation program that starts with teachers and parents helping kids regulate to learn, all the way up to what to do if there is a crisis in school. Dr. Moench thinks STEP might be helpful in this setting as well, for teachers in particular, and they are beginning research with school staff soon.
STEP was launched during the pandemic to assist mental health clinicians, medical staff, and other front line workers to decrease stress and increase coping. The idea was that because people were unable to meet in person a computer-delivered protocol was necessary. This was not intended to be a substitute for psychological treatment or medical diagnoses, but that a 90-minute session with STEP videos could develop containment strategies that would allow them to continue working on the front lines through this time of overwhelming stress. Eye movement is part of the process.
“Eye movement is part of EMDR Therapy, an approach that has an eight-phase model, and you go through all the phases with a client to help them resolve unprocessed material and recover from distressing life experiences. STEP is an adapted protocol but it still uses eye movements and goes through modified phases of treatment – you print out a worksheet, and the person taps from one side of the protocol sheet to the other side and follows with their eyes as they’re doing that. The eye movements help to add distance and give calmness around the event that is being processed. It helps to consolidate the memory in a more cohesive way.”
Normally Dr. Moench and her team would do this kind of activity in groups in the office. You know, in the before-times. Now, this program has to be modified for online delivery, which means a few steps have been adapted. Typically, EMDR treatment would involve an extensive history with the client – with STEP, this has been modified to a few specific questions up front that ensure the person is ready and eligible to use the protocol. For example, someone who was thinking about suicide, or had a complex trauma history, may be better served with one-to-one EMDR Therapy.
Another thing that sets STEP apart is that it is designed to deal with only one very specific trauma episode at a time – right now, the trauma brought on most recently by the COVID-19 pandemic. Dr. Moench calls this ‘titration’, and it narrows the focus to that one episode and excludes the larger history that might otherwise be part of treatment.
“With STEP, the research study we did focused exclusively on COVID. Since then, I’ve used it with other things that aren’t specifically COVID-related…even though right now everything is kinda COVID-related! But there are other events that are happening along with the pandemic.”
The STEP protocol has been used in Alberta with mental health clinicians, with a small group of staff from the United Nations, and with other national and international groups in which Dr. Moench is a member. Right now, she and her team are making a more professional version of the current STEP videos – after all, the originals were shot in her basement with audio from her phone! Only time will tell if this psychology-as-garage-rock-band will be a pandemic-specific flash in the pan (like the Strokes) or a longer lasting international sensation (like U2).
Hey…that’s got us thinking now. How come there hasn’t been a Live Aid / Live 8 pandemic relief show yet? Those were always super-distanced!
 Chloe Hamza
Chloe HamzaDr. Chloe Hamza has an article in the upcoming Canadian Psychology journal COVID-19 special edition entitled ‘When Social Isolation Is Nothing New’. It’s part of an ongoing study of post-secondary students, some of whom had pre-existing mental health concerns before the pandemic, and some of whom didn’t.
Dr Chloe Hamza
Dr. Chloe Hamza is an assistant professor in the department of Applied Psychology and Human Development at the Ontario Institute for Studies in Education at the University of Toronto. She’s the lab director of the CARE lab (Coping, Affect, and Resilience in Education), and her research has been broadly about stress and coping among postsecondary students. It was with this focus that she and her team ran a study looking at the psychological impacts of COVID-19 among postsecondary students.
Like so many other studies at this time, Dr. Hamza and her team were lucky to have already done a similar survey, that one in May of 2019. This meant that repeating many of the same questions with many of the same participants could give a good indication of where they were now, with the pandemic, compared to where they were before.
“We had some pre-COVID assessment data, and then we went back in May 2020 and surveyed students again. We were looking at stress, coping, and mental health before and during the pandemic. What we had originally hypothesized was that students with pre-existing mental health concerns would be those who would be most adversely impacted by the pandemic. But what we found was that students who had pre-existing mental health concerns fared similarly or were actually improving during the pandemic. Whereas students without pre-existing mental health concerns showed the greatest decline in mental health.”
This study, and these results, have resulted in an article that will be published in this month’s COVID-19 special issue of the journal Canadian Psychology. (See our upcoming profile of Dr. Vina Goghari for more on the journal the day the special edition comes out.) The article is called ‘When Social Isolation is Nothing New’, and it details these findings from Dr. Hamza and her team.
“When we looked at why those students without pre-existing concerns were declining, we found that increasing social isolation seemed to be associated with deteriorating mental health. What that seems to suggest is that if you were feeling socially disconnected before the pandemic, which in our case was among students with pre-existing mental health concerns, the start of the pandemic and distancing guidelines may have been less impactful. In contrast, if you weren’t used to experiencing social isolation, and this was a real change for you, your mental health was more likely to decline.”
It looks, for now, as though students with pre-existing concerns were already experiencing some kind of isolation socially pre-pandemic, and that has made the adjustment easier and less impactful for them than it has for others. There are of course other possibilities that might account for the findings of Dr. Hamza and her team, and they plan to explore those in a follow-up study that is beginning right now.
“For many students some stressors actually decreased. For example, having multiple competing demands, or academic pressures, lessened. Which sort of makes sense if you think about how universities initially responded to the pandemic. Students weren’t going to class any more, they may not be going to work, and so the demands on their time – both academic and vocational – may have decreased.”
The follow-up study is currently under way, where Dr. Hamza and her team are asking those same students how they’re coping now during the pandemic. Some of it will involve the results of the previous study, where they will ask the participants about the results. “Here are some of our findings – how does this resonate with you? Do you think it’s accurate? What are some of the reasons you think we might have seen this result back in May?”
While that study is ongoing, Dr. Hamza is also focused on her own students – trying her best to ensure that they remain engaged, well, and healthy through what has been a very difficult school year. Her department does a ‘wellness challenge’ which challenges people to get outside and walk, or pick up and learn a new instrument, or try a new recipe. All things we can do to maintain better mental health during this time of isolation. Things that are good both for those of us who are still new to distancing and socializing remotely, and for those of us for whom social isolation is nothing new.

 Laurie Ford
Laurie FordDr. Laurie Ford at UBC has school psychologists to train, students adjusting to online learning, and innovations to replace hands-on experiences. She also has a community garden and two great dogs!
Laurie Ford
“Every night we talk on FaceMail”.
Two things are getting Dr. Laurie Ford through this pandemic in a positive way. One is her nightly ‘FaceMail’ chats with her dad in Oklahoma. Not sure if this means FaceTime, or FaceBook, or Zoom or some other video chat platform, but dad calls it FaceMail and so FaceMail it is. The other is a community garden where Dr. Ford is the President. The garden has become a meeting-place and something of a pandemic oasis throughout the past year. Sometimes up to six or seven people, Laurie and her friends, will head to the garden after work, sit well-distanced on the various plots, and share a laugh and a glass of wine. Maybe pull some weeds. It’s a nice break from long days at work.
“I’m getting a lot of work done – when all I have to do is go to the front of my house and come back. The bad thing is I think many of us are working too much, as the lines between work and home are blurring.”
Even Dr. Ford’s beloved community garden has become part of that blurring of work-home-life, her meetings with friends inspired her to do the same with her grad students. A few months into the pandemic, she suddenly realized that most of her students lived in Vancouver but had never actually met one another in person! With the exception of one student stuck in Australia and one stuck in Alaska, she invited them all to meet, in person, at the garden. (The two stranded students were able to join virtually, by Zoom.)
Dr. Ford is at UBC. She is the Director of Training for the School and Applied Child Psychology program and has been involved in training school psychologists for a long time. She is also a board member at the CPA. As the pandemic has gone on, she has become more and more accustomed to Zoom calls, as has her dogs Gracie Belle and Cooper come to say hi and investigate the goings-on before wandering off to find more interesting ‘dog stuff’ as Dr. Ford goes back to teaching her now presumably more interested class.
“One of the big things, from a training perspective, is to figure out ways that students can get some of that hands-on training, in schools and in clinical settings, when everything’s restricted. The other part that’s related to training is – how do you move to train people to do service delivery in less traditional ways?”
Right now, Dr. Ford’s training is primarily preparing Masters and Doctoral-level school psychologists. Training that would ordinarily involve a lot of hands-on experience. Before 2020, Dr. Ford would take her students to a local homeless shelter for some classes. Others would take place in a rehab clinic, or a xʷməθkʷəy̓əm (People of the River Grass) longhouse located within walking distance of the UBC campus. Dr. Ford says, just being in these physical locations was a huge part of the experience. That, of course, has not been possible in the past year. So they are finding some workarounds.
Members of community join Dr. Ford’s Communities Systems class some weeks as they try alternate ways to immerse students in a variety of settings. In this class and others, she’s also experimenting with videos, podcasts, and other methods of delivering information that are different that simple Zoom lectures. She says she has been surprisingly impressed by how many of her students are doing the extra work and taking advantage of the extra content she makes available to them.
“I think I was just so determined to make this be awesome, even though it sucked being on line, that it’s made me become more familiar with the technology of teaching online, but it has also in some ways made me work harder to find diverse sources of information. I actually think I’m better teaching this course than I have been in the past. I’ve had to work harder to be more creative to find new and better ways to engage my students. It’s made me think like the kids a little bit – I’m doing less lecturing and I’m using podcasts and videos. They’re good teaching pedagogies that we talk about but then we kind of get lazy, you know? So I really think I’m doing a little bit of a better job this year!”
Dr. Ford has a big personality, the kind that can fill a lecture hall in person better than a Zoom screen. She says she misses that part of teaching, addressing a large room full of people, and it’s clear that will be the first thing on the docket, whenever this pandemic ends and she can get back to the front of a class. But while it goes on, she hopes that the innovations she and her students have come up with have made her a better teacher, and they have certainly made her more tech-savvy. When the spring arrives, her students will be able to meet one another again, in a safely distanced fashion. They still have the community garden.
And Laurie’s dad will still have his FaceMail.
 Dr. Christine Chambers
Dr. Christine ChambersDr. Christine Chambers is part of the #ScienceUpFirst initiative, the Scientific Director at the CIHR Institute of Human Development, Child and Youth Health, and many other things. The biggest change for her during the pandemic might be as the Scientific Director of SKIP (Solutions for Kids in Pain).
Dr Christine Chambers
Busy mom of 4, PhD Psychologist, Scientific Director @CIHR_IHDCYH , Scientific Director @KidsInPain , Professor & Tier 1 @CRC_CRC in Children's Pain @DalhousieU
- Christine Chambers’ Twitter bio
You’ll note that the first word in Dr. Christine Chambers’ Twitter bio is ‘busy’. It’s a shame that Twitter bios allow a maximum of 160 characters only…or maybe it’s a blessing? By the time people finished reading hers, they might have no time left for doomscrolling! That’s also why we have profiles such as this one, which, as you will note, has no character limit whatsoever.
I feel lucky to have been able to spend half an hour speaking with Dr. Chambers. When I first started at the Canadian Psychological Association, I had made plans to meet with Dr. Chambers in the spring of 2020, when she would be in Ottawa for a conference. Back then, that was how meetings worked – you would wait until you were in the same city, then you would squeeze in some time. Things operate a little differently now but with Dr. Chambers, even on Zoom it’s still about squeezing in time.
Dr. Chambers is speaking with me just after one Zoom meeting and just before another, each one involving a different hat she wears. One of those hats is as the scientific director of Solutions for Kids in Pain (SKIP).
“SKIP is a federally funded national mobilization network, focused on moving research into practice. We received funding for four years, so our first year of operation was in the ‘before-times’. - In that first year we laid groundwork, developed relationships, built momentum. The pandemic hit just as we were entering into our second year of operation. It’s fascinating, both in terms of the areas of focus that we’re engaging in right now, but also just the process of knowledge mobilization.
How research gets moved into practice is based a lot on relationshipsand bringing people together. In our first year we had so many workshops, and we played a key convening and catalyzing role in bringing people together on a number of issues in physical spaces. All of a sudden you lose your ability to do that. Thankfully we had a lot of partners in SKIP who were already in the digital space either with health providers or with parents, so we had the right tools and the ability to leverage those.
From a content perspective, obviously vaccinations are a huge topic right now. In the area of children’s pain, vaccination pain evidence is very robust. Anna Taddio and others like Meghan McMurtry (also a psychologist) have pulled together this evidence and there’s a clinical practice guideline. So we’ve been doing a lot of public engagement around needles, and how to prepare for needles.
Virtual care has obviously also been something people in the healthcare space have been engaging in in new and different ways, and Katie Birnie – also a psychologist in SKIP – has been leading some really interesting work in this space.
Another thing though, and every health person is struggling with this right now, is how do you keep your issue (in my case pain) a priority in the middle of the pandemic? We were working to improve pain management in Canadian health institutions, now we have to figure out how to keep that issue a priority while competing against all this very important focus on the pandemic. So it’s been a hell of a year!”
Dr. Chambers says she’s been pleased and surprised at how well the team at SKIP has been able to keep pain front and centre, and how well institutions are responding. There have been many champions for this cause working for many years, and the disruption of COVID may actually have made things a little easier. One, because a lot of people in the healthcare space are re-constructing their practices in a different way, and two, because talking about pain and pain management gives those health institutions a bit of a break from talking about the pandemic.
Another hat Dr. Chambers wears as an expert with the #ScienceUpFirst initiative, combatting online disinformation around the pandemic, the vaccine, and more. (See our profile of Dr. Jonathan Stea for more details on #ScienceUpFirst.)
“This is a fantastic collaboration led by Tim Caulfield and Senator Stan Kutcher, and I was thrilled to be one of the psychologists that was an early joiner. I’ve been using social media for a number of years to help promote the work we’re doing and to raise awareness with a particular focus on parents. So it’s been really nice to be a part of this group addressing misinformation head-on. I have my eye on the types of misinformation that gets shared around children and families. It’s a wonderful group of people trying to make sure that evidence (in my case psychological evidence) is embraced and accepted.”
Some more hats. Dr. Chambers is a professor at Dalhousie University. She runs a research lab where they generate new knowledge about children’s pain. And she is also the Scientific Director of the Canadian Institutes of Health Research Institute of Human Development, Child and Youth Health.
“It has been a busy year! It was going to be a busy year before the pandemic, but the pandemic really took it up a notch. It’s a privilege to have the opportunity engage in so many different roles, and I tell people I’m definitely not bored during the pandemic! And also I think that never before has Canadian science and global science been on such a stage. Never before have we needed science more, or have needed to communicate the role of science. So it’s important that psychologists have visibility, and that the psychological evidence be generated and shared. I’m always trying to put up my psychology flag at every table I sit at, and reminding people of the value of psychology.”
Dr. Chambers has four kids between the ages of 9 and 14. Several years ago, she realized that all this research – research she had been instrumental in creating – was not being used to the benefit of her own children. It was then that she started getting into the mobilization side of things, the advocacy and media and policy veins. This involved creating videos, becoming active on social media, and ensuring that knowledge moves to where it needs to go and it led to a career of many hats.
“All this great psychological research is wonderful, but if it sits in journals, or in conferences, and doesn’t actually get out into the hands of people who need it, then what was the point?”
 Mélanie Joanisse
Mélanie JoanisseWhen the pandemic began, Dr. Mélanie Joanisse created a simple, easy, and funny Guide to Wellness for her frontline co-workers at the Montfort hospital. It immediately took off and has been shared and translated around the world to help healthcare workers everywhere.
Mélanie Joanisse
“I wrote this in what I would call a hypomanic phase…as psychologists, we always have to pathologize any kind of creativity.”
Dr. Mélanie Joanisse was still processing the fact that she was not going to be able to attend a Pearl Jam concert when she had something of a viral moment in the early days of the pandemic. Can we still say ‘going viral’? Or has that phrase now passed out of the lexicon like so many others before it that conjure unwelcome memories? Anyway, a lot of people suddenly found Dr. Joanisse’s work. Like, a LOT of people. Her ‘Guide To Wellness’ was being discovered.
“I got a call from the communications director at the Montfort hospital, who said ‘what was your marketing and communication strategy for this? [Mélanie laughs heartily] I was like…none? She said we were being bombarded with messages from people who said they like it, and I was starting to receive a lot of emails – even from people in Europe – saying ‘we like this, can we translate it?’ And so I said sure, go for it! So the communications team at the Montfort helped me to create a creative commune so people would understand that they could just take it.”
Dr. Joanisse’s has a private practice in Ottawa, but does a lot of work at the Montfort Hospital, Ontario’s only francophone hospital. When the pandemic first hit, she saw at the Montfort the stress that the staff was experiencing. The sudden worry among doctors and nurses. The occupational therapists and social workers who were wearing masks and gowns, something they would never have done before. It was all hands on deckand changed how everyone was working. She wanted to do whatever she could in her capacity as a psychologist to help.
“As a psychologist I’m not trained in acute care – no one would want me in the ER! So I figured maybe doing a guide would be helpful. I was reading a lot online, and there are a lot of good resources, but I was just picturing a physician or a nurse or an RT sitting down with a list of 25 papers that they could read on wellness. I just pictured them shutting down their computers and saying ‘I don’t have time or the capacity for this’.”
So Dr. Joanisse set about writing something that encompassed as much as possible about the evidence-based ways to wellness, but to package it in a more engaging way. Visually attractive, a little bit funny, and representative of what frontline healthcare workers were experiencing. An easily-digestible light read, rather than another arduous undertaking.
“The only mask you should be wearing is a medical mask; please discard the infallible mask, as research has shown it suffocates its users.”
- From the Guide To Wellness
The humour in the guide comes from Dr. Joanisse herself. She’s extremely funny, in a very natural way, and that good humour has helped her get through this pandemic and all the setbacks. Like the Pearl Jam concert she missed – her first realization of how big COVID-19 was going to be was that cancelation. Or, more recently, the Chiefs loss in the Super Bowl – her husband is a huge Chiefs fan and just after they were married they flew to Kansas City to take in a game at Arrowhead. In 2019, moments before the pandemic really took hold, the Chiefs finally overcame decades of ineptitude to deliver a Super Bowl victory to fans like Mélanie’s husband.
“Last year when they won, it was pre-pandemic so we were at a friend’s house for the Super Bowl. He got up and spontaneously screamed ‘this is the best day of my life!’ There was a silence, and everyone looked at me. I was like, sorry daughter…birth…wedding…I’m just putting that in my pocket. The next time I spend I don’t know what on what, I’m bringing that card out!”
Now, after watching her husband celebrate the greatest day of his life, Dr. Joanisse is something of a Chiefs fan too. This is perhaps more because of Laurent Duvernay-Tardif, the French-Canadian starting right guard with a doctorate in medicine who left the Chiefs in the offseason to join the front lines of the pandemic back in Montreal. Just the kind of person who might benefit from the Guide to Wellness.
Dr. Joanisse still sees stress in her co-workers at the Montfort. Now, it’s not the stress of uncertainty that existed at the beginning of the pandemic, but rather a stress borne of long hours, fluctuating numbers, a desire for the pandemic to be over, and sheer exhaustion. She’s heartened, however, that many have taken her Guide To Wellness to heart – not only at her own hospital, but at institutions around the world.
“Now I know people in Hawaii, BC, all over the world. All types of different healthcare workers have reached out to me. It has been quite the experience, I have to say. And very moving, to know that this has touched people in that way.”
 Khush Amaria
Khush AmariaMindBeacon had a bit of a head start on other similar groups when the pandemic began, as they had already been providing online services for some time. Dr. Khush Amaria is the Senior Clinical Director at MindBeacon, and the last year for her has been packed with speaking engagements.
Khush Amaria
“My Zoom background used to have my Parent Report Card up there but I took it down because I wasn’t doing very well – my cooking skills were poor, there were many problems.”
Dr. Khush Amaria’s Zoom background now has a bar graph made by one of her children, which really is ideal – it’s homey, warm, colourful and comforting – but also scientific! Just the atmosphere she probably wants to evoke for CBT Associates and MindBeacon.
If you are a resident of Ontario, a pop-up window appears when you go to the MindBeacon website. ‘Free therapy for Ontario residents! MindBeacon’s Therapist Guided Program is now free thanks to funding by the Government of Ontario.’ They were always providing live therapy through a digital stream with the CBT Associates division of the company, but it was restricted to Ontario only. During the COVID-19 pandemic, they have expanded their Live Therapy program (now capitalized and official) across Canada, and the Ontario portion is now free thanks to government assistance.
“The one thing that is so clear to me is the demand. In the summer we may have seen about 800 new accounts created each week. In the fall that number was reached close to 2,000 new accounts some weeks. It’s indicating that Canadians are struggling, but that they’re not waiting – they’re reaching out for help right now.”
Dr. Amaria is the Senior Clinical Director at MindBeacon and manages the CBT Associates side of the business. During the pandemic, that has meant she does a huge amount of speaking engagements. Companies who reach out looking for an expert in stress, or anxiety, or depression, get Dr. Amaria’s full attention, as she walks them through some of the steps they can take to alleviate the difficulties of their employees. She gets them to understand what level of help they might need, and what supports are available.
“Sometimes it’s a company that will come to me and say, ‘we’re all feeling a little concerned about each other, and we don’t know how to know if our colleagues are doing well’. So what I often do is talk about how we identify stress in ourselves. A common topic might be ‘what is burnout vs. just feeling burnt out?’ How can you be there for others? For me that’s a really nice way to make psychology and the science of psychology understandable to the day-to-day person. My intention with almost every single event I’m part of is to have people feel like they can walk away with a plan.”
That plan may be that they research the thing Dr. Amaria was talking about. Or they’re going to reach out to a friend that they think might not be doing so well. Or that they themselves will reach out because they’re not doing well. It’s always about reminding people of the supports that are available, and destigmatizing mental health – recognizing that mental health is an integral part of everyday health.
In March of 2020, MindBeacon was one of the companies chosen by the Ontario government to provide services quickly and on-demand to Ontarians, which meant that Dr. Amaria and her colleagues expanded their roster of psychologists, and other mental health professionals, very quickly.
“We had to figure out really quickly how we could build our roster, and we brought on psychologists but we also brought on registered social workers. We needed to be able to deliver services, and our psychologists could then be involved in places where diagnosis was required, or helping with triaging, or oversight. Our psychologists are involved in developing protocols. We recognized that some people don’t fit the criteria of having a depressive disorder or being anxious – but they have stress! So we launched this amazing managing stress protocol in the fall because many people just needed to ‘tweak’ their stress management skills. That was a psychologist who wrote that out and put that material in there. That’s the nature of what we do.”
Another major thing that happened during the pandemic was that MindBeacon went public. Dr. Amaria is a psychologist, still does clinical work, oversees the residency program at CBT Associates, speaks to large groups and does a lot of work as a spokesperson for the company. What she does not do is IPOs and the stock market.
“I’m not sure I really understand most of it – but the most amazing thing about it was the attention that this garnered, and the investment coming back into us as a company to continue to support Canadians. So that’s been really neat.”
When GameStop stock took off, and Wall Street was all in an uproar, Dr. Amaria says she got the Coles’ Notes version of it from her husband, presumably during one of those moments when she was not doing one of the many jobs she has at the moment. Maybe during one of the forced getting-outdoors breaks they take with their school-age children. Taking care of stress levels and mental health is something clinicians have to remember as well.
“I remind myself I need to take a dose of my own medicine in a way. In a week I might talk to 1,000 people about stress management, and share examples from my own life. It’s about recognizing that we’re all in it together, and we do really have to work on mental health. Nobody is immune – it doesn’t matter if you’re a psychologist or a therapist, taking care of your mental health is effortful, and we all have to do something.”
For some of us, doing something means reaching out to a friend, or taking a walk outside. For others, it might mean reaching out to Live Therapy from MindBeacon. Maybe doing something is as simple as learning something new. Like improving one’s ‘cooking skills’.
 Helen Ofosu
Helen OfosuDr. Helen Ofosu runs IO Advisory in Ottawa where she helps organizations and businesses tackle structural racism and promote equity, diversity, and inclusion. During the pandemic, more and more groups are looking for this kind of assistance and her business is growing.
Dr. Helen Ofosu
“There are certain people who, pre-pandemic, were super-productive and making amazing contributions at work. But because they weren’t bragging, buttering up the boss, or charismatic, they were overlooked. But now, when everyone’s at home, it’s easier to track who is contributing – who is sending in work product. So, all the “doers” are kind of getting their chance to shine.”
Dr. Helen Ofosu is writing a book. The working title is The Resilient Career, and will impart lessons she has learned over a 20 year career in Work and Business (Industrial/Organizational) Psychology. It will be a resource for people dealing with underemployment, harassment, workplace scapegoating, or being a newcomer to Canada trying to adapt to a new culture in the workplace. A lot of the book will be about employees’ identities, and how those tie into career progression, as well as some insights around the “glass cliff” phenomenon (i.e., women and racialized people being more likely than men to achieve leadership roles in an organization in times of crisis, when the chance of failure is much greater).
It may seem like writing a book during the COVID-19 lockdown is something a person with a lot of time on their hands would decide to do. That does not seem to be the case for Dr. Ofosu, who is an HR Consultant, Executive Coach, and Career Coach who runs I/O Advisory Services in Ottawa. Much like the employees she sees getting more recognition for the work they do during the pandemic, Dr. Ofosu is getting more recognition as well. The bulk of her clients were once in Ottawa, but now that Zoom is the de facto way to connect she is working with companies all over Canada, and sometimes the US and Saudi Arabia.
An additional reason for that branching out is the newfound focus companies are placing on systemic discrimination, anti-racist workplaces and restructuring their policies around equity, diversity, and inclusion. That happens to be Dr. Ofosu’s specialty – what she refers to as a ‘passion project’ turned full-fledged business line. This process is taking something of a different turn now as well, with the pandemic forcing this kind of coaching to be done at a distance. At the moment, this is mainly taking the form of mentorship and sponsorship programs for employees.
“My favourite model is one that I’ve been experimenting with and tweaking – it’s blending mentorship with allyship. At the same time that we train mentors to be more effective working with racialized people with whom they may not have a lot of experience, we’re also going to train a second group of people called ‘allies.’ These are people who may be senior and well-intentioned in the organization, but who don’t have the time to dedicate to either a one-on-one protégé or a small group of protégés. But they can still benefit from some training around systemic discrimination and what it means to be a good ally and mentor. They can then be out there in their organization as resources and influencers on more of an ad hoc basis.”
The mentors and the allies both receive the same kind of training – but while the allies tend to have giant workloads and full calendars and therefore less time to dedicate to this sort of thing, the mentors commit to six month or year-long programs where they check in with Dr. Ofosu regularly.
Mentors are ideally people in leadership positions in the organization. They are people with good ‘soft skills’ (e.g., communication, empathy, judgement, strategic thinking, etc.) and a genuine interest in supporting the career development of more junior employees. This way they will be more effective at imparting the lessons learned to the rest of their teams.
It was shortly after the death of George Floyd that a group in Toronto reached out to Dr. Ofosu, and it’s with this group that she has been developing the mentorship program as it stands today to support communication, marketing, and PR professionals in Canada. Now the federal government has caught wind, and she’s working with them to get this program launched there as well.
That likely means more work, which might also mean less time working on her book. But Dr. Ofosu will find the time, while still taking the occasional break. One of the perks of living in Ottawa is all that free time outdoors taking long walks and shoveling snow, where she puts on her headphones and listens to R&B, gospel, and hiphop music. Then she’ll come back in refreshed, ready to work on that book (with support from her American editor) and to get busy supporting leaders and dismantling structural racism at organizations across Canada.
 Maya Yampolsky
Maya YampolskyThe COVID-19 pandemic has made racism worse around the world for marginalized communities. Racism has made the pandemic worse for those communities as well. Dr. Maya Yampolsky specializes in social and cultural psychology, with a particular focus in her research on systemic racism and how racism enters into our personal lives.
Maya Yampolsky
In the spring of 2020, there was a COVID outbreak at a homeless shelter in Ottawa. The outbreak was traced back to two immigrant women who were both working at multiple long-term care homes in the city, and who lived at the homeless shelter. As new Canadians with few job prospects, personal support worker positions were some of the only jobs the two women could get. Those jobs paid so little that they were forced to work in more than one location in order to make enough money to live. Even then, they did not make enough to afford rent and so they had to live at the homeless shelter. It was a perfect storm of transmission as vulnerable people in one population brought the virus to vulnerable people in another. As many pointed out at the time, this was eminently predictable.
COVID-19 has had a disproportionately devastating effect on Black people, Indigenous people, immigrants and refugees. Pretty much anyone that has been disadvantaged by institutions and societies over generations are now even more vulnerable because of health inequities. Dr. Maya Yampolsky is an Assistant Professor in Psychology at Université Laval. She specializes in social and cultural psychology, with a particular focus in her research on the experience of managing multicultural and intersectional identities, and how those identities are related to our broader social relationships and broader social issues – especially systemic racism and how racism enters into our personal lives.
We’re speaking on Zoom, Dr. Yampolsky in her apartment in Quebec City, in front of a blank wall that I notice looks a lot like the hallway outside my high school gym. It turns out this is by design – an avid yoga practitioner, Dr. Yampolsky has been with a group call the Art of Living Foundation for about 20 years. They are an organization that promotes individual and community development through yoga and yogic philosophy. When teaching a course, Dr. Yampolsky prefers a neutral, blank background. That said, I get the sense that a yoga class with Maya would be an awful lot of fun. She is exuberant, cheerful, friendly and animated in a way that comes through even a Zoom screen. Even when the subjects we’re discussing are rather sombre and depressing compared to yoga. Subjects like COVID, and racism.
“A lot of research showed that Black Canadians of Caribbean origin or African origin, populations that are descendants of enslaved peoples from previous centuries, these groups have continuously been targeted. As a result there’s stress, and there’s illness that builds up in the body. So a lot more of these members of our population have chronic illness, which makes them more vulnerable to COVID, and to having a more intense experience with it. This means they have worse cases and a higher mortality.”
Around the world, Black, Indigenous, Hispanic and Southeast Asian people have felt the greatest impact from the pandemic. This is in part because of the stress that comes along with the continuous targeting Dr. Yampolsky speaks about, but also because those groups are the most likely to be essential workers. Frontline healthcare employees, people who work in long-term care facilities, areas that are more susceptible to exposure. Worse health outcomes, increased exposure, and more long-term neglect of marginalized communities have combined to create a storm during the pandemic.
“This isn’t overt racism, like hatred. But it is something that manifests from the existence of structural racism that creates inequalities that then come to the surface when a pandemic hits.”
Dr. Yampolsky, along with her colleagues Andrew Ryder, John Berry, and Saba Safdar, created the fact sheet ‘Why Does Culture Matter to COVID-19’ for the CPA. That fact sheet inspired a review article she is currently working on with Rebecca Bayeh (1st author) and Andrew Ryder (last and corresponding author). Every time culture and COVID is discussed, it takes Dr. Yampolsky and her colleagues in new directions. Racism is a big part of that. With the pandemic, one thing leapt out very early.
“The World Health Organization has said that we don’t name diseases after places. And yet, people kept insisting on calling this the China Virus or worse. From there we saw a lot of hate speech emerging, and there’s been a lot of hate crime. Here in cities like Toronto and Montreal, there were a lot of defacements of businesses and sacred spaces like Buddhist temples. Asian-Canadians and Asian people abroad, in the global diaspora, and people who looked phenotypically Asian (like Northeastern states in India) were being targeted as the source of the virus and being associated with disease.”
This is sadly not a new thing. We’ve seen this before many times, with virtually every epidemic and pandemic in human history (the 1918 influenza pandemic is still called the ‘Spanish flu’ today, even though the first reports of the outbreak were in Kansas, and no evidence suggests that Spain was particularly hard-hit or that outbreaks occurred there earlier than anywhere else).
Dr. Yampolsky explains that part of the reason for this is that the human brain has shortcuts wired into it to be able to avoid danger – we see disease and immediately try to determine the source of the danger, leading us to associate a virus with a whole group. But of course, it’s more complicated than just this. It wasn’t as though everything was great, and then suddenly the pandemic created more racism – there had been a steady rise in overt racism and hate groups leading up to the onset of COVID-19, a trend that was merely accelerated by the pandemic.
Racism has always existed, and it is always there among the public – the rise has been in overt, or as Dr. Yampolsky put it, “audacious” racism. Hate groups and far-right terror groups in North America and Europe have been more bold in sharing their vitriol publicly. Even some political actions have acted to exacerbate racial tensions. Dr. Yampolsky points to Bill-21 in Quebec, the law that bans people working in public services from wearing ‘religious symbols’ of any kind.
“Anything that essentially targets a minority group will also condone hate toward that group. By its very nature, it singles them out for discrimination. And we were seeing a lot of that already.”
Discrimination against virtually all minority groups has been amped up as a result of COVID-19, in large part because that discrimination was on the rise already. The advent of the pandemic became an excuse to further scapegoat those marginalized groups among those who were already trafficking in hate. These populations already tended to be more vulnerable than others because a history of systemic racism has set them up that way.
In the middle of this perfect storm, Dr. Yampolsky sees a silver lining, maybe a light at the end of the tunnel.
“Hopefully the fact that COVID happened, and then this latest big anti-racism movement – as far as I can tell, the biggest since the civil rights movement – in a way COVID facilitated drawing our attention to what was an existing situation. We weren’t going out, we weren’t being distracted, and so our attention was drawn towards anti-racism. This, positively, has yielded a lot more awareness about racism, and institutional valuing and awareness about racism as well. So that also gives me hope – in the sense that COVID showed us that we’re all connected, it also drew our attention to these things that needed repair, and needed work. I hope that it does end up building more responsible, more healthy, and happier connections with one another.”
There’s still a huge amount of work to do building those connections. To avoid another scenario like the one that happened in Ottawa in the spring, immigrants and refugees require greater supports. Personal support workers, and others we consider essential, require higher salaries. We also need to build ethical and cooperative interactions with Black and Indigenous peoples. There must be equitable and affordable housing for all. And the structural systems that create these conditions must be dismantled.
Dr. Maya Yampolsky is one of the people that will move us closer, as a society, to creating those connections. After an hour with her on Zoom, it’s almost impossible not to be inspired to get out there and start working on dismantling racist structures and historic disenfranchisement. And also, maybe even to sign up for her yoga class.
 Karen Blair
Karen BlairDr. Karen Blair and her colleagues created the ‘COVID-19 Interpersonal & Social Coping Study’ which surveyed hundreds of Canadians over several months. One of the most striking results they found was the impact of the pandemic on LGBTQ+ university students.
Karen Blair
“One student broke up with her girlfriend just as the pandemic began. She was sent home but wasn’t out to her family. So she was heartbroken, that young love heartbreak that totally guts you, but her family didn’t even know she was gay. And so she couldn’t be heartbroken in front of them. At the same time her brother was home, with his girlfriend stuck in another city. And so their parents were doting on him – empathetic and supportive of the poor moping brother, sad at being separated from his girlfriend. And she’s watching this knowing she can’t even tell them that she’s heartbroken, that she got dumped because of the pandemic.”
Dr. Karen Blair is an assistant professor of psychology at Trent University. She is also the Chair of the Sexual Orientation and Gender Identity Section of the CPA, and has been since 2014, a fairly long time to be the chair of a section. She says she’s likely to remain the Chair until at least 2022, as it would be a pretty big ask to get someone to take over virtually, in the middle of our current pandemic.
One of the things Dr. Blair has done during the pandemic is the ‘COVID-19 Interpersonal & Social Coping Study’. It was a large, ongoing survey of hundreds of Canadians on a variety of topics. It found as the pandemic progressed between May and July, Canadians wore masks more often and supported mandatory mask mandates more strongly.
Dr. Blair and her team also looked at Intimate Partner Violence (IPV), and found that the sample couples who had negative reactions to COVID-19 were at greater risk of perpetrating and being the victim of IPV. Their results found that married or common law couples are at greater risk for psychological IPV victimization; women and married or common law couples are at greater risk for psychological IPV perpetration; and younger individuals, parents, mixed-sex couples, and individuals in newer relationships are at greater risk for sexual IPV victimization.
They also looked specifically at Nova Scotians and how they were coping with the pandemic relative to other Canadians. Nova Scotians reported higher levels of social support, mental wellbeing, and medical help seeking behaviours. Nova Scotians also reported more engagement in WHO recommendations, feelings of competency to engage in social distancing and more positive attitudes toward mandatory mask regulations.
Part of the survey had participants writing notes to their past and future selves - one was a message to a past self, before the pandemic began. The other, a message to a future self several weeks later (see Courtney Gosselin profile).
Perhaps the biggest thing Dr. Blair and her team keyed on in the survey was LGBTQ+ university students who were dealing with the pandemic, home life, and distance learning.
When the first lockdown and stay-at-home orders came down way back in March of 2020, students from all over Canada were sent home from school. Accommodations were made for those who could not return home – those whose home was in a hot spot, like Italy. Or those who may not have been able to get back to Canada once they left for their home countries. But students whose needs could be met only on campus, like the LGBTQ+ population, were not considered.
Universities across Canada closed on March 13th. Students were, for the most part, given 24 hours notice that they would be moving back home. For LGBTQ+ students, that meant giving up the support systems they had cultivated at school – social groups, roommates, dorm communities and so on. It also meant that for many of them, they were going home to a place where there was simply no support at all. Everything else in the family might be fine, but for these kids there is a huge part of themselves that is having to hide.
“Parents were scrambling to get their kids home, kids were scrambling to move out. In all that chaos we never stopped to ask if we were sending closeted kids home to unaccepting families.”
In addition to the students who remain closeted at home, there are some who may have it even worse – their family knows, but is hostile about their orientation or identity. Which means they are being berated for it every day, stuck in a place they can’t escape, where the support system they’ve built outside the home is inaccessible.
Even virtual support becomes difficult for these students. Now stuck at home with a family that doesn’t accept their sexual orientation, or their gender identity, there is often not a place private enough to have that conversation over Zoom or Skype without the danger of a parent or sibling overhearing the discussion.
These youth, while experiencing all the same upheaval the rest of us went through with the pandemic, had this added layer of a difficult home life. Dr. Blair says this difficulty doesn’t tend to extend to adult LGBTQ+ people – the 30- or 40-year-olds who are settled and married.
“Someone asked me the other day how it has affected me, and I thought not really – I might actually be doing really well. I’m stuck at home with my wife… we’re both academics and often collaborate with each other so we’ve been able to be great supports to each other throughout the various lockdowns.”
Dr. Blair herself relocated during the pandemic to be closer to family. While her wife’s family is now within driving distance and they are only one flight (instead of two) from her own family, the pandemic has meant they haven’t been able to realize the benefits of seeing their families more despite living closer. But the fact that they both have families that want them to visit, and that are happy to be cooped up with one another, puts them in a place many of the university youth Dr. Blair speaks about can only dream of being.
One day, hopefully, those LGBTQ+ youth will get to that place. For now, they must navigate their way through a difficult school year, the same global pandemic with which we’re all dealing, and a certain kind of isolation and difficult home situation most of us won’t experience. What they are missing is a community, a peer group, and a support system. And someone with whom they can share their heartbreak.
 Courtney Gosselin
Courtney GosselinCourtney Gosselin was one of 25 students from Canada and the UK who worked on the COVID-19 Coping Study between March and August. Part of the study was letters people wrote to their past selves (pre-pandemic) and future selves (what they thought at the time would be post-pandemic).
Courtney Gosselin
“Find time for yourself, life will slow down, and that’s okay. Take time to learn lessons, take time to really appreciate everything. You are strong, creative and independent, which will all come in handy.”
- Anonymous, writing a note to their past self during the pandemic
Courtney Gosselin is a graduate student in clinical psychology at Acadia University. She’s doing her Masters-level research with Dr. Karen Blair and Dr. Diane Holmberg, and as COVID-19 has overwhelmed most of our lives, their research has moved in that direction as well. Dr. Blair and her colleagues embarked on a large-scale COVID-19 coping study. At the end of the survey, there were two questions – one was a message to a past self, before the pandemic began. The other, a message to a future self several weeks later.
The questions were inspired by a video made by Italian filmmaker Olmo Parenti called 10 Days Later. In the earliest part of the pandemic, when Italy was being hit harder than nearly any country in the world, Parenti asked Italians to record messages to themselves just ten days earlier – what did they wish they had known just ten days ago?
“What you might think is coming is not nearly what is coming. What is happening is much, much worse than what you thought it could be.”
- Anonymous Italian citizen, 10 Days Later video
The Italian 10 Days Later video was filmed in early March. At the time, it was intended to be a warning to the rest of the world. It was estimated that at the time, France and the United States were about 10 days behind where Italy was in the progression of COVID-19, and the hope was that people in those, and other countries, would see this and take the virus seriously.
When Courtney and her group began asking the two questions developed by Dr. Blair, it was much further into the pandemic. Like, a few weeks further into it, which in March and April was a fairly large passage of time in which an awful lot happened here in Canada. She and fellow Acadia student Abbey Miller developed a coding scheme to look at the more than 500 responses.
There was at least one person who advised their earlier self to “Buy Zoom shares, sell Air Canada, don't worry about toilet paper.”, but very few were so self-serving. What Courtney and her team were struck by was the overall tone of hope, the positivity, and the more optimistic and encouraging series of messages. Advice to take time for self-care, to slow down and enjoy the little things in life. The encouraging messages were ten times more common than the discouraging ones.
“This is a chance for you to connect with the part of yourself that thrives on solitude, thinking, listening to nature, watching the sun rise and set.”
While the messages to past selves were largely optimistic, the messages to future selves were a little different. A lot of them would fall into the category of “hey, self – is it over yet?” Says Dr. Blair, “none of us thought it would go on this long either. Now that we think about it, instead of asking them to write to themselves six weeks from now, we should also have asked them to write for six months, or a year, from now.” Some participants stayed in the study for four weeks, and often their future messages would be the same week in and week out – how are things NOW?
“As the world opens up, how do we cope with physical distance, the funerals that have been postponed and loss in general (not due to COVID sickness but impacted by its limitations)?”
Courtney and Dr. Blair say they would like to do another survey of this kind with a different set of questions to see if the optimism and hope that they saw back in March and April has remained. They would do it a little bit differently though, as logistically this one was a bit of a nightmare for their lab. Software, time zones, and other factors came into play and resulted in a group of students going into the lab almost every night to send out the surveys manually, from 6 pm in Newfoundland to 6 pm in BC.
It was, as a result, a very labour-intensive study to run. Especially for the students, like Courtney and the 24 others from Canada and the UK who worked on it between late March and early August. At the beginning, as the pandemic was just hitting Canada and the study was just beginning, they were running on adrenaline. The need to get something done, the need to find a way to help during the COVID-19 crisis, drove them to work longer hours and search for answers.
If they were to do it again now, would they have the same motivation? Would they feel the same urgency, almost a year into the pandemic? It’s tough to say – just as it’s tough to say whether the responses would have a similar tone today as they did back in April. As one participant said,
“Am I still being a positive person?”
 Jonathan N. Stea
Jonathan N. SteaThe proliferation of disinformation and misinformation online over the past few years has become more dangerous with the advent of the COVID-19 pandemic. Dr. Jonathan Stea, a clinical psychologist and an adjunct assistant professor at the University of Calgary, is one of two psychologists invited to join Science Up First, an initiative bringing together experts from every field to combat disinformation online.
Jonathan N. Stea
“That the outbreaks of Spanish influenza, which have given army officials some concern, may have been started by German agents who were put ashore from a submarine, was the belief expressed today by Lieut. Col. Phillip S. Doane, head of the Health and Sanitation Section of the Emergency Fleet Corporation. … 'It is quite possible that the epidemic was started by Huns sent ashore by Boche submarine commanders,’ he said. ‘We know that men have been ashore from German submarine boats, for they have been in New York and other places. It would be quite easy for one of these German agents to turn loose Spanish influenza germs in a theatre or some other place where large numbers of persons are assembled.’” (New York Times, ‘Think influenza came in U-boat’, September 19, 1918).
You can find that story on Page 11 of Dr. Steven Taylor’s book The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Conspiracy theories are nothing new. Conspiracies surrounding pandemics are nothing new. What has changed is the speed at which they are spread, and the maliciousness with which they are created.
Lieut. Col. Doane may have thought German U-Boat submariners were coming ashore to spread the flu in movie theatres, and his story was told to the New York Times. It was read by New Yorkers who may, or may not, have believed him. The fact that this opinion exists only in archival material and does not persist to this day, is indicative that either few people read it, few of them believed it, or both.
Lieut. Col. Doane’s theory was not posted to an 8-Chan thread, picked up by a Russian bot farm, posted to Facebook by sixty accounts, disseminated by dozens of questionable ‘news’ platforms, discovered by the President of the United States and tweeted to 90 million people, many of whom were eager to believe and spread the rumour.
This is where we live now, where disinformation and falsehoods can spread from one person to millions across the world in the blink of an eye. And in the time of a pandemic, this can be dangerous, destructive, and harmful in more ways than just fighting between friends and family members. It can put whole populations in greater danger than they need to be.
It is for this reason that scientists across Canada have come together to create the #ScienceUpFirst initiative. Dr. Jonathan N. Stea, a clinical psychologist and an adjunct assistant professor at the University of Calgary, is one of two psychologists who were asked to join the team. Along with Dr. Christine Chambers, Dr. Stea is providing his psychological expertise to combatting disinformation online – specifically, for , disinformation about COVID-19 and COVID-19 vaccines.
“It’s an ethical imperative for psychologists to promote evidence-based patient care and public health– so I’ve always been interested in things like pseudoscience and health-related misinformation. Calling that stuff out is one of our ethical imperatives.”
#ScienceUpFirst emerged from conversations between Timothy Caulfield, a professor of health, law, and policy at the University of Alberta, and Senator Stan Kutcher of Nova Scotia. Professor Caulfield has been researching online disinformation and how to debunk it for decades. Senator Kutcher, before becoming a senator, was the Department Head of Psychiatry at Dalhousie University. They got together to assemble a team of science communicators, epidemiologists, chemists, biologists, geneticists, bioethicists, infectious disease experts, and of course psychologists. Dr. Stea says,
“There is a lot that psychology can bring to the table. We’re trained extensively in science, we’re trained in critical thinking, and we’re trained to understand the ways in which we interpret information and the world more generally. I’ve personally applied these skills to communicate to the public through mainstream media channels, such as articles about tackling health-related misinformation, like how to address vaccine hesitancy and how to identify fake science news.”
This coalition of scientists is dedicated to debunking the misinformation that is out there now. They also want to do the same, as quickly as possible, after a new false narrative emerges online. And there are a lot of them – Bill Gates is microchipping you through vaccines, the numbers are being inflated to control people somehow, alternative medicine cures the virus, the list goes on. And on, and on, and on. Add to that the already loud and vocal anti-vaccination movement that predated the pandemic, and it looks like an uphill battle. But it’s one Dr. Stea is ready to wage.
“Science is an ever-evolving process, and sometimes there are disagreements between scientists. I think for the first time, science is being exposed to the public the way it has always been – as an iterative, evolving process. But for people who are unaware of that, sometimes it can be kind of jarring and it can leave people vulnerable to traps of misinformation. You’ll hear anecdotes, or testimonials on Facebook about how vaccines are extremely dangerous or how Bill Gates caused all this or something. And we want to take accurate, science-informed information and amplify that.”
The initiative is not just scientists railing against misinformation, it is designed for regular Canadians, and regular people around the world, to help amplify the message in the name of public health and protecting their communities.
Your brother-in-law posted online that the COVID-19 was engineered in a lab in China. Your former boss is constantly posting memes about the vaccine being unsafe and untested. Hank from high school is pretty convinced the virus itself is a hoax, meant to distract us all from Pizzagate. Go to #ScienceUpFirstFirst.com, the site that’s designed to help you in combatting these conspiracy theories and false information. They’re fully committed to this fight and want to provide you with the tools to join in as well so that you are not railing against misinformation alone.
Dr. Stea’s day job involves providing psychological treatment in a specialized interdisciplinary outpatient clinic for people who present with both substance use and psychiatric disorders. With the pandemic, he and his colleagues have helped people with these conditions adapt and cope with the additional stressful layer of COVID-related anxiety and uncertainty.. Social media, and the conspiracy theories it perpetuates, does not help. And the volume of these things is only increasing. And of course, that’s where Dr. Stea is spending a fair amount of his spare time.
In 1963, Republican Presidential candidate Barry Goldwater refused to distance himself from the John Birch Society, a powerful conservative group claiming that the bulk of the American congress, including President Eisenhower, were communist conspirators. Later the JBS would push the bogus claim that laetrile, a chemical compound found mostly in the seeds of apricots, was a cure for cancer. In 1964, Goldwater was defeated in one of the biggest landslides in American history, and the John Birch Society was forced out of respectable Republican circles
In 2019, Marjorie Taylor Greene voiced support for the theory that the school shooting at Marjorie Stoneman Douglas High School was a “false flag” attack. She also advanced the conspiracy theory that there was a video – though she hadn’t seen it herself because it does not exist – circulating on the “dark web” of Hillary Clinton cutting off a young girl’s face and wearing it herself as a mask while drinking that young girl’s blood. In November of 2020, Marjorie Taylor Greene was elected to Congress as a Republican Representative from Georgia.
Much of this, of course, stems from Donald Trump who was the biggest source of disinformation and conspiracy theories in the world. Disinformation about COVID-19 is estimated to have declined by 73% on Twitter since Trump had his account disconnected by the platform. And so now may be the perfect time to strike. If genuine science and fact can flood the internet at the same pace as false stories can be spread by trolls, then perhaps we have a chance to stem what the WHO calls a “global infodemic”.
It’s an uphill battle, but it is one that must be waged. Dr. Stea and his colleagues are ready to take it on – and they’re in it for the long haul.
To join the #ScienceUpFirst movement, follow @ScienceUpFirst on Twitter, Instagram, and Facebook, and please visit www.ScienceUpFirst.com to learn more.
 Adrienne Leslie-Toogood
Adrienne Leslie-ToogoodDr. Adrienne Leslie-Toogood works with elite athletes in Manitoba. When the pandemic hit, those athletes were spread out across the world, some unable to return home. In response, Dr. Leslie-Toogood launched the #TerrificTuesdays Zoom therapy sessions, a podcast, a book club, and much more to connect athletes across levels, disciplines, and the world.
Adrienne Leslie-Toogood
“I learned what it’s like to do something for the last time and now know that it’s not about doing it perfectly but about the privilege of getting to do it and staying connected to my why.”
- Leanne Taylor, Canadian paratriathlete, #TerrificTuesdays
Dr. Adrienne Leslie-Toogood is sitting on a Bosu ball during our Zoom chat. This suddenly seems like a pretty great idea – a way to maintain a little bit of physical fitness during that portion of our days when we are most sedentary in front of our computer cameras. This may not have been Dr. Leslie-Toogood’s motivation for choosing the Bosu ball – there is a perfectly serviceable office chair right next to her – but that chair has been commandeered by a rather presumptuous dog. The presence of a dog enhances any Zoom call, and so this is a perfectly acceptable arrangement.
The pandemic has forced us all to figure out acceptable arrangements, the kind we might not have imagined a year ago. Very often those new arrangements turn out to be positive, and sometimes they break new ground. Such is the case with Dr. Leslie-Toogood’s work, and with her clients, many of whom are elite athletes across Canada and, currently, around the world.
Usually, those athletes are in their own little bubbles (not the COVID kind of bubble, but rather a “hardcore athletes striving for the same goal” bubble). Olympic athletes rarely interact with NCAA divers. Top-level gymnasts don’t tend to run in the same circles as paratriathletes. Even within the Olympic community there’s little crossover between say, cyclists and water polo players. That is, until now – when Dr. Leslie-Toogood and her team initiated #TerrificTuesdays, to connect elite athletes from all different sports, and all different levels, to support one another during the pandemic.
This involves weekly Zoom calls with NCAA players whose seasons have been canceled, Olympic hopefuls who missed out on a chance of competing at Tokyo in 2020, internationally ranked table tennis players whose tournaments have been delayed time and again, and basketball players in a tight bubble in Europe where their teams are located.
Those calls have been extraordinarily productive, as elite athletes from all walks of life connect virtually over great distances and share their experiences and their wisdom with one another. Dr. Leslie-Toogood and her team collate some of that wisdom and share it on the Canadian Sport Centre Manitoba Twitter account, @cscmanitoba, under the hashtag #TerrificTuesdays.
“We are all trying to be excellent people, but the path to that excellence is unique.”
- Michelle Sawatzky-Koop, Canadian volleyball player, #TerrificTuesdays
The #TerrificTuesdays program started to invite in outside guests, like dieticians to provide cooking lessons. Before long, it was being replicated in other programs across Canada as the athletes involved found it so helpful and productive. Now an expert on Zoom technology, Dr. Leslie-Toogood decided to expand her technological prowess even further.
She started a podcast.
Heroes In Our Midst is available - on her website www.drtoogood.com and features interviews with dozens of incredible Olympic and Paralympic athletes, coaches, referees, athletic therapists and more. What Dr. Leslie-Toogood wanted to do was to tell the story about the human being behind the performance. She says, “sport is not about how fast you run but about who you become in the process of trying to run fast.” The podcast series is really about who these athletes have become, as much as it is about their sport and their process.
“I love the freedom you get from riding a bicycle. I’m free to go explore anywhere in the world, anywhere there’s a road. I can go to the mountains. I can go find beautiful places. I can go fast and push myself. I really just love cycling for that.”
- Leah Kirchmann, Olympic cyclist, Heroes in Our Midst
Then there’s a book club for athletes – one of the books they read was Win In The Dark by Joshua Medcalf. Dr. Leslie-Toogood says “for me it was a metaphor for the time. So many athletes are training without anyone watching, doing a lot of work in the dark”. Like everything else, a book club is a tool for conversation. There’s more, but at this point it would be easier to list everything she is not doing than everything she is doing!

It’s all about creating community and connection. Dr. Leslie-Toogood has connections with athletes all over Manitoba and the world, but until now those athletes had little connection with one another. Now they’re dealing with a devastating global pandemic, the postponement or loss of some of their dreams, and the struggle to stay motivated while isolated or in quarantine. But they’re not dealing with those things alone. They are connecting with others going through similar experiences and sharing their stories in an effort to help as many people as they can.
One hopes that when life returns to a semblance of normality, some of these things will remain. It would be great if #TerrificTuesdays stuck around, and if the podcast series continued (there is a second season planned for April, featuring people in other disciplines with whom Dr. Leslie-Toogood works as well. Firefighters, teachers, RCMP, and more). And who can’t get behind a good book club?
One thing that will almost certainly evolve before the pandemic ends, however, is the relationship between Dr. Leslie-Toogood, her assertive dog, her comfortable office chair and her less-comfortable Bosu ball.
@cscmanitoba – twitter handle #TerrificTuesdays
https://cscm.ca/ - Canadian Sport Centre Manitoba
https://drtoogood.com/heroes-in-our-midst/ - Podcast
 Andrew Ryder
Andrew RyderDr. Andrew Ryder helped prepare the Fact Sheet ‘Why Does Culture Matter to COVID-19’ for the CPA. An Associate Professor in the Psychology department at Concordia University, Dr. Ryder self-identifies as a ‘cultural-clinical’ psychologist, and the intersection of culture and the pandemic is in his wheelhouse.
Andrew Ryder
Why have some countries dealt with the COVID-19 so much better than others? How is it that others have fared so very, very badly? It’s not always as simple as good government vs. bad, or effective messaging vs. chaotic messaging. More often, it comes down to the people themselves. Do they tend to be rule-followers? Is there societal pressure to take public health seriously, and how do citizens of those countries respond to that pressure?
These are the type of questions that are of particular interest to Dr. Andrew Ryder. An Associate Professor and, currently, Associate Chair in the psychology department at Concordia University, Dr. Ryder self-identifies as a ‘cultural-clinical’ psychologist. His research is largely about how cultural context shapes mental illness like depression and anxiety. With COVID now, there are some new avenues to explore.
“I’ve turned my attention to whether culture may be involved in shaping physical illnesses, which we’re accustomed to seeing as strictly biological. Rather than retooling myself as a COVID-19 researcher, what I’ve been doing is applying the cultural-clinical framework to research that is being done by many of my colleagues.”
Of course, no country is a cultural monolith. Within every larger society are smaller cultural groups, each with their own ethno-cultural backgrounds, residing in different parts of the country and having different socio-economic statuses. And the difference between those groups in terms of combatting the pandemic can be stark, even within the borders of the same country. And on an even smaller scale, each individual within each community differs on their belief, approach, and conformity to the larger group ethos.
But let’s begin on the “macro” level – how might culture be involved in shaping physical illness?
“It’s an infectious disease, and an infectious disease that is socially transmitted. You have to get it from someone. Many of the things we are being told to stop the spread are behavioural. For example, wearing a mask. You might say ‘well that’s the same behaviour everywhere’, but it isn’t really. In Japan, Korea, Taiwan, it’s doing that thing you always do even when you just have the sniffles. For another cultural group it might be doing something absolutely novel.”
Then on the “meso” level – how might smaller cultural groups within those larger societies approach this?
“We know of some cultural groups where [mask-wearing] immediately seems like an imposition on liberty. Like there’s some kind of core cultural value that is violated by the government telling you to do something unusual. Your psychological state is different when you’re doing something that feels normal versus abnormal under the circumstances.”
What ends up happening, says Dr. Ryder, is that while we all feel like we’re doing the same things – mask wearing, social distancing – those things actually play out very differently for different people. He has spoken to some clients who were into the second week of lockdown before they even knew there was a lockdown. Computer programmers who lived in their basement and had their lives changed very little. Then there are others whose entire way of life was upended overnight.
So what, given the significant differences across cultures on a large scale and a small scale, should be done? Dr. Ryder co-authored a fact sheet for the CPA on Culture and COVID-19 with his colleagues Dr. Maya Yampolsky, Dr. John Berry, and Dr. Saba Safdar, that sought to answer that question. (‘Why Does Culture Matter to COVID-19’)
“An unprecedented number of people worldwide are concerned about the same disease and are experiencing broadly the same distancing measures. As such, there may be a temptation to focus on the similarities. At a minimum, policymakers, healthcare workers, and the public at large should keep in mind that the pandemic experience may be very different for different people. These differences are shaped by the society in which one lives, the communities of which one is a part, and culturally-shaped individual variations. Complicating matters, appreciation for difference does not mean treating all responses equally when it comes to effectively mitigating a pandemic. Clearly, some cultural patterns are more effective than others.”
Cultural differences seem to be enormous factors both in containing the spread of COVID-19 and in accelerating it. Some countries are doing exceptionally well, others not so much. And no one factor can determine why but Dr. Ryder points to a few factors. One is the “tightness” of a society, meaning the level of uniformity and narrowness in that society’s understanding and expectation is when it comes to rules, norms and customs. This seems to correlate directly with the degree to which that society accepts and implements public health guidelines. Another is “relational mobility”, which is a measure of how much people move around, and especially how much they move around between various social groups. This tends to correlate with the speed of the spread in those societies.
Never before has there been an event like the COVID-19 pandemic that can highlight the cultural differences in communities, cities, regions, and countries around the world, in terms of how they respond. For self-identified cultural-clinical psychologists like Dr. Ryder, that presents a whole new fascinating series of studies upon which to build his understanding and his work.
His attention is now turning toward cultural variations in how we will recover. Who will bounce back first, and who will bounce back better? How will the logistics of vaccines be handled, and how will those logistics intersect with public concerns about those vaccines? More than anything else, Dr. Ryder’s interest is in the long term. How effectively will different people in different societies respond to the crisis, learn from it, and be better prepared down the line for any future similar outbreaks?
Some of those questions are being answered right now, others will take some time before a larger picture emerges. In the meantime, each of us is fighting a devastating global disaster in our own way. It’s the difference in the ways each of us fight it that could be most illustrative in mitigating potential future damage the next time something like COVID-19 occurs.
 Ian Nicholson
Ian NicholsonDr. Ian Nicholson is the Manager for Psychology and Audiology at the London Health Sciences Centre (LHSC), and a former President of the CPA. As with most hospitals, the LHSC has had to change many of their practices since early 2020, including the way they deliver instruction as a teaching hospital.
Ian Nicholson
It is a tough time to work in a hospital. Hospitals are, of course, one of the first places to have felt the effects of the COVID-19 pandemic. Even those that are not currently nearing capacity are well aware that an increase in COVID-19 cases in their community could suddenly make beds scarce. Across Ontario, they are planning ahead for this by ensuring there are beds available, all the while dealing with patients in as safe a manner as possible and supporting vaccination clinics for the rest of the community.
London Health Sciences Centre (LHSC) is one of those hospitals. In addition to juggling advance planning, vaccination, and the safety of staff and patients, it has a few other balls in the air as well. An acute care teaching hospital, they have changed the way instruction is delivered across the board. They are also a children’s hospital, and provide a broad range of other physical and mental health acute care services, all of which have had to make major alterations as a result of COVID-19.
Much of this comes under the purview of Dr. Ian Nicholson, the Manager for Psychology and Audiology at LHSC. While COVID-19 in London was not, at the time we spoke, overwhelming the hospital and pushing it to capacity, LHSC was accepting patients from elsewhere in the province where the strain was more severe, and the possibility that such a thing could happen in London was always in the back of everyone’s mind. This means that Dr. Nicholson has to perform a delicate balancing act between keeping his staff safe, both physically and mentally, and providing psychological services to the patients that come through his hospital. Said Dr. Nicholson,
“The primary difficulty from a management standpoint is the balancing of the need to provide psychological services to patients in a way that is both safe to the patients as well as safe to staff. Given the broad ways in which psychologists work with patients in acute care hospitals, that means a broad range of strategies that have to be used to keep everybody safe during this pandemic.”
Those strategies are myriad, and most involve virtual technologies. Students who do not require work hours in a hospital to graduate are not going in. Psychology Residents are being trained to provide care virtually, often by teachers who are themselves just learning how to deliver virtual care. The supervision of residents and their educational activities are also being done virtually. The team of psychologists is still going into the hospital itself for work, but providing much of their expertise virtually, from offices elsewhere in the building.
Dr. Nicholson still goes in to the hospital every day. He gets screened at the front doors, just like the rest of the staff and the patients who enter the building. He spends the bulk of the day in his office, as he did before. The biggest change he sees in his own job is that he misses the casual discussions that would occur thanks to a chance meeting somewhere in the hospital – walking down the hallway, standing in the cafeteria line, those quick chats about a new idea or a new approach.
“In management, very often you have the meeting, but then you also have the chat before the meeting, or the meeting after the meeting to follow up on one of the items. Those things aren’t happening as much now. When you have these virtual meetings (we use WebEx at my hospital) there’s very little opportunity for schmoozing or chit-chat. This makes it more difficult to have the conversations you normally would around other things.”
Much like psychologists in other hospitals, one of the things Dr. Nicholson is seeing in staff is the impact this pandemic is having. Not that they are putting in longer hours than they normally do, but the added layers of protection mean that every procedure, every intake, is a little more difficult now. Constantly thinking about the pandemic takes its toll, as does being prepared for a wave that could come at any time. And, like elsewhere in the province, the pandemic is affecting both the home and work lives of all staff. Thankfully, he believes we are rounding this corner with something of a light at the end of the tunnel – a light that starts at the London Health Sciences Centre.
At the direction of the Government of Ontario, the hospital has set up a vaccination clinic, and they are vaccinating people as quickly as they can, as much as their supply allows. Based on direction from the Ministry of Health, the health units are prioritzing staff and residents of long-term care facilities, but are hoping that with more vaccine supply they can move on to the hospital staff and physicians shortly.
When the end of the pandemic does come, it will be thanks to the efforts of hospitals like London Health Sciences Centre. On that day, it will still be tough to work in a hospital. But rather than being the place where they watched the pandemic begin, they will be able to look at their workplace as the place where it began to end.
 Chelsea Moran
Chelsea MoranChelsea Moran is a PhD student in Clinical Psychology at the University of Calgary. Along with her supervisor Dr. Tavis Campbell, the bulk of her research has been about behavioural medicine – adherence to health behaviours. That research took a fortuitous turn when the pandemic began in early 2020.
Chelsea Moran
“People are more likely to adhere to physical distancing behaviours when their motivations were that they wanted to protect other people, and they wanted to protect themselves. That they want to contribute to the overall well-being of their community. Given that information, although we can’t say for sure, theoretically public health messaging that incorporates those pieces can increase adherence.”
Okay…neat. So public health messaging should focus on keeping the individual safe and keeping their community and everyone around them safe. Seems reasonable. But what is the alternative? What other messaging could there possibly be during a global pandemic if it isn’t to keep your friends and neighbours and yourself safe from the virus? It turns out there is a lot more nuance that that!
Chelsea Moran is a PhD student in Clinical Psychology at the University of Calgary. Along with her supervisor Dr. Tavis Campbell, the bulk of her research has been about behavioural medicine – adherence to health behaviours. Before March of 2020, that meant things like finding ways to promote physical activity and encourage sticking to medication regimens among people with chronic illnesses, like heart disease.
When the pandemic hit, Chelsea and Dr. Campbell thought that the work they had been doing on adherence to personal health behaviours could be applied to adherence to public health behaviours. What makes a person stick to a plan? What motivates them to continue doing the thing that will keep them alive? And how does that translate from the individual level to a community, public space?
Chelsea’s focus is now on the factors that promote adherence to COVID-19 public health guidelines, like physical distancing, mask wearing, and the like.
“We’re looking at individuals, and their day-to-day decision-making processes surrounding these things, and then using that to inform some of the wider public health campaigns that everyone is being exposed to.”
In their research, Chelsea, Dr. Campbell and collaborators Dr. Adina Coroiu and Professor Alan Geller discovered that adherence to physical distancing guidelines was motivated by two main factors. In a survey of more than 2,000 people globally, they found that the desire to protect oneself and the desire to protect other people were (surprisingly to the researchers) almost equally motivating factors.
So back to the messaging. Showing people that wearing a mask and sticking to a tight bubble keeps them, and other people, safer seems to be the way to go. This messaging can work. But what are the alternative messages? What might the media, public health officials, and politicians be saying that doesn’t work? What other message IS there?
What Chelsea has been seeing, and what Dr. Campbell has been showing in some of his own work, is that much of the public messaging can sometimes have a fear-based component. There’s a big difference, as Chelsea points out, between a message that says, “wearing a mask makes you less likely to infect your neighbour”, and “not wearing a mask could kill your neighbour”. The message often is that if the guidelines are not followed, the cases will go up and there will be more death as a result.
While fear can be a motivating factor in the short term, in the long term it doesn’t help. This is true of individual health behaviours as well. It’s much easier to get someone to be healthier by emphasizing the positive benefits to their well-being that come from exercise, rather than telling them “if you don’t exercise you will have a heart attack”.
Another thing Chelsea, Dr. Campbell and their team discovered in their survey was one of the sources of motivation to break the rules – to go against public health guidelines. It wasn’t surprising, but it was good to have it quantified in data, that loneliness was a significant factor in people eschewing physical distancing rules. Chelsea lives alone, and she has been feeling that loneliness as well. Her family is in Ottawa, her partner is in Toronto, and while they connect on Zoom and Skype and FaceTime and all that, it’s tough not to feel a little disconnected.
Chelsea’s practicum placement is at a hospital – one in which she has never set foot since she provides clinical services virtually or over the phone. She has met her clinical supervisor in person once, in September. Chelsea has to stay in Alberta, because that’s one of the provincial rules – even virtually, you must physically BE in Alberta to see clients in Alberta. And so she does. She says she’s grateful for the way the University of Calgary has made online learning accessible so quickly, and once she’s done,she may move to Toronto to be with her partner. For now, they make do.
“We have a standing phone date. He has about an hour commute on the way home from work, so we connect over the phone, catch up, and debrief on how our days went. And then FaceTime and Zoom are good because they provide that visual feedback, the non-verbal support from people.”
Chelsea is staying put. As a trainee, she’s seeing people via virtual platforms, doing school online, and generally coping with a solitary existence for the time being. She wants to keep herself safe, and wants those around her to stay safe as well. That motivation thing is really working!
 Gabrielle Pagé
Gabrielle PagéDr. Gabrielle Pagé works with people experiencing chronic pain. During the COVID-19 pandemic, she and her team have had to pivot to a number of different forms of care. They have discovered some expected results among those suffering from chronic pain, but also some real surprises.
Gabrielle Pagé
“Chronic pain has always been one of the more neglected areas within the health care system. Within the context of the pandemic, we didn’t expect that to improve – rather, the opposite.”
Dr. Gabrielle Pagé is an assistant professor in the Department of Anesthesiology and Pain Medicine at the Université de Montréal. She is also a clinical psychologist working out of the Montreal General Hospital specializing in chronic pain conditions. When COVID-19 struck, Dr. Pagé and her team decided now was the time to move more toward an advocacy role, to inform the public about chronic pain, and to make this a larger part of the overall health care discussion.
They began by launching a Canada-wide survey of people experiencing chronic pain, and found out that over the first few weeks of the pandemic and the lockdown, 2/3 of them reported that their pain was getting worse. This was in April-May, right as the first wave was rising across all provinces. The idea that most people’s chronic pain would get worse at this time was an expected result given the magnified difficulties to access pain treatment, increased stress and social isolation.
What was less expected – and almost shocking for Dr. Pagé and her team – was that a small group, 5-10% of respondents, actually reported that their pain had been lessened during this time.
Stress is a big predictor of the severity of chronic pain. When patients are stressed out, they experience more pain – more pain leads to more stress, which leads to…well, you get the idea. So it was very surprising that such a large number of people reported an improvement. Maybe they were going for walks, taking the time to connect with family members, or were laid off from a job that had been causing the bulk of their stress. Dr. Pagé can’t say what the cause is, or was, but she is determined to find out.
As I’m speaking with Dr. Pagé, her team is wrapping up a follow-up study to the one they conducted in May. Will the outcomes be similar, or will something new present itself? They should know soon enough. Also, as we’re speaking, Montreal is entering Day One of the big winter lockdown. Curfews in place, all non-essential businesses closed, and the multidisciplinary pain clinic in the Montreal General Hospital is deciding how to move forward.
Dr. Pagé’s clients, for the most part, have been receptive to virtual therapy. Even the group therapy programs which were a concern seem to have adapted well.
“The social bond, the connection that they make and just being around other people who get what it’s like to have pain every day, is one of the central elements of group psychotherapy in chronic pain. So we were wondering how that would translate into a virtual format, being able to see people only through a screen. We’re doing a qualitative research study around this. And while it’s very preliminary, so far it appears that the screen is not a barrier for them to create bonds between one another.”
Because of the nature of the work, however, many of Dr. Pagé’s clients either don’t have access to computers, phones, or tablets – or are unable to use them. For this reason, the clinic has moved to a more hybrid form of care. Group sessions and many individual meetings are still conducted online, but for those who are unable, or uncomfortable doing so, the clinic remains open for in-person masked and distanced visits. While it`s great to be able to offer this service, it`s quite a challenge to demonstrate presence and empathy during therapy through a mask and face shield!
This means Dr. Pagé still goes into the hospital, in one of Canada’s COVID hotspots. She gets screened for symptoms at the door goes through the protocols every time and then she goes home to an 8-year-old who is, at the time of this writing, doing virtual schooling, and a 4-year-old boy going to daycare.
It can be a demanding situation. Thankfully, Dr. Pagé does not experience chronic pain herself. But she is doing everything she can to collect data and get the message out. It’s stressful to have pain. And it`s painful to be stressed. There is a vicious cycle there, and one that is under-recognized in the overall health care system. A system that is starting to realize, more than ever before, where all those gaps lie.
 Jenn Gordon
Jenn GordonDr. Jenn Gordon is an associate professor at the University of Regina, and a Canada Research Chair in the bio-psychosocial determinants of women’s mental health. A study she conducted at the beginning of the pandemic identified a major gap in how women in academia were faring during the pandemic compared to their male counterparts, especially among those with young children.
Jenn Gordon
The pandemic, and the resulting lockdown, has not affected everyone equally. This is true across nearly every demographic, including the most highly educated among us. In a survey of almost 1,000 academic faculty members, it was found that parents of young children were less productive and worse off all around – especially, and most significantly, women who were parents of those young children. Women like Dr. Jenn Gordon.
Dr. Gordon is an associate professor at the University of Regina, and a Canada Research Chair in the bio-psychosocial determinants of women’s mental health. She is also the mom of three very young children. Her husband is an accountant. That meant that when the pandemic first started, causing lockdowns back in March of 2020, Dr. Gordon’s husband was in the thick of a suddenly more complicated tax season.
With her husband working long hours preparing taxes, their children gravitated toward Mom – even though Mom had a huge amount of work to do herself. In addition to her work with the University of Regina, the research she does on the effects of estrogen on the mood of menopausal women, and her work with the Women’s Mental Health Research Unit, Dr. Gordon is also the editor for the Health Psychology and Behavioural Medicine newsletter at the CPA. It was the section newsletter that sparked the idea for this study.
Dr. Gordon and Dr. Justin Presseau, the Chair of the Health Psychology and Behavioural Medicine Section, were discussing article ideas for the newsletter. Dr. Gordon says,
“I suggested a piece that talked about academics, and the tough time that faculty are having. Particularly around parenthood, and juggling having kids at home while working and that sort of thing. [Dr. Presseau] suggested that instead of just a piece, why don’t we survey profs across Canada and ask how they’re doing. So we did.”
Almost 1,000 professors responded to the survey, and many of the results were as expected. Most experienced a decrease in work satisfaction, in productivity and publications and grant submissions – with data collection being totally on hold at that time. What was more surprising however, was the size of the gap in those areas between academic faculty who had kids under the age of 13, and everybody else. And then the even bigger gap between men and women who were parents to those young children.
Women were worse off compared to men. Fewer grant submissions, fewer first-author publications, and an ever-widening gap in work satisfaction. Dr. Gordon acknowledges that this survey represents only a slice in time, a snapshot of where we were when the pandemic and the lockdowns began. A follow-up study is in the works, to see whether these effects diminished over time or increased. Her situation today hearkens back to concerns Dr. Gordon had when she first decided to become a researcher several years ago – the idea of work-life balance.
“Could I have a family if I was a researcher, would I have to give up my life? I was always flip-flopping, but over time I decided that I really love research, and the choice became clear.”
While she found that work-life balance soon after embarking on a career in research, specifically research into hormone levels and estrogen levels and how they affect the mood of menopausal women, the pandemic has altered that balance significantly – both for the participants in her survey, and for Dr. Gordon herself. But it has also provided her with an interesting, and timely, research study that, depending on how long the pandemic lasts, might produce more studies down the road on academic faculty, gender disparities, and work-life balance for parents of young kids. Parents like Jenn herself.
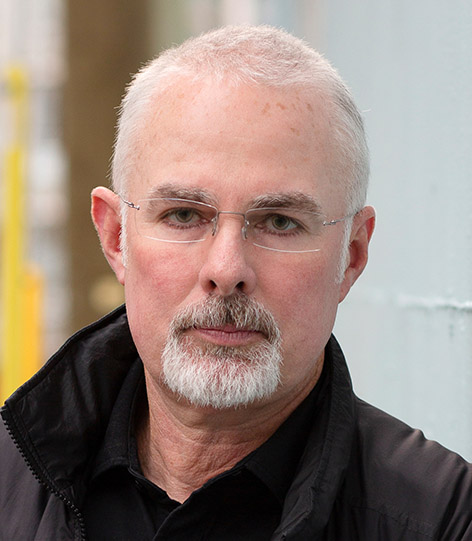 Steven Taylor
Steven TaylorWe kick off Psychology Month 2021, Psychology And COVID, with a profile of Dr. Steven Taylor. Dr. Taylor’s book ‘The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease’ was published in October of 2019
Steven Taylor
“I knew a pandemic was coming, we all did. But I didn’t think it would be quite so soon.”
When Dr. Steven Taylor says “we all” knew a pandemic was coming, he means infectious disease experts, world health authorities, epidemiologists and mathematical modelers - and psychologists like him, who work in this space. He does not mean the rest of us – the general public who were, for the most part, blissfully unaware that such a global disaster was looming. Those of us who thought of pandemics and epidemics as something that devastated one part of the world while staying mostly contained to that region. Ebola, SARS, H1N1 – we’ve lived through those and, as regular Canadians, they haven’t changed our lives a whole lot.

This time, the pandemic has changed our lives. And although he saw it coming, Dr. Taylor was not exempt from the disruption. Of course clinical work, teaching, research, and interviews have all been moved online. This is something for which Dr. Taylor’s unit was better prepared than some others – but it is his leisure time passion that may have taken the biggest hit. He loves scuba diving and super-macro photography. In December, when news of the pandemic first broke in Wuhan, he was in the Galapagos taking extreme close-up portrait photos of colourful sea slugs and other marine life. Thankfully, there is some interesting marine life to photograph off the coast of BC, but those opportunities are understandably fewer and farther between than they once were.

Dr. Taylor’s initial publisher was one of us regular people in the sense that they thought of a global pandemic as an ethereal, far-off concept. When he wrote his book The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease, his American publisher rejected it. Who wants to hear about some unlikely hypothetical catastrophe anyway? Thankfully, a second publisher thought there was some value there and agreed to publish the book. It came out in October. Of 2019.
It is the first comprehensive look at the psychology behind every aspect of a pandemic. The initial public response. Panic buying. Conspiracy theories and xenophobia. Adherence to, or refusal to follow, public health guidelines.
“What really surprised me was that all the phenomena that had been described previously unfolded almost like clockwork throughout 2020. It’s one thing to synthesize the historical literature and say X, Y, and Z are what happens – it’s a completely different thing to see those things happening in real time. That’s the astonishing thing for me – that everything that has happened before is happening during this pandemic, except on a grander scale and faster.”
Dr. Taylor points to the 24-hour news cycle, social media, and the fact that we are all digitally interconnected as the reasons for the acceleration in behaviours humanity has seen before. There was a major backlash against a public mandate to wear masks back in 1918 during the so-called ‘Spanish Flu’ outbreak. There were conspiracy theories during a Zika virus epidemic a few years ago that never really went away, and are being recycled today as the conspiracy theories we see pop up on our Facebook timelines related to COVID. All that was old is new again.
“There’s a very interesting article from the New York Times in 1918 where they cited one of the health authorities. He thought there was some credence to the theory that the ‘Spanish Flu’ was being caused by German U-Boat submariners coming to shore in Manhattan, getting out of their U-Boats, and going into cinemas to spread germs.”
It is stories like this, and interviews with epidemiologists and disease modelers, that convinced Dr. Taylor that The Psychology of Pandemics was an important endeavour. Those interviews, and those stories, resurfaced in 2018 with the centenary of the 1918 flu pandemic. As he absorbed those stories he realized that a plurality of infectious disease experts believed that there would be a global pandemic within the decade. And that it would be a flu, likely caused by a corona virus. Dr. Taylor also recognized that there was a surprising lack of psychological literature on the subject.
“It’s all psychological. Psychology is essential to the spread of these diseases – that is, people choosing to travel – and also essential to containment, because all containment measures require people to do agree to do stuff. Agree to wash your hands, to cover your cough, to get vaccinated, to wear a mask, to maintain physical distancing.”
Dr. Taylor and his team have, of course, been staggeringly busy since the first mention of the virus in Wuhan, and have been studying the psychology of COVID-19, specifically, since December. They have published 6 or 8 papers, and have another 5 or 6 under review (it’s tough to remember exact numbers when you’re doing so many!)
“There has been more research conducted on pandemics in the past 12 months than has been conducted for all other pandemics in the history of human existence.”
There is now enough material for a second Psychology of Pandemics book, describing how all the phenomena we see are interconnected. From vaccination non-adherence, to mask rebellion, to disregard for distancing, to COVID-related emotional distress, excess alcohol consumption, and general coping during lockdown. None of which is particularly new, but all of which has a new context and better data and can build on the historical findings laid out in the first volume.
Dr. Taylor believes that people are resilient, and that we are not going to be wearing masks for the rest of our lives or becoming germophobes. We will one day get back to doing the things we love to do, even though that is likely to come too late for him to take his scheduled scuba diving trip in South Africa in June.
There will, however, be another global pandemic. Hopefully it is decades away, and not two months after the release of Volume 2 of The Psychology of Pandemics. But when it does arrive, we will be better equipped, as global citizens, to handle it. We’ll be more prepared thanks to the work Dr. Taylor did putting together the historical information last year, and the work he and his team are doing to learn everything they can this year.
Will the follow-up book be called The Psychology of Pandemics Volume Two: I Told You So? Almost certainly not. But it could be.

Throughout Psychology Month we will be highlighting people with psychology degrees working outside clinical settings and academia. We are going to profile magazine editors, aviation specialists, bankers working in people analytics, and much more #PsychologyAtWork
Psychology Month Profile: Meghan Norris – The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science
 Meghan Norris: The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science
Meghan Norris: The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science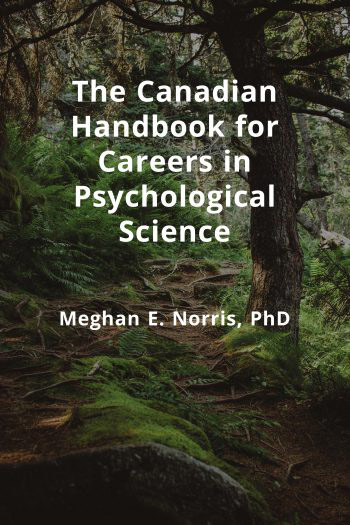
We’re closing out Psychology Month by connecting you with a resource that could help you with one of the career paths you may have read about in February. Dr. Meghan Norris’ open-source book The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science.
Meghan Norris – The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science
Throughout Psychology Month (February) we have been highlighting people who have completed advanced psychology degrees and gone on to work in a field outside clinical practice and academia. Some work in the aviation industry, like Marais Bester or Gregory Craig. Others are business owners, like Susan Underhill and Lauren Florko. And still more are government scientists, like Natalie Jones and Chrissy Chubala.
Part of this campaign has been designed to show people in general what psychology is, and what people trained in the discipline do all around us. Another goal has been to show students what a wealth of possibilities await at the end of a psychology degree. It is in this pursuit that our campaign has intersected with that of Dr. Meghan Norris, a social psychologist and the undergraduate chair in psychology at Queens University.
Meghan has created an open-source (FREE online) book, The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science. It is a guide for psychology students featuring all the things she wishes she had known as a psychology student herself. This begins with obvious practical advice for the job-seeking student. The best way to construct an email, leave a voicemail, or ask for a letter of reference. It moves on to things that might not be top-of-mind. How to dress at a conference. Where to wear your nametag. Which plate is which at a formal dinner setting. And how to practice holding food in your left hand at a reception so your right is free for shaking hands.
The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science contains a lot of information about the possible career paths open to those with a background in psychology. There is a list in the first chapter of all the skills upon which employers are currently placing a premium. They include skills related to leadership, teamwork, communication (written and oral), problem-solving, work ethic, initiative, adaptability, and analytic and technical skills. All areas where Meghan realized psychology students tend to tick all the boxes.
There are some practical and specific job possibilities included in the book, the way we’ve included them in our Psychology Month campaign. Community mental health worker (like Evangeline Danseco), grassroots organizer (like Amanda Parriag), community development (like Troy Forcier), program or project director (like Alexandra Thompson), policy analyst (like Natalie Jones), the list goes on and on. But it does more than that. The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science is designed a little more like a roadmap.
As Meghan says, the earlier students start thinking about this stuff, the more opportunities they’re going to have. The work of career development is incredibly important, but it doesn’t tend to feel urgent for people. You can’t start networking a week before submitting a job application. Chipping away at small healthy behaviours when it comes to a career is a good thing to do as early as you can. And once you have started down the path to an education in psychology, a world of possibilities awaits.
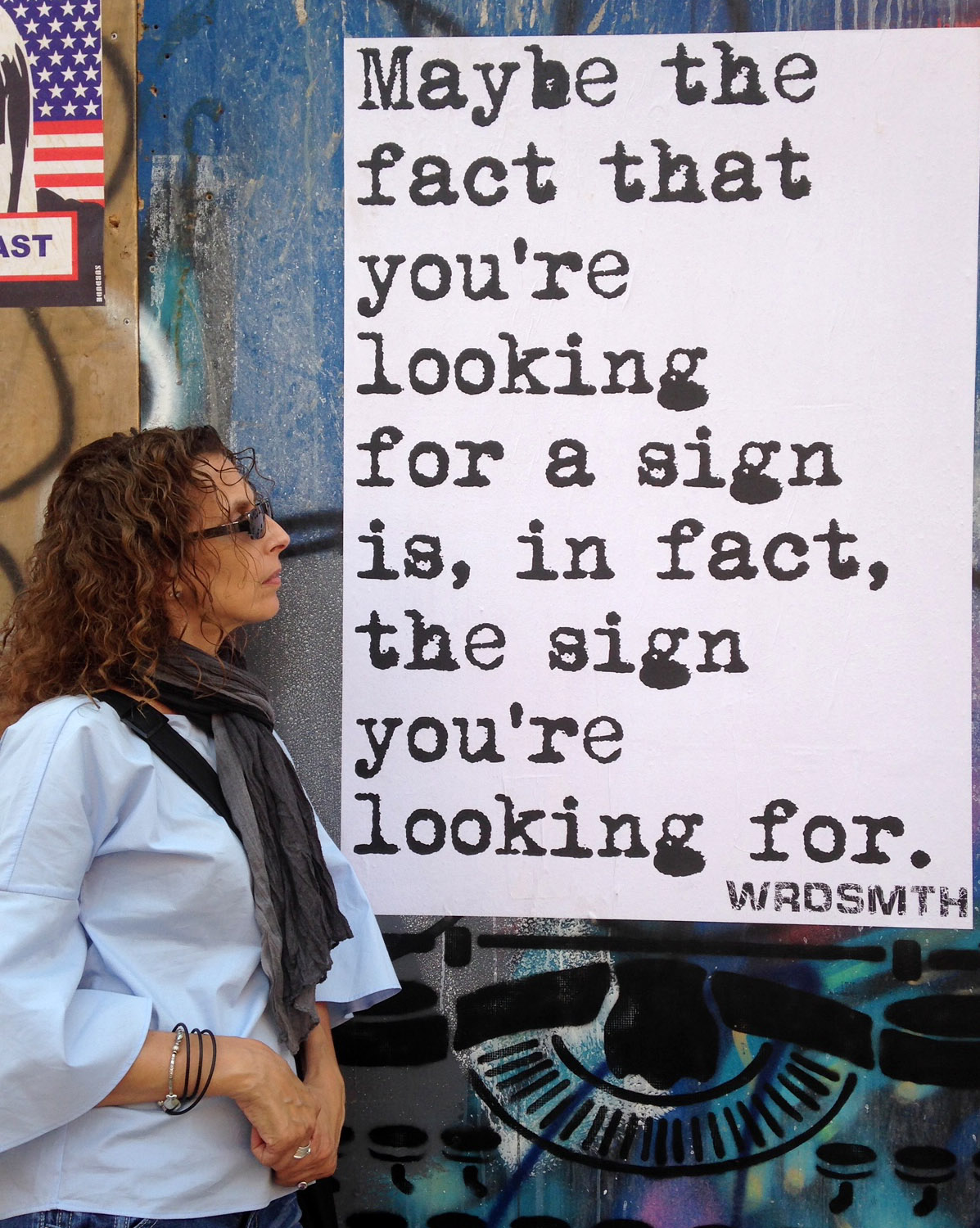 Leanna Verrucci
Leanna VerrucciThe Director of Marketing and Membership at the Canadian Psychological Association, Leanna Verrucci’s background in psychology has led her to jobs in TV, newspapers, travel, entrepreneurship, and now the CPA.
Leanna Verrucci
Leanna has a Master’s in Child Development from Carleton University, and that degree has carried her all over the world, from Toronto to Ottawa and then back to Toronto and then Ottawa. With quite a bit of time in Tuscany tucked in the middle. Leanna is the Director of Marketing and Membership at the Canadian Psychological Association, but her journey to get here has taken many turns.
She has worked in television, as a field producer and reporter for CBC TV and other stations. She started Food & Leisure newspaper here in Ottawa back in the 90s before selling it. She has been a hiking and biking guide, a communications professor, and the Director of Bespoke Travel. There were also stints as a Marketing Manager, a Senior Brand Manager, a Communications Director and, more recently, the Managing Director of Innovation and Entrepreneurship at Algonquin College.
It’s a lengthy resume, and it’s probably longer but I couldn’t be bothered clicking ‘next page’ on LinkedIn. I had just one question for Leanna – how does all this tie together, and how did psychology play a role?
“The one through-line in all my work has been communications. In television, newspapers, travel, and marketing it all really is about communication. In addition to learning how to do research and gather and analyze data, the main thing psychology taught me was how to speak to people, how to listen to them, and the right questions to ask. It’s important as a manager to know what motivates each individual, and how to play to their strengths.”
In the time she has been at the CPA, Leanna has built a cohesive and complimentary team. Yussra, with her sharp analytic mind and quiet persona. Kathryn, who has terrific people skills and a gregarious demeanour. I’m probably good at some stuff too. And, of course, Leanna - who holds it all together with spreadsheets, forward thinking, and strategic plans that make our lives easier and create an environment in which we enjoy coming to work every day.
 Leigh Greiner
Leigh GreinerAs the Director of Research and Strategic Planning for BC Corrections, Dr. Leigh Greiner leads a multi-disciplinary staff on a huge variety of evaluations, assessments, and projects.
Leigh Greiner
When she was in school, completing her PhD in Forensic Psychology at Carleton University, Dr. Leigh Greiner learned from experts in psychopathy, risk assessment, female offenders, sex offenders, youthful offenders, and more. All were areas of interest then, and all remain relevant to Leigh now as the Director of Research and Strategic Planning for BC Corrections. She leads a talented and diverse multi-disciplinary staff with backgrounds in mathematics, criminology, education, and many other disciplines.
“My education gave me a solid understanding of so many areas of forensic psychology, including where the field has been and where it’s going, and evidence-based practice more broadly in Corrections. As my role touches so many aspects of our business, this breadth of knowledge has been so useful, as have the relationships I built while completing my degrees—many of these relationships I have maintained in my current role and are people with whom I continue to work collaboratively today!”
Day to day, Leigh and her team are responsible for examining the effectiveness of correctional programs, assessing the need for new jails, providing data to inform policy or practice decisions, working to improve the quality and usefulness of the organization’s data, providing research expertise when developing new correctional programs…and the list goes on. Their portfolio is extremely large, and they are rarely left twiddling their thumbs.
It’s the variety that Leigh enjoys most.
“Every day is different, and each day brings new problems to dissect and analyze… and hopefully solve! I’ll admit that at times it can be challenging to juggle all the various demands placed on our unit, as we support the research and data needs of the entire branch. However, being part of an organization that values evidence and wants to make decisions based on data really makes my job easy. Being able to see the impact our work has on the organization and, though less directly, on the individuals in custody and those under community supervision makes the job very fulfilling.”
A wide scope of knowledge is great preparation for a wide scope of responsibilities. And in BC, from evaluating programs designed to help offenders to change their behaviour, to determining how effective body scanners are at detecting contraband, Leigh and her team are right in the thick of it.
 Marais Bester
Marais BesterIn the growing field of Aviation Psychology, PhD psychologists are increasingly being hired to help keep air travel safe. One of them is Dr. Marais Bester, a Manager of Assessments and Psychology at Qatar Airways.
Marais Bester
Despite some tragic news stories in the past few years, air travel remains the safest mode of mass transportation. It can seem otherwise, as plane crashes make the news far more often than motorcycle accidents and sinking boats. But a lot goes into putting planes in the air, and just as much effort goes into keeping people safe while they’re up there.
A lot of those safety protocols are the purview of a rapidly-growing discipline, that of aviation psychology. Dr. Marais Bester has been in that field for more than five years, since graduating with a PhD in Industrial Psychology from the University of South Africa. Seven months ago, he moved from Dubai to Qatar to become a Manager of Assessments and Psychology at Qatar Airways.
Working with a team of two other Industrial/Organizational Psychology PhDs, Marais is responsible for ensuring that the personnel operating Qatar Airways aircraft are healthy, supported, and working well with their teams. This begins with psychometrics for talent acquisition (the job interview process) and continues through talent development (workshops, trust, resilience and team building).
Pilots must be resilient and cope well with pressure. They also must be one of those rare individuals who are both meticulous rule followers and are able to think on their feet and act very quickly. The cabin crew must be open to diversity and embrace new experiences, and have a high aptitude for teamwork and cooperation.
Like the employees with whom he works, Marais is always learning and changing at his own job. He is implementing best practices and creating new standards all the time. He maintains membership in the British Psychological Society and the European Association for Aviation Psychology (EAAP), to connect with like-minded people in this quickly growing field.
After a tragic incident in 2015 when a German co-pilot took his own life, and the lives of his passengers with him, the International Air Transportation Association (IATA) has required airlines to have psychologists on staff. This is one of the reasons the field is growing so quickly around the world, which Marais thinks is wonderful – after all, it will make air travel even safer than it already is. He quotes Richard Branson:
“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.”
So Marais and his team take care of their employees, through career facilitation and coaching, career guidance, psychometrics and team building. And in doing so they are not only helping those pilots and crew members in their lives, they are helping to make the skies safer for all of us.
 Natalie Jones
Natalie JonesA Senior Program Evaluation Officer with the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), Dr. Natalie Jones says her colleagues and fellow researchers are the highlight of her job.
Natalie Jones
Dr. Natalie Jennifer Jones wears many hats. Singer-songwriter, perpetual learner, yoga enthusiast, cat person. Today though, we’re going to talk about just one of those hats. The one she wears as a Senior Program Evaluation Officer with the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).
What this means is that she is part of a team that examines the effectiveness and the efficiency of federal granting programs. They determine whether these funding programs are achieving the goals they were designed to achieve. They go into the field to interview the recipients of those grants, they do data analysis, and a vast range of other things on any given day.
(A note for those who are looking to obtain SSHRC grants – Natalie has nothing to do with that process. So buttering her up will not help you achieve this goal. That said, if you want to ingratiate yourself to Natalie for any other reason, volunteer at a cat rescue.)
Natalie completed her PhD in Forensic Psychology at Carleton, and SSHRC was not on her radar as a career option. And while she acknowledges that the job she’s currently doing is outside her area of study from a content perspective, she says,
“All of the research skills, and core analytical skills, that I developed in grad school are highly transferable to my current work environment. Everything from research design to quantitative methods, those are skills that I use every day. So there’s actually a lot of overlap – it’s really interesting, and I love working there.”
Many of us can attest that our co-workers make all the difference in whether we like our job or dread going to work. And so it is with Natalie, whose favourite thing about SSHRC is her colleagues. Half of them work with Natural Science and Engineering Research Canada (NSERC), as theirs is a joint evaluation division with SSHRC. Many have psychology backgrounds just like she does, and many have a background in a wide variety of other scientific fields. They all work together toward a common goal.
“It’s really important to have a group of colleagues that you get along with and that you respect. They’re all very good at what they do – a lot of attention to detail and they care about quality. We’re very like-minded in that way. I’m proud to call them my friends. We help each other out professionally, but I know they always have my back in my personal life as well.”
That personal life is as busy for Natalie as her professional life. Her hobbies include: enrolling in a 16-month graduate diploma program in Public Policy and Program Evaluation, which she completed this past December. She suspects that she will still be enrolling in classes and continuing to learn well into her 80s. She’s involved with cat rescue charities, and planning to get back on stage at her local cafés as a singer-songwriter. It’s a safe bet that when she does, the first three or four tables will be packed with scientists and researchers from SSHRC and NSERC. Natalie’s co-workers and friends, both in the lab and out.
 Jen Welter
Jen WelterDr. Jen Welter is many things – the first woman to coach in the NFL, and the first to play running back in professional football. An author, speaker, TV producer and fashion designer. And also a PhD psychologist.
Jen Welter
For much of Psychology Month, we have been putting the spotlight on one job at a time, showcasing the variety of careers populated by people who have advanced degrees in psychology. But what if you didn’t have to pick just one thing? What if you could use your psychology PhD to do everything? Dr. Jen Welter is doing as many things with her psychology PhD (from Capella University) as she possibly can.
She runs girls-only football camps, as well as football-and-tech camps called KickGlass with her partner Mike Brown (former NFL player turned tech entrepreneur). She’s just coming back from being the keynote speaker at VISA’s pitch competition for female founders doing great things in technology and commerce during New York Fashion Week. She’s working on a project with Ryerson University’s Experiential Sports Lab to reach for gender equality in sports media. She’s the executive producer of a TV show called Fangirl, set to debut soon about two superfans who get a chance to run their favourite college football team. She’s even talking about collaborating on a project with high-fashion designer Vivienne Hu, something more street-savvy than high-end.
Before getting to this point, Jen did a whole lot more. Things no one else had ever done, and that most would never consider doing. She was the first female professional football player in a contact position (running back for the Texas Revolution of the Champions Indoor Football League). The first female head football coach in international competition (Team Australia for the 2017 World Championships). And the first female coach in the NFL (2015 with the Arizona Cardinals). She also played on Team USA twice at the world championships, winning gold medals in both 2010 and 2013 (both times defeating Canada).
She tells us that her psychology training and background has come into play throughout all of this. As a football player and coach, she says
“Even as I was learning things in school I would try them out in my own games. Something as simple as sitting on the bench and looking up at people. Your body posture says a lot, and you would never find me with my head down. That was something I learned in psychology – the way we interpret the behaviour of other people, and realizing that the impact you have on your competition is just as relevant between the plays as it is during the plays you make. I still work with athletes on a lot of that to this day, in both big and small ways.”
Jen, in addition to producing TV, breaking barriers for women in sport, collaborating on fashion projects and encouraging young girls to break through preconceptions, is currently working on a follow-up to her book Play Big: Lessons in Being Limitless from the First Woman to Coach in the NFL. The follow-up will focus a lot more on the lowlights of her career than the highlights. She says it’s the kind of thing that doesn’t get spoken about very often, since we all tend to talk about the highs without truly examining disappointments and struggles. For example,
“My first book got turned down by everyone because they said ‘women in football doesn’t sell’. I mean…I’m pretty sure I was the first – how many times have you tried? I’ve done it on the field, and now I have to do it in literature?”
Then, she sums up her entire post-psychology-PhD career in one sentence.
“It’s constantly answering questions that other people have not even known should be, or could be, asked.”
 Eva Best
Eva BestLast year, Eva Best earned a CPA award for her thesis on the ‘positivity effect’. This year, she scored a terrific research job at Gameloft, one of the biggest mobile gaming companies in Canada.
Eva Best
When Eva Best stays up way too late, it’s because she’s gone down a rabbit hole on Wikipedia, researching marine animals and getting more and more engrossed in the nesting habits of the leatherback sea turtle. That, or she’s strumming the ukulele, shredding on her Fender Stratocaster, and making music until the wee hours.
Many of the rest of us stay up way too late playing Overdrive City or Disney Magic Kingdoms on our iPad. And we are the people who are of particular interest to companies like Gameloft. Eva is the manager of the qualitative research department in user experience at Gameloft Montreal, one of the biggest mobile gaming companies in Canada. Psychology graduates, and researchers like Eva, are becoming more and more a part of gaming companies as their particular sets of skills are ideally suited to the job. They allow gaming companies, and really any company that has a service or an interface used by human beings, to make decisions based on reports and data that is accurate, correct, complete, and relevant.
Qualitative research in a gaming company is currently more geared toward usability and functionality. Whether an app works, how easy it is to navigate, and so on. Moreso than in the past, the approach to user experience is a ‘holistic’ one, and people with backgrounds in research – especially those whose research experience is in a multidisciplinary environment – are increasingly in demand.
Eva graduated with her Master of Science in psychology from the University of Montreal, then obtained a PMP (Project Management Professional) certification from the Project Management Institute, precisely so she could get a job like this one.
Last year, Eva’s Master’s thesis on the “positivity effect” earned her a Certificate of Academic Excellence from the CPA. The positivity effect is a phenomenon where elderly adults tend to rate negative stimuli as less negative and positive stimuli as more positive than do younger people. Eva’s research provided a ‘proof of concept’ that this trend appears to be almost a straight line from birth, as children rate their responses to stimuli more negatively than do young adults, who in turn report more negative feelings than older adults, and so on.
Her project proposed a new theory on “lifespan emotional development”. One that put the positivity effect at the peak of development by showing that it can be produced in younger people as well. When they are desensitized by exposure to a negative stimulus, even younger people are likely to rate all other stimuli in a more positive way. Even the most neutral (boring) stimulus can feel more positive under these circumstances.
Gaming makes life less boring while in the waiting room or on the bus, for example. Figuring out how to improve your gaming experience is the goal of the qualitative research department. Who better to help create and ensure a positive experience than Eva? If she can make you as interested and invested in a mobile game as she is in gaming, sea turtles and the ukulele, then mission accomplished!
 Lauren Florko
Lauren FlorkoDr. Lauren Florko is the founder of Triple Threat Consulting, providing managerial consulting for corporate social responsibility, change management, and organizational development.
Dr. Lauren Florko
“Consultant” is such a nondescript term, isn’t it? Virtually everyone can style themselves a “consultant” when writing a CV or a LinkedIn profile. Which is why it’s good that Lauren Florko can get a little more specific than simply saying she’s “self-employed” as a “consultant”.
Lauren created Triple Threat Consulting, a firm which provides managerial consulting for a variety of projects - from corporate social responsibility to change management to organizational development. With a Ph.D. in Industrial/Organizational Psychology specializing in workplace stress, Lauren’s statistics training gave her a competitive advantage over similar consultants who come from a HR background.
Triple Threat Consulting plays on the film industry’s play on ‘triple threats’ as she specializes in Talent Management. The “Triple” also plays on the concept of triple bottom lines (planet and people outcomes on top of profits).
Triple Threat Consulting also fills a unique market need with psychological assessments, thanks to Lauren’s training. This means empirically-based strategies with practical implementations. Statistical analysis and reporting to produce key business insights. And the ability to engage a variety of audiences through keynotes and workshops.
The founder of a Multi-disciplined Research Lab, one of Triple Threat’s clients, says:
“She's doing advanced research methodologies...doing hierarchical linear modeling and item response analysis...She is highly motivated, particularly with high end analysis – she gets excited about that. She is very punctual with delivery."
What Lauren likes most about her job, she says, is the work-life balance it affords her. Well that, and of course the excitement she derives from high-end analysis to drive better business decisions.
 Heather Orpana
Heather OrpanaHeather has a long career in public service, working in three different federal departments. She recently moved into Substance-Related Harms, to help tackle the opioid crisis.
Heather Orpana
This is an excerpt from a larger article written by Dr. Heather Orpana in this month’s issue of Psynopsis. Click this link to read the whole article.
My path to a career in psychology was in no way a straight one. I started an undergraduate degree in science with a specialization in physics before completing two years of a baccalaureate in nursing and then finally switching to, and graduating with, an honours degree in psychology. After spending a summer as an intern at a non-profit organization writing plain language summaries of research studies that would impact patients, I decided to pursue a career in research and applied for my doctorate. I wanted to be part of the system that creates the evidence used to promote the health of the population.
I completed my doctorate in experimental psychology at the University of Ottawa, at the same time that the university was establishing a multidisciplinary program in Population Health. I was very fortunate to be funded by Health Canada’s National Health Research and Development Program, and the Canadian Institutes of Health Research during my doctorate and was hired by Health Canada to conduct policy-relevant data analysis before I had finished my program.
It has been sixteen years since I started my career in public service. During that time, I have worked in three federal departments: Health Canada, Statistics Canada, and the Public Health Agency of Canada. Every single position I have held has benefited tremendously from my training in psychological science. My first analysis project demonstrated the relationship between mental health and healthy living behaviours, in 2003, using Canada’s first national mental health survey. After working for several years at Health Canada, conducting analysis, and contributing to data policy and coordination, I moved to Statistics Canada to focus on research and analysis. There, I engaged in research in the areas of healthy weights, healthy aging, and mental health, all informed by my education in psychology.
Most recently, I have been appointed as a Senior Research Scientist and am working in the Substance-related Harms Division, supporting surveillance and applied research contributions to addressing the opioid overdose crisis. In this role, I advise on research methods and conduct research studies to inform our understanding of how the crisis is evolving.
Public health cannot address the complex problems we are faced with in the 21st century without the knowledge and skills of psychological science researchers. I have yet to find a single public health issue that is not informed by our discipline. Even public health issues that may seem like they belong more in a wet lab, such as anti-microbial resistance, can be addressed only with the incorporation of a behavioural perspective. I hope that other psychological science researchers see their value in contributing to improving the health of all Canadians.
 Gregory Craig
Gregory CraigDr. Gregory Craig is part of a team of “human factors researchers” at the National Research Council. His work might one day lead to a new frontier in aviation – pilotless airplanes.
Gregory Craig
One day, you might take a flight from Saskatoon to Dublin. There will be in-flight movies, tiny difficult-to-open bags of peanuts, flight attendants distributing cheap headphones and tiny pillows, and free tiny cans of wine once you’re over international waters. There will, however, be one major difference. On this flight, there will be no pilot.
At least, such a thing is possible. But not until a whole lot more studying is done on the subject. Some of those studies are currently being conducted by Dr. Gregory Craig and a team of human factors researchers at the National Research Council of Canada.
Gregory has been involved in a wide variety of research projects. He’s done research on night vision goggles, displays for infrared cameras for search and rescue, and the design of symbolic information displays for pilots. Currently, he’s involved in examining ‘trust in automation’ to assess pilots’ trust in automatic flight systems. This ranges from basic elements like an off-the-shelf autopilot to looking at fully autonomous (no pilots) flight.
Gregory spent his formative years at Carleton University, earning a PhD in Cognitive Psychology in 1997. While his current role is mostly unrelated to his studies, he credits the people he met along the way for getting him to where he is today.
“There is a wide gulf between what I studied in university and the type of research that I do now. The main elements of my university studies that helped were basic experimental design, document editing and data analysis. Much of my training in applied research came from one of my supervisors who was employed at the Communications Research Centre and an adjunct at Carleton. He encouraged me to participate in several of the applied research projects that he worked on for CRC. The other source of applied research thinking came from a course for which I was a teaching assistant at Carleton. The course was a basic introduction to sensation and perception, but the prof teaching the course had a large number of industrial design students in the class. For those students, the prof took the time to explain how basic elements of sensation and perception could be applied to the design of systems and products intended for use by the general population.”
One might expect a psychologist to lead project teams, analyze data, submit research proposals, prepare reports and presentations, and manage projects. But maybe not to design and conduct flight tests, evaluate advanced cockpit technologies, and explore human factors issues for pilots, crew and passengers.
So think about Gregory Craig the next time you’re on a plane – it might be his work that enhanced the technology in the cockpit, or designed the display used to navigate. And while you’re doing that, you might want to check to see if, up front in the cockpit, there’s still a pilot.
 Alexandra Thompson
Alexandra ThompsonDr. Alexandra Thompson is a Program Leader with the NRC working on ‘High Performance Buildings’. Her team aims to reduce energy emissions by identifying industry, scientific, technological & societal issues that can stall the adoption of new technologies.
Alexandra Thompson
Alexandra Thompson is helping to devise a vision for future scientific exploration, as a Program Leader with the National Research Council of Canada. She manages a large team and a portfolio of science and engineering projects focused on a strategic goal. Specifically, that goal is focused on the ‘High Performance Buildings’ program.
This program, established in 2013, aims to reduce energy emissions in buildings by identifying the industry, scientific, technological and societal issues that could stall the adoption of new technologies. Alexandra is working at knowledge mobilization (the translation of science to action) to ensure the science is used for environmental change. She also has the chance to encourage younger researchers to develop their careers, scientific interests and to have confidence in their abilities.
In 2007, Alexandra obtained her PhD in environmental psychology and human factors from the University of Southampton in the UK. She says her training has aided greatly with, among other things, knowledge mobilization.
“My psychology training has enabled me to ensure good scientific methodologies and statistical analysis are used and the ethics of a project are considered. Also, working in an engineering multi-disciplinary environment understanding the human and societal implications of an engineering project has helped with the applicability of projects to real world conditions or expectations.”
As climate change becomes more and more devastating, and as environmental concerns become the number one national priority, programs like ‘High Performance Buildings’ will be at the forefront of the effort to curb emissions. Knowledge mobilization to that effect is becoming more critical than ever. We’re glad that Alexandra Thompson, and others like her, are working on those exact things. Bringing about the change that is needed to tackle the most serious issue of our time.
 Robin Langerak
Robin LangerakWorking as a Design Researcher on a suite of business intelligence software tools at IBM’s Ottawa studio, Robin Langerak says “I get to do a little bit of everything I loved about running my own research studies as a psychology graduate student!”
Robin Langerak
It’s convenient when you can find a career in the city where you are completing your PhD. Such was the case for Robin Langerak, who began working at IBM in their Ottawa Studio while completing her doctorate in Cognitive Psychology at Carleton University. She has now been there more than a year, working as a Design Researcher on a suite of business intelligence software tools designed and developed by the Ottawa product team.
Robin provides design recommendations that will help improve the user experience for this software. That involves everything from problem definition to study design and data collection to synthesis and communication of research findings. Psychology has prepared her for all of this in a big way. She says,
“Data collection, storage, and analysis methods that I learned in training are invaluable at my job. I also rely on the understanding of human thought and motivation that I studied in school as well as the techniques I learned to check my bias and measure constructs as accurately as possible.“
The best thing about her job?
“I get to do a little bit of everything I loved about running my own research studies as a psychology graduate student in a fast-paced, high impact environment.“
 Suzanne Simpson
Suzanne SimpsonDr. Suzanne Simpson founded the talent management firm Human Resource Systems Group Ltd. more than 30 years ago. Now the CEO, HRSG is a global company, hiring people and taking on clients from all over the world
Suzanne Simpson
For much of this month, we have been focusing on jobs and careers available to psychology majors once they graduate from school. Suzanne Simpson not only found one of those careers, she helps others find theirs. Suzanne is the founder and CEO of Human Resource Systems Group Ltd. (HRSG), a software-as-a-service talent management firm.
What that means is that her company creates software for human resources departments to simplify their work. Need to build the perfect job description, so you can attract the perfect employee? HRSG has the software for that. Then they have an interview guide built for you, so you can make the correct decision. Now you have a new employee with a job description that puts them and their management on the exact same page. From there, that employee might use one of HRSG’s career pathing programs, complete with assessments and learning resources to help them in their current job today, and to reach their dream jobs tomorrow.
All of this is built based on Suzanne’s training in psychology. She earned her PhD in Industrial/Organizational Psychology from the University of Ottawa, and says the training she received there supports the main focus of HRSG’s service and software offering to their clients.
HRSG celebrated 30 years in business in 2019 and offers its services and products to organizations worldwide. HRSG employs professionals trained in Industrial / Organizational and other related disciplines from across Canada and around the world.
It is challenging to build a business, and very rewarding when it comes to fruition. Suzanne takes satisfaction in offering a service that is highly valued by her clients, and embraces the continuous learning and innovation that comes with her role as CEO.
 Chrissy Chubala
Chrissy ChubalaDr. Chrissy Chubala helps naval personnel make better decisions during mission planning and execution. She is a Defence Scientist in Maritime Decision Support at Defence Research & Development Canada’s Atlantic Research Centre.
Chrissy Chubala
My name is Chrissy Chubala, and I am a Defence Scientist in Maritime Decision Support at Defence Research & Development Canada’s Atlantic Research Centre. My job is to guide and assist in the development of tools that will help naval personnel make better decisions during mission planning and execution, from the perspective of cognitive psychology. This involves a consideration of human factors, human-computer interactions, team dynamics, and basic cognition.
My training in psychology (PhD, Cognitive Psychology, University of Manitoba 2017) has provided me with both concrete and abstract forms of knowledge that help me in my current role. The concrete skill sets of experimental design and statistical inference are directly applicable to my work, although the constraints and goals of applied research are different enough from those of academia that some relearning and rethinking has had to occur.
Thankfully, the more abstract forms of knowledge provided by my training have positioned me well for this transition. My training in psychology taught me versatility, creativity, and lateral thinking. I have the ability to learn about a new topic very quickly, to creatively apply my existing knowledge and skill sets to new scenarios, and to find connections between seemingly disparate ideas or fields of study. With these abstract skills in hand, I have been able to adapt my more concrete areas of expertise to the requirements of the job.
What I enjoy most about my current position is the level of structure it provides, the direct sense of impact that comes from conducting applied research, and the ability to collaborate and exchange ideas with a very diverse group of scientists.
I receive specific problems to solve but I am free to explore them in any manner I see fit; this provides me with some structure around which to focus my efforts, but enough flexibility to follow my interests. Moreover, the ability to see the direct effects of my research on the lives and work of others is rewarding in a way that my academic career in experimental psychology was not. Finally, I get to work with interesting and brilliant researchers from all areas of study, from physics to chemistry to computer science. Not only do I get to learn new things I would otherwise know nothing about, but my own unique perspective and expertise are a valued part of the whole and I get to teach as much as I learn.
 Amy Bucher
Amy BucherAmy Bucher graduated with a PhD from a psychology program that no longer exists, and that made her skill set unique in the post-grad world. She puts those skills to use at Mad*Pow, a design agency that improves peoples’ experiences with technology, services, organizations and each other.
Amy Bucher
“Mad*Pow leverages strategic design and the psychology of motivation to create innovative experiences and compelling digital solutions that are good for people and good for business.”
That is Mad*Pow’s mission statement, ripped right from their webpage. Mad*Pow employs medical doctors and all kinds of behaviour change design experts. But perhaps you would be surprised to learn that Mad*Pow’s behavior change experts come from a variety of training backgrounds. Currently, there is only one person on the team with a PhD in psychology!
That one person is Dr. Amy Bucher, the vice president of behaviour change design at Mad*Pow. Amy brings a unique skill set to her position, and took a rather unique path to get there. She started school at Harvard, doing an undergrad focused on social psychology. From there, she moved on to the University of Michigan at Ann Arbour for her Master’s and PhD in Psychology. Although that is the official title of her degree, it was achieved a little over a decade ago in a program that no longer exists.
It was called Organizational Psychology. It was not an Industrial/Organizational program of the type we see offered now, it was more as Amy describes it a “contextualized social psychology program”. That means that when she graduated she was more of a social psychologist, albeit one with a deep knowledge of workplaces and organizations.
Amy realized as she was nearing the end of her schooling that she did not want to go into academia. That track meant specialization, and she wanted to broaden her horizons rather than narrow her focus. She began to work with other researchers and learned many different research methods before graduation. She learned how to dive into information and deal in the “grey areas”. After all, research is always in progress.
That comfort with the “grey areas” has served her well at Mad*Pow, as often clients will ask Amy for definitive answers on how to tackle a problem. She is adept at explaining that while formative research can provide a direction, it can’t often come up with a concrete and foolproof series of steps to take to achieve an aim. It’s important to experiment with different approaches that are specific to the clients’ customers and their needs to figure out the best solution.
Her desire to broaden her scope is also an asset, as Amy thrives on having a variety of projects and problems to work through. She likes being exposed to new things. She says,
“Right now, I’m leading a project to understand what people with a rare genetic condition might be looking for from an online portal to support their condition management. So we’ve designed moderator guides, recruited people with this condition, and recruited people who serve those with this condition to conduct interviews. We’ll be creating output reports with insights from that research, doing a workshop with the client that we will also design, then translating all the insights from the research into designs for this portal.”
Amy says that before starting this project, she had never heard of this particular genetic condition before (it is very rare). Now she’s had the opportunity to learn quite a bit about it and understand more about the day-to-day lives of the people who live with it.
“I feel excited by this type of new knowledge that I don’t think I’d encounter in any other way.”
She’s also excited at the prospect of some new colleagues. There are many different types of researchers at Mad*Pow (which further helps Amy broaden her horizons as she learns from them), but soon there will likely be a few more psychology grads joining the fold. As Amy says, there are now many great opportunities outside academia for graduating researchers. And working alongside Amy seems like a pretty great opportunity.
 Liane Davey
Liane DaveyA writer, blogger, public speaker, and volunteer board member at the Psychology Foundation of Canada, Liane Davey has made her mark on corporate culture with her consultancy group 3COze.
Liane Davey
“You need to have more conflict.”
This is Dr. Liane Davey’s advice to almost every organization with which she works. These include enormous companies like TD Bank, Amazon, and smaller companies like Shoretel. Chris Burgy, former VP of Strategy at Shoretel, says of Liane and her company 3COze,
“Liane supported us in rolling out a methodology for productive communication and conflict to our top 100 leaders in the company. Without a doubt, I fervently recommend Liane to any company seeking to improve their organization’s accountability, communication methods and for those seeking a fantastic facilitator for strategic level planning.”
3COze is named in conjunction with their mission statement. They seek to transform the way people “communicate, connect, and contribute” in their organizations. Liane is the co-founder and principal of 3COze, and brings her “more conflict” approach to CEOs and senior leadership teams around the country and across the world.
She says the number one thing that’s getting in the way of productivity is that people are avoiding conflict and being passive-aggressive. That means conflict sits unresolved causing a lack of productivity, eroding trust and engagement, and causing stress for individuals.
Liane says the things she learned in obtaining her PhD in Industrial/Organizational Psychology from Waterloo are the same ideas she puts into practice today.
“It’s very much applied social psychology. So, issues of motivation, team dynamics, conflict, culture, all the sorts of things that are the bread and butter of organizational psychology have been my whole career.”
And what a career it has been! Not only does Liane work with some of the biggest CEOs and companies around the world, she is also an author (her book The Good Fight: Use Productive Conflict to Get Your Team and Organization Back on Track is available at online book sellers everywhere), a blogger (at www.lianedavey.com) and a public speaker, bringing her message of productive conflict to corporate crowds everywhere.
She is also a volunteer member of the board of trustees at the Psychology Foundation of Canada (PFC), a charity that brands itself a “child-based (birth-18) mental health promotion organization” thanks in part to Liane’s strategic skills in directing the board and the group. And also her ability to create productive conflict, and not to shy away from uncomfortable conversations.

She first encountered the PFC at a fundraising breakfast twelve years ago, and was impressed by what they were able to do with so few resources. With just a handful of staff members and an army of volunteer facilitators, they were able to create resilience, attachment, and stress management skills in what are now hundreds of thousands of Canadian children every year.
When not writing, blogging, speaking, volunteering, or whipping a group of executives into shape, what does someone like Liane do? Well, she says it’s often important to do things at which you are terrible. With that in mind she just had a Bob Ross paint night with her kids, and the painting now rests proudly in her house. A Bob Ross paint night sounds like just the kind of soothing, mellow thing that might be as far from “conflict” as possible. And even the expert on the subject likely needs a break from conflict now and then, if only for a little while.
 Angela Febbraro
Angela FebbraroA defence scientist with Defence Research and Development Canada, Angela Febbraro works to create messaging that counters the recruitment propaganda put out by extremist groups like ISIS.
Angela Febbraro
What messaging does an extremist group, like ISIS, use to recruit young people to join? Is their messaging different for young men than it is for young women? And how can we create a counter-messaging strategy to dissuade those people from a life of extremism? These are the questions currently being tackled by Angela Febbraro and her team of (mostly social psychologists) at Defence Research and Development Canada (DRDC).
Angela is a Defence Scientist, and has studied all kinds of issues pertaining to national defence, most of them around gender. Early on, she studied the leadership styles of women in leadership positions in the military. Did they feel the need to conform to a more stereotypically “masculine” leadership style, or were they comfortable forging their own? It turns out that women in those leadership positions did not feel the pressure to behave in a more “masculine” fashion, but at the same time women in more subordinate positions felt this pressure quite acutely.
In discussing the studies in which she’s involved, Angela speaks a lot about context. Early on in her school journey, she was struck by the notion that human behaviour depends in such an enormous way on the context in which that behaviour occurs. Now, after all that school and a PhD in Applied Social Psychology from the University of Guelph, context still matters a great deal.
Yes, the messaging from extremist groups target men and women differently. But counter-messaging must take into account much more than just gender. Angela and her team look at the local landscape in the areas that are being targeted. The culture in that part of the world, the method through which they receive the extremist messaging. A counter-messaging campaign to prevent the radicalization of a young woman in the Idlib Governorate in Syria might be vastly different than one targeting a young man in Maple Ridge BC. Or even one targeting a similar young woman in a neighbouring province of Syria.
There are many highlights in Angela’s job, but she says this, specifically, is the best part:
“The opportunity to apply my expertise (e.g., on gender and diversity, developed during my graduate training in psychology) to current defence and security challenges (to work on interesting/exciting challenges, such as gender and counter-radicalization!); the opportunity to communicate my research findings/analyses through written reports and articles; and the opportunity to mentor junior scientists.”
Angela’s scientific training in psychology, both content-related and methodological, has helped her carry out her responsibilities as a defence scientist. At DRDC her focus is on conducting applied, defence-related research, and broadening her expertise to address current and future defence and security challenges. Her responsibilities include planning, organizing, conducting, analyzing, and reporting basic and applied social- and organizational-psychological research; interacting with the Canadian Armed Forces and other national/international security partners; and building the scientific capabilities of the entire organization.
And currently, of course, using psychology to counter the propaganda of extremist groups all over the world.
 Amanda Parriag
Amanda ParriagAmanda owns her own consulting business, the ParriagGroup, and spends much of her spare time working in her Ottawa community to end violence against women.
Amanda Parriag
“Amanda is a star! She has leveraged her MUN education to provide stellar research and evaluation services. She has become a trusted advisor to her clients and is a leader of Women's issues in Ottawa. She was the president of MediaAction for 8 years, has run Ask Womxn Anything for more than 5 years, and sits on the board of the Ottawa Coalition to End Violence Against Women (OCEVAW). She has owned and operated her own business for 20 years and for me, she is a friend, a supporter and a role model.”
Susan Underhill is effusive in her praise for Dr. Amanda Parriag, her current colleague and collaborator and long-time friend since university (MUN is the Memorial University of Newfoundland, where they studied psychology together years ago). Amanda obtained her PhD from MUN, but not a lot of her clients know this. She doesn’t refer to herself as “Dr.” and rarely tells people she has a PhD in psychology. That’s because when she does, she finds people behaving a little differently, choosing their words more carefully, and thinking that Amanda is psychoanalyzing them at every turn.
Not exactly her thing – Amanda is a researcher – but on occasion this response can come in handy! Amanda runs the ParriagGroup, a consultancy that specializes in research, evaluation and performance measurement. Her small business has been running for 20 years, and while Amanda is the lead on everything, she works with a team. She has six research assistants and six consultants that she pulls in at different times to complete bigger projects.
The ParriagGroup works mostly with governments and not-for-profits. Recently, she and her team worked with an Ottawa not-for-profit on a program they were doing jointly with another not-for-profit. It was a program to work with women who were potentially victims of gender-based violence, and were intersecting with the child welfare sector. The program was designed to provide an intersectional lens in supporting the women and their families. It had been running for a few years, but the group wasn’t sure they were helping the women in the way the program was designed. Amanda and her team looked at the location of the program, the governance, how it was resourced, the skill sets of the people working within the program. The ParriagGroup also did a document review to determine what had been written about how these types of programs were supposed to function.
The group took Amanda’s recommendations to heart (always gratifying!) and ran with them. They made some immediate changes, started to implement others, and looked to outsource a few more. Amanda says,
“Hopefully, because of my work, women in the community who are in this frustrating space, intersecting with the child welfare system and potentially experiencing gender-based violence, can get better support. This can help them make better decisions and move forward in a more sustainable and human way.”
This is where Amanda’s real passion comes out. She feels lucky to be living the dream – she works out of a home-based office with the rest of her team spread across Canada. She can carve her day out as she pleases. And on a beautiful sunny day, she can post an out-of-office and spent time in the pool.
And she also loves the time she can take to work in the community. The focus of her studies at MUN and Carleton was gender-based violence, and she is still doing everything she can in that field.
Susan mentioned Amanda’s work with OCEVAW, and Ask Womxn Anything. AWA gathers together amazing women from the Ottawa community to talk about their expertise on a particular topic. People from across the city are invited to come and have a discussion in a warm and inviting environment. Amanda says,
“Women are not often heralded as experts and so this is an opportunity for these women to be recognized as such, especially among our peers. And it’s an opportunity for women and men in the Ottawa community to see these experts. You can’t be what you cannot see.”
The next Ask Womxn Anything event is called ‘Black Womxn Making the World A Better Place’. They are focusing on black women because February is Black History Month, and the AWA panels are designed to be intersectional without tokenizing the participants. ‘Black Womxn Making The World A Better Place’ is coming up February 18th – at the Pressed Café, if you’re in the Ottawa area. The speakers include Deborah Owusu-Akyeeah, a feminist activist and Campaigns Officer at OXFAM. Meghan Wills, President at Parents for Diversity and current project coordinator at the Michaëlle Jean Foundation. And Maya McDonald who is an educator, facilitator, and storyteller – among many other things!
AWA is a great way for people in Ottawa to get to know experts and remarkable women. Much like Amanda herself, and Susan, and the splendid teams with which they surround themselves.
 Anne-Marie Côté
Anne-Marie CôtéAnne-Marie coordinates virtual field trips, among many other things, for students in remote northern indigenous communities with a program called Connected North.
Anne-Marie Côté
Anne-Marie Côté became passionate about the field of education after accepting a three-month replacement contract in a school in Guyana, South America, where she ended up spending the next two years. She was able to experience and understand the crucial impact teachers have on shaping how kind, resilient, adaptable, and confident students become regardless of curriculum taught, and therefore how important it is for students to be surrounded by positive role models at school. Back in Canada, she now teaches an online English as a Second Language course to children in China, and she also works with TakingITGlobal, a non-profit whose mission is to empower youth to understand and act on local and global challenges. She mainly works on a program called Connected North.
Connected North delivers immersive and interactive education services to remote indigenous communities in Northern Canada through Cisco’s TelePresence video technology. Anne-Marie coordinates virtual field trips and guest experts for schools in Nunavut. She also works on developing Francophone content for the program.
Anne-Marie says her Master’s in Organizational Psychology from Carleton University has served her very well in her professional career:
“My psychology training has helped me in my work with children and Indigenous communities. It's helped me approach everything I do from a standpoint of compassion and understanding. Every behaviour has a reason. People don't just ‘’do things for nothing’’. It's helped me appreciate that anyone "in trouble'' (or not, everyone in general) has their own story and if you're trying to make change you need to invest and really care about people.
My organizational psychology training has also helped me understand the dynamics of the workplaces I have been a part of. It's helped me understand good and bad leadership, and how to recognize these. Although I’m not currently consulting, it's also helped me guide some of my workplaces through change and development as well as understand program evaluations and other organizational development processes.
It’s also made me become a better employee in general. I know from the research what makes happy employees and organizations and it has made me brave enough to ask for certain things or just share some of this knowledge with employers in hopes to make a better workplace for everyone. This training has also made me more compassionate. Just understanding some of the processes behind human behaviour makes you really care about people and where they’re coming from.”
Anne-Marie is thrilled that she is able to positively impact children in so many different ways.
“Children spend most of their time growing up at school and I think it's so important for them to be surrounded by supportive adults and be in an environment where they feel safe to be who they are and to learn. Equally, it’s important that they have access to engaging and culturally relevant educational resources, regardless of where they are. That's really my main goal working in education; build empowering and innovative classrooms and be a positive role model children feel like they can come to easily.”
She loves being part of this incredible program that creates opportunities for Indigenous communities in the area of education – an area that's so important, and where a lot of trauma still lies. Her hope is to begin to focus on programs that promote mental health and teach emotional regulation early on in those schools where she makes such a large impact.
 Susan Underhill
Susan UnderhillPresident of the Connor Claire Group, a consulting firm that works with both the government and non-profit sectors, Susan is a specialist in doing more with less.
Susan Underhill
For people who work in the non-profit sector, doing more with less is a massively important key to being successful. When it comes to the public sector, we Canadians are all invested in efficiency and innovative practice. Thankfully, there are people out there who specialize in helping such organizations become the best they can be. Susan Underhill is one of them.
Susan is a management consultant for both government and the non-profit sector, as President of the Connor Claire Group. She does policy research, organizational design and development, coaching, business process improvement, and much more to help improve the performance of organizations of all shapes and sizes. Her colleague and collaborator, Amanda Parriag of the ParriagGroup, says of Susan,
“We went to university together and have stayed friends through the years. In the last few years we’ve had the opportunity to work together. It’s really a joy for me. We don’t agree on everything, but she can present things where she needs to change my mind in such a way that I can hear it. I implicitly trust her, she’s extremely smart and gets things very quickly. I really love working with her.”
We asked Susan how her training in psychology (she has a Masters in Experimental Psychology from the University of Newfoundland) has helped her in her current role.
“I am a good researcher - both qualitative and quantitative. I know what questions to ask, where to find information, and how to interpret that information to provide sound, evidence-based policy advice. Psychology has also helped me to consider organizational dynamics and the impact of these dynamics on implementing changes.”
One of the highlights of a job like Susan’s is that there are a never-ending set of policy questions that require new research. Susan says she loves the variability of her job and supporting government and not-for-profits to better serve individuals who need important services.
 Sophie Kenny
Sophie KennyA staff scientist for VPixx Technologies, Sophie helps bring eye capture technology, among other devices, to scientists and labs around Canada and the rest of the world.
Sophie Kenny
Somewhere in the world, right now, there are researchers using a specialized device manufactured by VPixx Technologies. These researchers might be working in a behavioural laboratory, an MRI or MEG space, or even working with non-human primates. That device might be an eye tracker, a video projector, a sound system or a calibrated visual display.
Whichever device they are using, there is a strong possibility that Sophie Kenny helped to bring their work to fruition. As a staff scientist for VPixx Technologies, Sophie works directly with the academic community. Her role is not only to understand the current needs of researchers, but also to identify research trends and opportunities for growth of the company.
More precisely, Sophie provides consultation services for lab setups. She writes work orders for custom software and hardware development, designs and presents product or technology-oriented workshops, and gives seminar lectures and invited talks. She also visits conferences (Society for Neuroscience, the Vision Sciences Society, the Psychonomics Society) to interact with academic clients and partners. It is there that she sets up independent and collaborative research projects, such as conducting literature reviews, methods papers, and perceptual/cognitive experimental research.
Sophie obtained her PhD in Brain, Behaviour, and Cognitive Sciences from Queen’s in 2017, and says that her academic studies have prepared her admirably for her current career:
“During my research training, I have worked on research spanning attention, reading, memory and movement perception research. Through this broad experience, I used advanced methodologies which have included eye tracking, whole body motion capture, virtual reality headsets, fMRI recordings, and scripting for high-level research experiments software and game engines. This knowledge and skill base has been invaluable, because in most aspects of my work, I am called to comment and advise clients and colleagues on a eclectic variety of research designs and applications.”
Now working for a company doing those exact things, Sophie has found her niche.
“VPixx Technologies is an incredibly dynamic and collaborative environment. I feel that as a staff scientist, my work has a positive influence on the quality of the work that happens in our industry, and ultimately, in the laboratories of the researchers who use our devices.”
 Troy Forcier
Troy ForcierTroy has worked in Child and Youth Mental Health for years, since graduating with an M.Ed. in Education Counselling Psychology. He is the Director of Operations for the Ministry of Child and Family Development (MCFD) in Williams Lake, B.C.
Troy Forcier
You might expect someone with an M.Ed. in Education Counselling Psychology to work as a Child and Youth Mental Health clinician, or some such thing. And Troy Forcier did, for several years after graduating from UNBC. From there, he moved on to a job as a clinical supervisor, before taking on his current endeavour.
Troy is the Director of Operations for the Ministry of Child and Family Development (MCFD) in Williams Lake, British Columbia. The MCFD is, among other things, the main child protection service for the province. They also do a lot of preventative work (family support, parent psychoeducation groups, Child and Youth with Special Needs support). Troy manages contracts, HR, resources and guardianship, facilities, child and youth mental health for the region, and community relations.
After spending many years dealing one-on-one with children and families, Troy embraces the more bureaucratic nature of his new position. There are two things, above all others, that make this job pleasurable for Troy. One is working with people – something he has always done, but it is now in a different context. The other is making change – specifically, changes he can help create at his own specific bureaucratic level.
 Natalie Therrien Normand
Natalie Therrien NormandNatalie is a Program Manager at the provincial team that oversees grants made by the Ontario Trillium Foundation. Her current work is informed enormously by her studies in psychology and experience as a TA.
Natalie Therrien Normand
My name is Natalie Therrien Normand, and I'm a Program Manager at the provincial team that oversees grants made by the Ontario Trillium Foundation (OTF), an agency of the government of Ontario. I have my MA in Experimental and Applied Psychology from the University of Regina. I received it in 2013, but so much of what I did at university I am still doing today.
I help people apply for grants by delivering presentations (like the courses I used to guest lecture in as a TA) and doing one-on-one coaching (like office hours), I assess grant applications when they come in (like scoring papers and exams as a TA), and monitor grants that are funded (which works a lot like monitoring all the work happening in my old labs). I also work on OTF's volunteer education initiatives to train our volunteers to meet corporate goals. This means a lot of juggling, like in my academia days.
Studying psychology has helped me in a myriad of ways. First are the obvious project management skills I learned in my graduate level studies, which apply to managing grants. Juggling multiple projects and deadlines is essential to my work, and indeed my career. But beyond that, learnings about human behaviour and the mind keep popping up, whether it's communication skills, the team-forming framework I learned in, literally, one sports psychology class that comes up over and over again. People think you have crazy ninja human behaviour skills, but it's things anyone can learn in basic psychology courses (which is what I tell them!). What may be most important are my critical thinking skills, and being adaptable in a field where feedback and constructive criticism are constant. We all know from our training that the constant cycle of producing work, receiving feedback, and working to improve that work is how you grow, or how a project/paper gets better.
I love that I get to work with people. I love that I get to apply my skills in an unexpected way. I work with people with super varied educational and professional backgrounds but I don't think anyone expects to have someone with an advanced degree in Psychology among them. The assumption is that this would mean I'd be a clinician or a counsellor. And as I mentioned above, even the basic principles of an education in psychology come up in the every day working world.
 Sandra Meeres
Sandra MeeresSandra works for the provincial government in Saskatchewan. She is the Manager of Planning, Evaluation and Improvement in the aptly-titled Office of Corporate Planning Evaluation and Improvement.
Sandra Meeres
In 1994, Sandra Meeres graduated from the University of Saskatchewan with a Masters in Applied Social Psychology. Sandra is also a Credentialed Evaluator through the Canadian Evaluation Society. She achieved the designation in 2017. Today, she remains in Saskatchewan working for the provincial government. Sandra is the Manager of Planning, Evaluation and Improvement in the aptly titled office of Corporate Planning Evaluation and Improvement. She conducts needs assessments, program development and design, program review, and evaluations in human services. Her current work focuses on justice, corrections, and policing. Sandra says,
“All aspects of my formal psychology training have helped in my current role - especially the internship and practicum placements that were part of my graduate program. I have also relied on ongoing professional development to ensure I stay up to date with current practices and trends. I have been working in my field since I graduated – more than 25 years - and I have enjoyed every minute of it. I get to work with a variety of people in many different roles throughout the organization, and also with stakeholders from other ministries and external service providers.
It's very fulfilling working with key stakeholders - gaining insights by interacting with everyone from clients and participants to program managers and leaders. My work is very satisfying because I know it is helping to provide decision makers with the essential information they need. It guides them to see what aspects of programs and services are working well, and where there are gaps or areas that could be strengthened or improved.”
 Jenn Richler
Jenn RichlerDr. Jenn Richler has always been deeply passionate about championing the work of others. Jenn has a PhD in Cognitive Psychology and is putting it to use as a senior editor at two scientific journals – Nature Climate Change and Nature Energy.
Jenn Richler
The January issue of Nature Climate Change has papers on changing bird migrations, projections of lemur habitats in the Malagasy rainforest, climate change detection in daily weather, and the risk of breadbasket failures. It’s a publication that brings together a number of disparate disciplines from every corner of the world in a common cause – tackling climate change. One of the people responsible for this publication is Jenn Richler, PhD Cognitive Psychology, Vanderbilt 2010.
Jenn works at Nature Research, where she is a Senior Editor at Nature Climate Change and also another research journal, Nature Energy. She evaluates, selects, and oversees peer review of scientific manuscripts from across the behavioral and social sciences, including psychology, sociology, behavioral economics, political science, human geography, and communications. In addition, she commissions, edits, and writes non-primary research content like Reviews, Comments, Research Highlights and Editorials. It’s a job perfectly suited to a psychologist, and Jenn says,
“A key part of my job is evaluating scientific manuscripts from across social science disciplines. Although I handle manuscripts outside of psychology, training in scientific thinking and research design applies broadly across the fields I cover. We also get very ‘hands on’ with papers that are ultimately published, and so the experience I have writing manuscripts and presenting data is very valuable. Finally, being in academic publishing means that I rely a lot on what I learned about publishing and peer-review when I published my own papers in graduate school and during my post-doc. Those experiences were critical to shaping my ideas about what makes peer-review work well, what the problems are, and how we might develop innovative solutions.”
One of the highlights for Jenn is the intellectual side of the job –justifying editorial decisions requires balancing a lot of different factors, as few decisions are easy. It’s intellectually stimulating to craft arguments about each manuscript, and then discuss them with colleagues. This is the part of Jenn’s work that takes place behind the scenes, but is of crucial importance to the final product. Jenn says that, and highlighting the work of others, give her the deepest satisfaction.
"I always liked research, but I was never deeply passionate about any one research topic - I never wanted to have to convince anyone that my research was interesting. I get much more satisfaction from getting a bird’s eye view of a lot of different fields, inviting experts to write about important topics, championing the work of others, and helping authors make their work as strong and impactful as it can be. I feel that I am truly providing a service to my authors, and take a lot of pride in that.”
 Christina Bilczuk
Christina BilczukChristina has achieved a remarkable work-life balance thanks to her background in psychology. She works from all over Canada, from home and from the office on her own schedule, as an Account Executive for McCabe Promotional Advertising.
Christina Bilczuk
One of the things a person might learn in university, if they’re lucky, is the ever-elusive work-life balance. In Louisiana, while pursuing her undergraduate degree, Christina Bilczuk managed to balance her studies with the rigour of playing Division I NCAA soccer. After completing her Masters in Social Psychology at Carleton University, Christina moved on to a job as an Account Executive with McCabe Promotional Advertising, but of course had to maintain her soccer bona fides with her beer league team the Goaldiggers.
Work-life balance is easier when you’re not stuck behind a computer all day. Working from home when you want, traveling as often as you like, in a relaxed atmosphere in an ever-challenging career. Such is the case for Christina at McCabe.
At the moment her work is taking place largely in and around Ottawa, where she is working with the Air Cadets (specifically the 51 Air Cadet Squadron, based out of the Canadian Aviation and Space Museum) on some fun apparel items. She’s doing the same with Camp Fortune, a ski hill located just across the Ontario-Quebec border in Chelsea. Ottawa kids planning to become fighter pilots, or those training to one day compete in the Olympic giant slalom, might soon do so in clothes provided by McCabe.
Christina works directly with clients who need promotional products (anything with their branding on it). Her role requires a lot of person-to-person contact. Some interactions are great, others not so good, but all her interactions are informed and assisted by her training in psychology. Christina says:
“My experience within psychology allows me to take a step back and think about things from [the client’s] point of view (but that also comes from my own struggles while in school, and being able to relate to others experiencing a difficult time). Of course, time management, being able to respond positively to constructive criticism, research skills - there are endless ways in which my education has aided in pretty much every aspect of my life.”
Christina showcases artwork, provides product suggestions and pricing, and she pushes sales through to completion & delivery. She can do all of this from home, while traveling, or in person all over Canada. It’s a role that suits her well, and her background in psychology is what made it such a good fit.
 Marc-André Lafrenière
Marc-André LafrenièreDirector of People Analytics for the National Bank of Canada, Marc-André coaches a team of data scientists, combining scientific rigor and creativity with practical considerations. His team, he says, is “at the forefront of innovation”.
Marc-André Lafrenière
One could make the case that every psychologist specializes in “Advanced People Analytics”, depending on how one defines such a term. For Marc-André Larfrenière, “Advanced People Analytics” is exactly what he does. That’s his job title with the National Bank of Canada. People analytics helps business leaders unlock the power of data to improve the way organizations identify, attract, develop and retain employees
As Director of Advanced People Analytics, Marc-André develops a people analytics vision and a roadmap that are aligned to business priorities. He leads, motivates, and coaches a team of data scientists as they implement methodologies and governance processes to address business needs. Marc-André and his team combine scientific rigor and creativity with practical considerations. In his role, Marc-André is able to provide leadership, subject matter expertise and business insight on all sorts of people analytics projects, including turnover prediction, pay equity analysis, psychometric testing, natural language understanding, and employee engagement analysis.
Marc-André says his PhD in Social Psychology from UQAM has served him very well in his professional career:
“Knowledge of social and IO psychology helps me bridge the gap between business needs and data science. It allows me to ensure that analytics projects are aligned to clearly address business issues. Also, my background in social psychology aided me play a key role as an analytics translator across multiple projects. Furthermore, scientific knowledge that I acquired during my studies and maintained afterward allows me to play a role as a subject matter expert on several subjects (e.g., employee engagement, compensation programs, psychometrics assessment, etc.). Finally, both my expertise in research methods and statistics eased my transition toward data science and allowed me to champion the scientific method and ethical principles inside the organization.”
Marc-André works in a multidisciplinary team, and his particular discipline is well-suited to people analytics. He likes that his team has a direct and clear impact on the business, and helps with HR transformation through technology and data. His is more than just a data translator role, he and his team are, as he says, “at the forefront of innovation”.
 Evangeline Danseco
Evangeline DansecoDr. Evangeline Danseco loves that her job has an impact on improving mental health services and addressing system-level issues. Evangeline is the Performance Measurement Coach at the Ontario Centre of Excellence for Child and Youth Mental Health.
Evangeline Danseco
A position that gives you the opportunity to have an impact on improving mental health services and addressing system-level issues would be desirable for many PhD graduates in Applied Developmental Psychology. Evangeline Danseco earned that degree from the University of Maryland Baltimore County in 1997, and now does just that.
Her psychological training has prepared her with a knowledge of research and evaluation methods (both qualitative and quantitative) as well as of child, youth and adult development, and with skills in critical thinking and writing. These body of knowledge and skills plus a thirst for ongoing learning and a desire to bridge the gap between research and practice, have served her, and Ontario, well.
Evangeline is the Performance Measurement Coach at the Ontario Centre of Excellence for Child and Youth Mental Health. There, she leads the development and implementation of various initiatives taking place in Ontario’s child and youth mental health sector focusing on performance measurement and/or system planning. The province of Ontario recently developed new quality standards in regard to youth and family engagement, and it is Evangeline who has led the evaluation of those standards.
Evangeline consults with and advises key stakeholders such as Ministry partners, expert panels, advisory groups, and lead agencies. She also collaborates with youth and family members on provincial initiatives. Her position has an impact, addresses important issues, and is a terrific example of knowledge mobilization in action.
 Jennifer Veitch
Jennifer VeitchFrom her very first introductory psychology class, Jennifer Veitch knew she wanted to get into environmental psychology. Many classes, years, and a PhD later, Jennifer is living her dream as a Principal Research Officer at the National Research Council of Canada.
Jennifer Veitch
Sometimes, a career path can be determined very early on, whether you know it or not. Such was the case when Jennifer Veitch became excited about environmental psychology in her very first introductory psychology course. She later volunteered in that prof’s lab where she learned practical data collection skills that she still uses today. A few years later, she was graduating from the University of Victoria with a PhD in Environmental Psychology.
To this day, the research Jennifer does is reflective of what she learned in those first intro psych classes, and from that professor. The big difference, in research terms, is the setting. She is a full-time psychological scientist in an interdisciplinary research setting, and uses her psychology skills to study how people relate to their physical surroundings.
Jennifer is a Principal Research Officer at the National Research Council of Canada, where she is responsible for the initiation (including obtaining internal and external funding), management, and conduct of research on the effects of the physical environment on occupants’ behaviour and well-being, and for disseminating the resulting knowledge through pertinent industry and research channels. That means that she publishes papers in journals, but also contributes to national and international standards and recommendations by participating in organizations like the International Commission on Illumination. For example, she leads a project that is conducting a systematic review of the literature on the effects of daytime light exposure on cognition, well-being, and physiology; she also is an active contributor to both North American and international recommendations for lighting that will be based on that literature.
Jennifer says,
“The research I do today is a direct extension of things I learned [in that lab, from that professor] - but now I can study more complex problems with my engineering, physics, and architectural colleagues, and I have routes through which to influence decision-makers to apply what we learn.”




